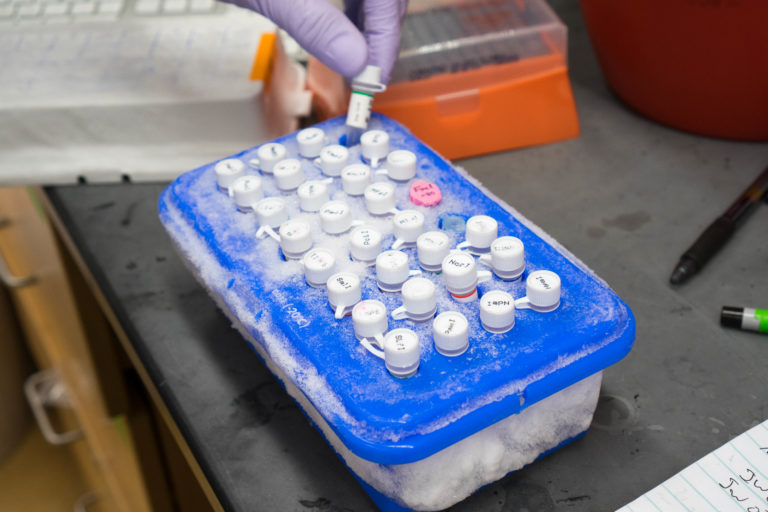Numérisation du vivant, partage des avantages : quelle législation ?

Le libre accès aux « informations de séquençage numérique » des organismes vivants, s’il était sans conditions, se heurterait au partage juste et équitable des avantages engendrés par l’utilisation d’une ressource génétique physique. Car ce partage, lui, est encadré par plusieurs textes internationaux. Malgré ces textes, les lois nationales font le grand écart entre un accès réglementé à ces informations, avec partage, et un accès totalement libre, sans autre partage.
Selon les pays, les « informations de séquençage numérique » [1] (nommées DSI – digital sequence information – dans ce texte) des génomes sont considérées tantôt comme égales aux ressources génétiques physiques elles-mêmes (comme au Brésil, Colombie, Éthiopie, Inde…) ; tantôt comme totalement différenciées (Australie, Union européenne, Japon, Corée du Sud…). Avec des conséquences diamétralement opposées sur l’accès à ces organismes vivants et le partage des avantages qui découlent de leur utilisation.
Grand écart dans les lois nationales
L’Inde, par exemple, revendique que sa loi sur la diversité biologique s’applique sans ambiguïté aussi bien aux ressources physiques qu’aux données numérisées [2] [3]. L’Éthiopie dit la même chose : « Le projet révisé (…) sur l’accès et le partage des avantages intègre les DSI dans son champ d’application et sa définition des ressources génétiques. Une « ressource génétique » (…) comprend les produits dérivés et les informations sur les séquences numériques ».
A contrario, et à partir des mêmes textes internationaux (!), d’autres pays arrivent à des conclusions opposées. Ainsi, l’Union européenne [4] et ses membres, « considèrent que les DSI ne sont pas équivalents à une ressource génétique. (…) Dans le cadre de la CDB et du protocole de Nagoya, (…) le consentement préalable informé (PIC) ne peut et ne doit pas être exigé pour l’accès aux DSI, y compris à partir de bases de données accessibles au public » [5] .
Qu’en disent les textes internationaux ? Depuis 2016, de nombreuses enceintes internationales abordent la question des DSI au regard du partage des avantages [6]. Parmi celles-ci : la Convention sur la diversité biologique (CDB), et son protocole de Nagoya ; le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Tirpaa) ; le cadre PIP (sur la grippe) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) ; la Convention des Nations unies sur la loi de la mer (UNCLO) [7] [8]…
Le partage des avantages est légalement défini
La CDB, entrée en vigueur en 1993, est un « traité international juridiquement contraignant qui a trois principaux objectifs : la conservation (et…) l’utilisation durable de la diversité biologique, et le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques » [9].
Deux textes internationaux concernent ce troisième objectif de « partage des avantages » : d’une part, le Protocole de Nagoya (entré en vigueur en 2014), dans le cadre de la CDB, sur « l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation » [10] ; et d’autre part, le Tirpaa [11], qui dépend de la FAO (entré en vigueur en 2004).
Le Tirpaa concerne 64 espèces cultivées [12] pour des applications agricoles et/ou alimentaires. Le Protocole de Nagoya concerne toutes les autres ressources génétiques, ainsi que les espèces listées dans le Tirpaa pour toute application non alimentaire.
L’objectif de ces deux textes est de permettre l’accès aux ressources génétiques et leur utilisation, tout en reversant une partie des avantages liés à celles-ci. Le moyen utilisé : un accord de transfert de matériel (ATM) [13], signé entre la partie utilisatrice et l’État souverain sur ces ressources [14] pour la CDB ; et avec le Fonds de Partage des avantages du Traité qui mutualise la répartition des sommes ainsi récoltées, en théorie en priorité vers les agriculteurs des pays en développement (mais dans la réalité, vers les organismes de recherche qui s’intéressent aux ressources phytogénétiques détenues pas ces agriculteurs).
À signaler que le partage des avantages peut être monétaire et non monétaire. L’annexe 1 du protocole de Nagoya [15] en donne quelques exemples : partage du revenu des droits de licences, transferts de technologies, formation, accès à des bases de données [16]… Quant au Tirpaa, il prévoit un fonds de partage alimenté pour partie par un engagement (très peu respecté) des bénéficiaires de l’accès aux ressources fournies par l’intermédiaire de son système multilatéral d’accès et de partage des avantages (SLM) de verser une part du chiffre d’affaire des produits commercialisés à partir de ces ressources génétiques [17]. Mais pour les détenteurs de brevets, rien ne les oblige à déclarer quelles ressources ils ont utilisées et donc à partager les avantages qu’ils en retirent. Le paysan, lui, doit acheter les semences de la variété avec un prix intégrant les droits de licence et payer des royalties s’il veut utiliser les semences issues de sa propre récolte de cette variété. Et si le génome d’une plante est séquencé, certains argumentent que le simple fait de rendre les séquences accessibles à tous est aussi une forme de partage des avantages [18].
Selon le président de la Fondation pour la Recherche sur la Biodiversité (FRB) en France, « les échanges relatifs au partage juste et équitable des avantages n’auraient porté que sur quelques milliers ou dizaines de milliers d’euros à l’échelle mondiale » [19]. Ces textes internationaux ne garantissent donc finalement que très peu de reversements. Ils n’ont pas empêché non plus des cas de biopiraterie, c’est-à-dire d’utilisation d’une ressource non seulement sans consentement préalable et sans partage d’avantages, mais aussi en brevetant la ressource, ses gènes ou les informations génétiques qu’elle contient, interdisant de facto son utilisation par les détenteurs d’origine de la ressource (cas par exemple du teff [20], du Quassia [21], etc.).
Le Tirpaa en 2015 puis la CDB en 2016 ont pris acte des divergences sur le statut des séquences numérisées. Ces deux instances ont alors créé des groupes ad-hoc dont la dernière réunion a eu lieu en mars 2020 [22] pour celui de la CDB et qui a abouti a un constat d’échec pour celui du Tirpaa lors de son Organe directeur de 2019 [23]. Les États signataires de la CDB ont aussi apporté leur contribution à ce débat [24]. L’objectif est d’arriver à un accord sur le partage des avantages lors de la COP15 en Chine, repoussée à 2021 pour cause de Covid [25].
L’OMS et le partage du virus de la grippe
Dans son préambule, le protocole de Nagoya tient « compte du Règlement sanitaire international (2005) de l’Organisation mondiale de la santé [OMS] et de l’importance d’assurer l’accès aux pathogènes humains (…) ». Son article 4(4) prévoit donc des exceptions pour le partage des avantages quand « un instrument international spécial sur l’accès et le partage des avantages s’applique » et est conforme aux objectifs du Protocole. C’est le cas pour certains pathogènes, comme le virus de la grippe.
En 2011, l’OMS a adopté un Cadre de préparation en cas de grippe pandémique pour l’échange des virus grippaux et l’accès aux vaccins et autres avantages, cadre connu sous l’acronyme PIP [26] [27].
Un « groupe d’examen » de ce Cadre PIP s’est posé la question du partage des avantages. Le groupe a déploré que « ces données [sur les séquences génétiques [28] ] ne [soient] (…) pas définies en tant que matériel biologique. (…). [Il a donc] veillé à ce que les principes appliqués soient les mêmes que ceux qui régissent le partage de matériel génétique » [29]. En avril 2019, le directeur général de l’OMS a proposé, entre autres, que l’OMS étudie « les mécanismes multilatéraux envisageables pour faciliter l’accès aux agents pathogènes et le partage des avantages (…) en harmonie avec le Protocole de Nagoya » [30]. Un rapport complet doit être fourni lors de la 74e assemblée mondiale de l’OMS, en 2021 [31].
Par ailleurs, l’OMS élabore un Code de conduite pour le partage ouvert et rapide des données sur les séquences génétiques des agents pathogènes [32]. L’OMS souhaite notamment que les données soient rapidement mises en ligne, même si aucun article scientifique n’a encore été publié. Cette mise en ligne s’accompagnerait d’une demande préalable d’autorisation pour utiliser ces données [33].
Il y a donc d’un côté un partage des avantages auprès des populations concernées, par exemple sous forme de vaccins ; et d’un autre côté, un soucis – légitime ? – qu’un chercheur ayant partagé le séquençage génétique d’un pathogène ne soit pas spolié de toute rémunération de son travail [34].
Ces DSI conduisant souvent au dépôt de brevets, on s’attendait à ce que l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) soit vigilante sur le partage des avantages. Certes, elle a bien défini de nouveaux standards pour enregistrer les séquences de nucléotides et d’acides aminés en juillet 2019 [35] où elle oblige à définir de quel organisme vivant proviennent les séquences ; mais elle n’astreint pas, pour le moment, à en mentionner la provenance géographique : le partage des avantages est donc impossible. Cependant, des discussions ont lieu au sein du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’OMPI [36] pour que « les déposants de demandes de brevet (…) [révèlent] la source ou l’origine [des ressources génétiques] et [fournissent] la preuve du consentement préalable en connaissance de cause et du partage des avantages » [37].
Et la France ?
La France a transcrit le protocole de Nagoya en 2016 dans sa loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages [38]. Mais elle vient de se faire épingler par la section environnement du Conseil économique social et environnemental (Cese) pour une quasi non application du dispositif de partage des avantages, et la non promulgation des ordonnances et décrets prévus [39]… et ce, en dehors de toute réflexion sur « l’information de séquençage numérique ». Mauvais présage ?
[1] « Information de séquençage numérique » : Traduction provisoire et non stabilisée du terme anglais Digital sequence information (DSI), voir note 1, p1 du document : CDB/NP/MOP/DEC/2/14*, 16 décembre 2016.
[2] , « La biodiversité : entre open source et États souverains », Inf’OGM, 13 avril 2021
[4] Trois documents clés régissent l’accès et le partage des avantages dans l’Union européenne : le règlement APA de l’UE (511/2014), le règlement d’application de l’UE (2015/1866) et un document d’orientation non contraignant sur le champ d’application et les obligations fondamentales (2016/C 313/01). Mais les décisions relatives à l’accès et au partage des bénéfices, ainsi que leurs dispositions, sont prises par chaque État membre.
[5] Submission by the EU and its Member States to CDB Notification 2017-037 : Views on any potential implications of the use of digital sequence information on genetic resources
[6] Voir p.4 de Information de séquençage numérique sur les ressources génétiques, Guide d’introduction à l’intention des décideurs politiques et des parties prenantes africains, Elizabeth Karger, Pierre du Plessis, Hartmut Meyer, août 2019, 20p.
[7] , « La biodiversité : entre open source et États souverains », Inf’OGM, 13 avril 2021
[8] Citons également la Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture de la FAO, ainsi que le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’OMPI…
[12] listées dans l’annexe 1 du tirpaa. Ces espèces, à elles seules, représentent 80% de la consommation des végétaux cultivés : blé, maïs, riz, pomme de terre, haricot, betterave, choux, carotte, orge, manioc…
[13] Un accord de transfert de matériel (ATM) précise d’où vient le matériel (par exemple la plante), à qui il est transféré, l’usage qui en est prévu et le reversement prévu en cas de commercialisation (voir , « Obtenir d’un clic une variété tropicale », Inf’OGM, 11 avril 2018).
[14] L’ATM est décliné différemment selon les textes : un ATM par ressource utilisée dans le cas du Protocole de Nagoya ; et un accord type de transfert de matériel (ATTM) pour les ressources du Tirpaa.
[16] [En France, c’est l’article L. 412-4 du Code de l’environnement qui régit ce partage, privilégiant a) la préservation de la biodiversité ; b) celle des connaissances traditionnelles ; c) la création d’emplois ; d) La collaboration, la coopération ou la contribution à des activités de recherche, d’éducation, de formation… Le « versement de contributions financières » ne vient qu’en dernière position.
[17] Par exemple, un semencier qui met au point une nouvelle variété à partir d’un échantillon couvert par le Tirpaa, et qui protège cette nouvelle variété avec un certificat d’obtention végétale, peut argumenter que cette nouvelle variété est mise dans le pot commun comme nouveau point de départ pour éventuellement en créer d’autres : c’est sa façon de « partager les avantages »…
[18] À noter que le projet de numériser les ressources génétiques gérées entre autres par le Tirpaa via l’initiative DivSeek, qui cherche à interconnecter les bases de données de séquences numérisées, compromet aussi le partage des avantages, voir : , « DivSeek : chronique d’une biopiraterie légalisée », Inf’OGM, 5 juillet 2017 et , « Le Tirpaa, traité international des semences, en danger », Inf’OGM, 27 novembre 2019
[19] Bilan de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, Allain Bougrain Dubourg et Pascal Férey, 23 septembre 2020, et ,
, « Ressources génétiques : la France ne sait pas (encore) partager », Inf’OGM, 5 novembre 2020
[20] , « Biopiraterie : le brevet sur la farine de teff annulé », Inf’OGM, 4 mai 2020, et voir plus globalement notre dossier sur la biopiraterie : https://www.infogm.org/-dossier-biopiraterie-comment-en-sortir-
[21] , « Biopiraterie en France : l’OEB confirme le brevet de l’IRD », Inf’OGM, 22 février 2018
[22] Voir Report of the ad hoc technical expert group on digital sequence information on genetic resources, Montreal, Canada, 17-20 march 2020
[23] , « Le Tirpaa, traité international des semences, en danger », Inf’OGM, 27 novembre 2019
[25] L’atelier en mai 2020 entre l’UE et la Chine en est un des jalons. Il réaffirme que « l’élaboration d’une solution aux problèmes soulevés par « l’information de séquençage numérique » est un élément important du cadre post-2020 et du succès de la COP15 ».
[26] Pandemic Influenza Preparedness – Préparation à une pandémie de grippe
[28] L’expression “séquences génétiques” désigne l’ordre des nucléotides au sein d’une molécule d’ADN ou d’ARN. Ces séquences contiennent l’information génétique qui détermine les caractéristiques biologiques d’un organisme ou d’un virus (Cadre PIP, section 4.1).
[29] FAO, Commission des ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture, point 4 de l’ordre du jour provisoire, dix-septième session ordinaire, Rome, 18-22 février 2019, « Information de séquençage numérique » concernant les ressources génétiques pour l’alimentation et l’agriculture – pertinence du point de vue de la sécurité alimentaire, p11.
[30] Voir Incidences pour la santé publique de la mise en œuvre du Protocole de Nagoya, A72/32, 18 avril 2019, en p.3.
[31] The public health implications of implementation of the Nagoya Protocol, seventy-second WHA(13), 28 mai 2019
[32] WHO’s code of conduct for open and timely sharing of pathogen genetic sequence data during outbreaks of infectious disease
[33] Ibidem, p.3
[34] Sur les insuffisances du PIP : Rourke Michelle, « Access by Design, benefits if convenient : a closer look at the PIP framework’s standard material agreements ». 2019. The Millbank Quaterly, 97,1 91-112
[35] Standard st.26, Recommended standard for the presentation of nucleotide and amino acid sequence listings using xml (extensible markup language), Version 1.3 Approved by the Committee on WIPO Standards (CWS) at its seventh session on July 5, 2019
[38] ,
, « Biopiraterie : flou sur les règles internationales », Inf’OGM, 20 avril 2017
[39] Bilan de la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, Op. Cit.