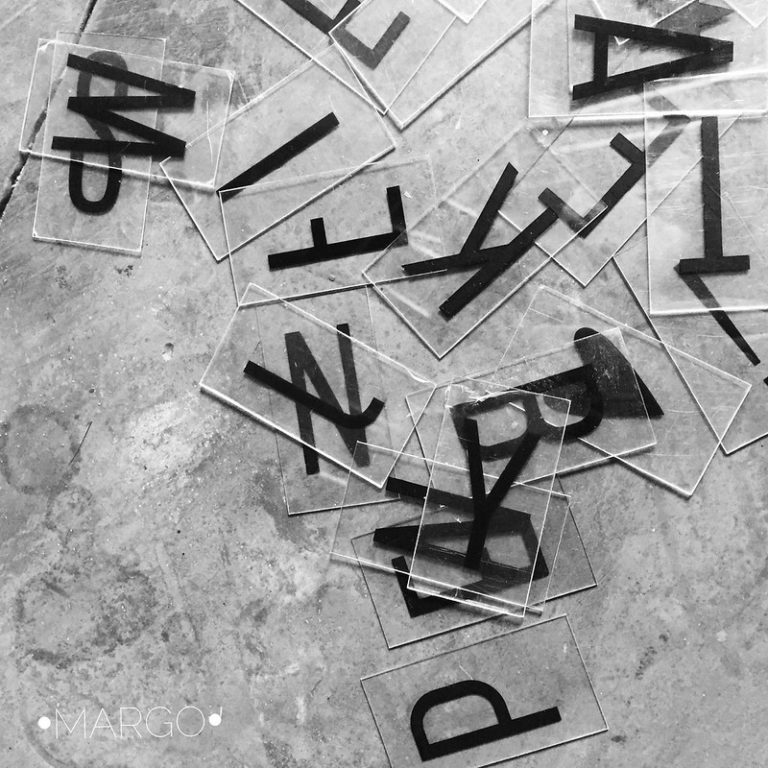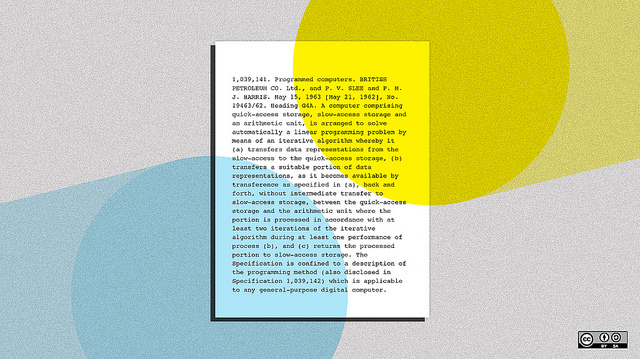Actualités
La propriété industrielle pour lutter contre la biopiraterie ?

Un futur traité destiné à éviter la biopiraterie ? C’est ce que pourrait devenir un document élaboré par un comité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Des points essentiels restent en discussion et certains États sont décidés à ne pas rendre ce futur texte trop contraignant… Plutôt que de rendre compte d’un texte abouti, Inf’OGM prend ici le parti de vous révéler un point d’étape des négociations, afin que chacun puisse se positionner…
Le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle s’est réuni pour sa trente-cinquième session du 16 au 23 mars. Ce comité, créé en 2000, a comme but notamment d’apporter des réponses au débat sur l’articulation entre deux domaines du droit : celui des ressources génétiques et celui de la propriété intellectuelle [1]. En effet, les produits issus des ressources génétiques [2] (médicaments, variétés conventionnelles ou génétiquement modifiés) sont souvent protégés par un droit de propriété industrielle [3].
Or, ces deux domaines du droit poursuivent des logiques différentes. Les principaux objectifs des textes internationaux relatifs au droit de la propriété industrielle sont, de manière générale, d’harmoniser la protection de la propriété industrielle et de faciliter l’obtention de ces titres de propriété [4]. Quant aux règles régissant les ressources génétiques, elles visent à préserver la diversité biologique, à encadrer l’accès à ces ressources et à assurer le partage juste et équitable des avantages résultant de leur utilisation, avec plus ou moins de succès d’ailleurs [5].
Les dénonciations de biopiraterie sont d’ailleurs un indice symptomatique de l’interaction entre ces deux logiques juridiques [6]. Par exemple, des brevets sur des produits créés à partir de ressources génétiques sont parfois délivrés alors que ces produits ne remplissent pas les critères de brevetabilité (pas de nouveauté ou d’activité inventive) [7]. Ou, des brevets sont délivrés sans que les règles d’accès aux ressources génétiques aient été respectées (pas de consentement préalable en connaissance de cause du pays dit « fournisseur » de la ressource) [8].
Des objectifs encore incertains
La session du comité intergouvernemental a permis aux États membres de l’OMPI de débattre des objectifs du futur instrument international et des moyens de les atteindre. Des questions cruciales restent toutefois encore en suspens : le choix entre l’emploi de l’indicatif ou du conditionnel, le caractère contraignant ou non de l’instrument, mais aussi ses objectifs.
Le « document de synthèse concernant la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques » [9], qui sert de base de travail au Comité et qui a été révisé à l’issue de la session de mars dernier, comporte en effet deux propositions alternatives d’objectifs. L’objectif du futur texte est-il de « contribuer à la protection des ressources génétiques et des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques dans le cadre du système de propriété industrielle » ? ; ou de prévenir l’octroi de brevets sur des inventions qui ne respectent pas les critères de la brevetabilité (pas de nouveauté, pas d’activité inventive et pas susceptible d’application industrielle) ?
La seconde proposition est à l’évidence plus étroite que la première. Elle cantonne le champ du futur instrument aux demandes de brevet (excluant les marques) et limite d’emblée le type de mesures qui pourraient être mises en place pour assurer une meilleure articulation entre les règles d’accès et de partage des avantages des ressources génétiques par le droit des brevets [10].
Et justement, les mesures prévues dans le document de synthèse font également l’objet de plusieurs propositions alternatives d’articles. Celles-ci sont le reflet d’autant de désaccords qui restent à régler et qui opposent les pays occidentaux aux pays d’Amérique latine et d’Afrique [11].
Vers une exigence de divulgation a minima ?
Le document de synthèse propose d’abord d’inclure une exigence de divulgation dans le droit des brevets ou le droit de propriété industrielle. Cette exigence de divulgation, à laquelle les pays occidentaux et l’industrie des biotechnologies sont opposés (voir encadré ci-dessous), est présentée comme un moyen de vérifier que les règles concernant l’accès et le partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques ont été respectées.
Le texte prévoit que la divulgation portera sur un certain nombre d’informations concernant la ressource génétique. Mais la teneur précise de l’exigence de divulgation reste encore à définir. Les États doivent encore déterminer si celui qui veut obtenir un titre de propriété industrielle devra divulguer le pays fournisseur de la ressource génétique, ou le pays d’origine et ou/si non connu, la source [12] de la ressource génétique.
Bien plus important encore, le caractère obligatoire ou non de l’exigence de divulgation reste à déterminer. Or, comme nous le confie Leandro Varison, juriste de France Libertés qui était présent à la session, les pays occidentaux (États-Unis, États membres de l’Union européenne, Japon…) veulent éviter qu’un texte trop contraignant voie le jour. Des débats avec les pays d’Amérique latine et d’Afrique sont donc à prévoir…
Quelle qu’en soit l’issue, les pays occidentaux ont déjà obtenu une chose : l’exigence de divulgation ne sera pas absolue. En effet, si le choix est fait de limiter l’objectif de l’instrument à la prévention de l’octroi indu de brevets, la divulgation de l’endroit où la ressource génétique peut être obtenue ne pourra être demandée que si cette indication est nécessaire pour que « l’homme du métier » puisse reproduire « l’invention ». Et des exceptions à l’exigence de divulgation sont aussi prévues si l’objectif plus large était retenu. Quant aux sanctions en cas de non respect de l’exigence de divulgation, une large place est laissée au droit national. Cela laisse présager des disparités importantes dans l’application effective de l’exigence de divulgation d’un État à un autre – le caractère dissuasif d’une sanction étant un moyen de garantir le respect d’une obligation…
L’industrie des biotechnologies réticente à la divulgation
La position de l’industrie des biotechnologies sur l’exigence de divulgation est claire. Dans une observation soumise au Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore en 2008, l’Organisation des industries de biotechnologies (BIO) a exprimé sa réticence à sa mise en place. Selon l’Organisation, « les propositions tendant à instaurer de nouvelles obligations de divulgation ne permettront pas d’atteindre les objectifs recherchés par leurs auteurs mais auront probablement d’importantes conséquences négatives à la fois sur les incitations à innover qu’offre le système des brevets et sur l’obtention d’avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques qui pourraient être partagés ». Pour l’Organisation des industries des biotechnologies, il faudrait avant tout « améliorer la qualité de l’examen des demandes de brevet portant sur des inventions pouvant avoir un lien avec les ressources génétiques ».
Des mesures défensives… légères !
Le document de synthèse prévoit, par ailleurs, une série de mesures dites « défensives » pour, en théorie, éviter que des brevets soient délivrés de manière indue [13]. C’est-à-dire, accordés à l’égard « d’inventions revendiquées qui font appel à des ressources génétiques » quand ces ressources génétiques constituent une antériorité par rapport à l’invention revendiquée (pas de nouveauté) ou quand les ressources génétiques rendent caduque une invention revendiquée (évidence ou absence d’activité inventive).
Pour éviter l’octroi indu de brevets, le document de synthèse prévoit aussi des mesures consistant en l’utilisation de bases de données [14] et de codes de conduite volontaires ou de lignes directrices par les offices de propriété intellectuelle.
Comme pour l’exigence de divulgation, les États doivent encore déterminer si ces mesures seront obligatoires ou facultatives. Néanmoins, même si leur adoption était obligatoire, une marge de manœuvre importante sera laissée aux États dans leur mise en œuvre [15]. Enfin, le texte reste silencieux sur les conséquences à tirer du constat de l’octroi indu d’un brevet : « l’invention » indûment brevetée tombera-t-elle dans le domaine public ? Les peuples autochtones recevront-ils une réparation ? Des questions qui ne recevront que des réponses nationales…
Quelle définition des ressources génétiques ?
Mais l’efficacité du futur instrument dépendra aussi, et surtout, de la définition qu’il donne de l’expression « ressource génétique ». Actuellement, les Parties à la Convention sur la diversité biologique débattent du « statut » des séquences et informations génétiques dématérialisées : sont-elles des ressources génétiques soumises aux règles d’accès et de partage des avantages [16] ? Dans le cadre de l’OMPI, la question est de savoir si le futur texte s’appliquera aussi aux données obtenues par séquençage du génome – même si cette question n’a pas été évoquée lors de la session de son comité intergouvernemental en mars dernier.
Le document de synthèse comporte pour l’instant deux définitions de l’expression « ressource génétique ». L’une reprend celle de la Convention sur la diversité biologique, ce qui pourrait témoigner de la volonté des rédacteurs de suivre également la décision prise ultérieurement dans le cadre de cette convention au sujet du statut des informations et séquences génétiques numérisées. L’autre définition reprend également la définition de la Convention sur la diversité biologique, mais en allant plus loin. Elle y inclut les dérivés des ressources génétiques et l’information génétique de ces dérivés [17].
Le terme « dérivés » pourrait-il couvrir les protéines et les glucides de plantes ? Si oui, doit-on y voir la reconnaissance implicite que de tels éléments peuvent faire l’objet de propriété industrielle ? La réponse n’est pas évidente. Car le texte prend soin de préciser que les ressources génétiques, se trouvant dans la nature ou isolées de celle-ci, ne sont pas des inventions et que, par conséquent, aucun droit de propriété industrielle ne devrait être accordé à leur égard [18]. Un article dont il n’a pas encore été déterminé s’il devait être rédigé au conditionnel ou à l’indicatif…
Le document de synthèse sera transmis à la prochaine session du Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore, qui aura lieu du 25 au 29 juin 2018. Un groupe d’experts ad hoc se réunira en amont de cette session, le 24 juin 2018 pour discuter la question.
[1] Pour certains pays en développement, le droit de la propriété industrielle mine la préservation de la diversité biologique et donc des ressources génétiques. Selon ces pays, les brevets sur des produits créés à partir de ressources génétiques relevant de leur souveraineté nationale – quand ils ne sont pas délivrés de manière indue – rendent ces produits trop chers pour être accessibles à leurs populations. D’autres pays estiment au contraire que le droit de la propriété industrielle pourrait contribuer à prévenir l’appropriation illicite et à promouvoir le partage équitable des avantages.
[2] Selon la Convention sur la diversité biologique, les ressources génétiques constituent le matériel d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de l’hérédité et ayant une valeur effective ou potentielle. Concrètement, il s’agit des plantes médicinales, des cultures agricoles ou des races animales.
[3] La propriété industrielle est un élément d’un ensemble plus vaste qui est la propriété intellectuelle. Le droit de la propriété intellectuelle comprend d’une part les droits de propriété industrielle (marques, brevets, certificats d’obtention végétale, appellations d’origine…) et d’autre part les droits de propriété littéraire et artistique (droits d’auteur et droits voisins du droit d’auteur), voir aussi https://www.infogm.org/faq-les-brevets-sur-le-vivant-et-les-OGM.
[4] Sans être exhaustif, les principaux instruments internationaux relatifs à la propriété industrielle sont les Accords sur les aspects de propriété intellectuelle liés au commerce de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et le Traité de Washington de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), institution spécialisée de l’Organisation des Nations unies.
[5] Le cadre juridique régissant les ressources génétiques est défini par la Convention sur la diversité biologique et son Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable découlant de leur utilisation ainsi que par le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO). Sur ces questions : ,
, « Biopiraterie : une autre colonisation », Inf’OGM, 20 avril 2017 et ,
, « Biopiraterie : flou sur les règles internationales », Inf’OGM, 20 avril 2017
[6] , « Biopiraterie en France : l’OEB confirme le brevet de l’IRD », Inf’OGM, 22 février 2018
[7] Cas par exemple, du brevet étasunien sur une variété d’ayahuasca (Banisteriopsis caapi), une vigne hallucinogène considérée comme sacrée et utilisée dans des rites par de nombreux peuples indigènes dans l’Ouest du bassin amazonien. Contesté, le brevet a été maintenu alors que l’inventeur se serait contenté de collecter la vigne dans une communauté indigène d’Équateur, de la décrire et de soumettre cette description en payant les frais de dossier pour revendiquer la plante comme étant son « invention ». Exemple cité par Edward Hammond, , « Biopiraterie : heureusement, les ONG veillent », Inf’OGM, 20 avril 2017
[8] Sur ce sujet, voir par exemple , « Obtenir d’un clic une variété tropicale », Inf’OGM, 11 avril 2018
[9] OMPI – IGC, The consolidated document relating to Intellectual Property and Genetic Resources REV.2, mars 2018.
[10] La question de l’articulation entre les règles régissant les ressources génétiques et la propriété industrielle ne concerne pas que le brevet mais aussi le certificat d’obtention végétale (COV). S’agissant du COV, la question est traitée au sein de l’Union pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV).
[11] C’est à la demande des États d’Amérique latine et du continent africain que le Comité a été chargé, dès sa création, de mener des travaux afin de parvenir à un instrument juridique international consacré aux questions de propriété intellectuelle relatives aux ressources génétiques.
[12] La définition du terme n’est pas encore décidée dans le document de synthèse adopté à l’issue de la trente-cinquième session du comité de l’OMPI. Selon les options, il peut s’agir de banques de gènes, centres de recherche, le système multilatéral du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture…
[13] À la demande de l’Union européenne, le titre de l’article qui traite de cette question a été modifié. Avant la trente-cinquième session, il s’agissait de prévenir l’octroi de « brevets indus ». À l’issue de la trente-cinquième session, il s’agit de prévenir « l’octroi indu de brevets » – l’idée étant que les brevets ne peuvent pas en eux-mêmes être erronés, seul peut l’être son octroi.
[14] L’utilisation de bases de données conduirait à renforcer encore l’écrit en droit des brevets. Elle pourrait selon certains avoir pour conséquence qu’à terme il sera difficile de contester un brevet si la ressource génétique n’est pas mentionnée dans une base de données.
[15] En effet, le texte laisse toute liberté aux États pour déterminer la nature des mesures qu’il adopte (juridiques, de politique générale ou administratives). Et ils pourront adopter ces mesures « en tant que de besoin » : ils apprécieront souverainement s’il est nécessaire de prendre de telles mesures, le texte ne les contraignant pas à les prendre.
[16] , « Numériser les gènes pour posséder le vivant sans partage ? », Inf’OGM, 9 avril 2018
[17] Les dérivés sont définis comme « un composé biochimique naturel résultant de l’expression génétique ou du métabolisme de ressources biologiques ou génétiques [même s’il ne contient pas d’unités fonctionnelles de l’hérédité] ».
[18] Voir article 9 du document de synthèse. La rédaction de cet article a été modifiée entre la trente-quatrième et trente-cinquième session de l’IGC. Plus précisément, à l’issue de la trente-cinquième session, la référence aux dérivés des ressources génétiques a disparu.