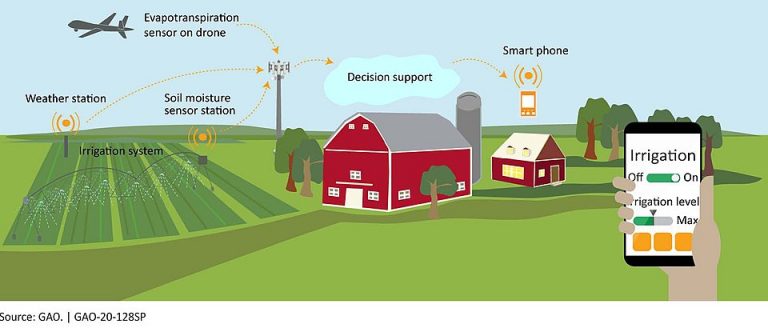Biodiversité cultivée : des champs aux frigos (et vice-versa)

Paysans, jardiniers, chercheurs et sélectionneurs conservent, chacun à leur manière, des semences et parties de plantes susceptibles de se reproduire. Objectif global : disposer de variétés comestibles essentiellement pour nourrir la population [1]. Mais que conserver ? Comment ? Et avec quels acteurs ?
Depuis que l’être humain a observé que la plupart des plantes naissent des graines [2], il les conserve. Les paysans [3] ont mis au point de multiples méthodes de conservation/sélection et ont été pendant des millénaires les premiers et principaux acteurs de la conservation de leurs espèces cultivées.
La production séparée de la reproduction
Mais, essentiellement dans les pays occidentaux à partir du XXe siècle, des paysans se sont spécialisés dans la production de semences, tandis que les autres ont progressivement perdu ce savoir-faire et rachètent maintenant chaque année leurs semences à ces paysans spécialisés créateurs d’entreprises semencières [4]. La naissance de ce nouveau métier de semencier, appuyé par les nouvelles connaissances en biologie de la reproduction et en génétique, a créé un besoin pour les sélectionneurs : celui de disposer de nombreuses variétés paysannes, sources des croisements pour créer de nouvelles variétés.
C’est donc dès le début du XXe siècle, puis de façon accrue après la seconde guerre mondiale, que les premiers conservatoires de plantes ont été créés. Le plus célèbre et plus vieux d’entre eux, l’Institut Vavilov, a même démarré en 1894, pour introduire plus de variété végétale en Russie. Suite à de nombreuses expéditions dans ce que Vavilov appellera plus tard les différents « centres d’origines des espèces », entre les années 20 et 40, l’Institut possède encore aujourd’hui 325 000 « accessions », c’est-à-dire des semences paysannes (soit autour de 5 % des variétés rustiques stockées dans le monde).
Avec la révolution verte et l’utilisation systématique d’intrants chimiques (pesticides et engrais), les semenciers et la recherche publique agricole (en France, l’Inra) ont mis au point un nombre limité de nouvelles variétés homogènes à fort rendement [5] qui ont éclipsé progressivement les milliers de variétés-populations (hétérogènes) utilisées par les paysans. Résultat : une érosion massive de la biodiversité cultivée.
Robert Ali Brac de la Perrière [6], phytogénéticien et aujourd’hui conseiller en gestion des ressources végétales, engagé avec les mouvements paysans, détaille les différents verrous qui restreignent la biodiversité cultivée : « en plus du catalogue et des droits de propriété industrielle, la valorisation commerciale d’une variété élite aux dépens du reste de la biodiversité est aussi un problème : le marché favorise des standards. Dans des communautés isolées, il existe plein de variétés au service de différents usages. Mais dans un marché plus global (national par exemple), les productions sont plus éloignées des marchés, et elles concernent alors des cultures de rentes, d’où la perte des connaissances liées aux cultures traditionnelles. La disparition des espèces cultivées vient aussi de la promotion faite sur les hybrides F1 [7], qui a conduit à l’abandon de la production des semences paysannes. Les gens sont happés à produire pour le marché ».
Paradoxe : les sélectionneurs ont besoin des variétés paysannes, qu’ils voient comme des « réservoirs génétiques », pour créer leurs nouvelles variétés. Mais les lois qu’ils mettent en place font disparaître ces variétés rustiques. Ils ont donc lancé en hâte, dans les années 60, de vastes programmes de collecte de variétés paysannes. Ces dernières ont été stockées dans différentes banques de « ressources génétiques », dont les banques des centres du Groupe consultatif pour la recherche agricole (CGIAR, voir encadré ci-dessous), créées pour la plupart dans les années 60 et 70. Ces banques renferment une partie de la diversité génétique des principales espèces cultivées à la fin du siècle dernier, dites majeures pour l’agriculture et l’alimentation dans les différentes régions du monde.
Le CGIAR : organisation neutre ou groupe d’intérêt ?
Selon son site Internet, le Groupe consultatif pour la recherche agricole internationale (GCRAI/CGIAR en anglais), créé en 1971, se présente comme « un partenariat global de recherche pour assurer la sécurité alimentaire pour le futur afin de réduire la pauvreté, améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et améliorer les ressources naturelles ».
Il comprend 64 membres, de poids très inégal, organisations internationales, Fondations (Rockfeller, Gates), gouvernements et organisations non-gouvernementales (ONG) et soutient actuellement quinze centres de recherches internationaux, dont douze avec des centres de « ressources biologiques ».
Dans son livre Semences paysannes, plantes de demain [8], Robert Ali Brac de la Perrière qualifie le CGIAR de « groupe d’intérêt, dont le haut niveau d’expertise influe de manière pesante sur la politique de la FAO ». De 1972 à 2016, c’est la Banque mondiale le principal bailleur (1263 millions de dollars), et, avec 562 millions, la Fondation Gates arrive en 6e position. Mais pour la seule année 2016 (derniers chiffres connus), la Fondation Gates est largement en tête avec 96 millions de dollars, devant l’Allemagne (27 millions) et la banque africaine de développement (22 millions) [9]. On comprend mieux dès lors la réorientation du CGIAR vers une « concentration accrue sur les programmes de sélection, sur les outils et méthodes biotechnologiques, notamment la génomique, la protéomique, la sélection assistée par marqueurs moléculaires et d’autres » [10].
Qui conserve quoi et comment ?
Résultat des campagnes massives de collecte, notamment depuis les années 60 : plus de 7,4 millions d’échantillons de variétés cultivées (dont 20 à 30 % seulement sont distinctes, le reste étant des doublons) sont stockés dans 1750 banques de « ressources génétiques », publiques et privées [11].
Cette conservation dans des chambres froides fait partie avec les vergers conservatoires de ce qu’on appelle la « conservation ex situ », c’est-à-dire en dehors des champs des paysans. « Chaque année, ces banques de gènes distribuent 120 000 échantillons à des chercheurs, sélectionneurs, ONG, paysans dans plus de 100 pays » annonce fièrement la plateforme Internet de ces banques, Genebank [12] [13].
À noter qu’en 2008, une « ultime copie de sauvegarde » de ces différentes banques a été créée à Svalbard [14] (Nord de la Norvège) : financée principalement par l’État norvégien, ainsi que par un fond mondial dédié à la conservation ex situ de la diversité des plantes, le Global Crop Diversity Trust (encore appelé CropTrust) [15], elle recèle aujourd’hui plus d’un million d’échantillons de graines, pour une capacité totale de 4,5 millions. Chaque « banque de gènes » reste seule propriétaire des échantillons qu’elle a déposés.
Mais il existe aussi d’autres formes de conservation : in situ, à la ferme, in vitro, et dernièrement in silico (voir encadré ci-dessous). D’ailleurs, toutes les plantes ne peuvent être conservées ex situ, comme le rappellent les deux chercheurs S. Louafi (Cirad) et A. Charrier (SupAgro) : « les nombreuses espèces à semences « récalcitrantes ou intermédiaires » (arbres fruitiers et forestiers, espèces cultivées à reproduction végétative) sont conservées en plantes entières (champ, serre, jardin botanique, arboretum), sauf quelques collections conservées in vitro ou par cryogénie » [16].
Conserver pour privatiser ou pour reproduire gratuitement ?
Conserver une semence pour développer [17] une variété ou en créer une autre : en fait, ce concept est propre aux semenciers professionnels. « La recherche conserve, évalue, détecte des caractères et crée des variétés biofortifiées [18] et hybrides (comme le sorgho) donc non reproductibles », rappelle Robert Ali Brac de la Perrière. Qui poursuit : « Le paysan coévolue, lui et sa société, avec ses plantes cultivées, au sein d’un système agricole (non réductible aux seules ressources génétiques) ». Du coup, « l’expression « conservation des ressources génétiques » irrite souvent les paysans qui ne conservent pas mais sont dans une gestion dynamique de populations ».
Traduction concrète : pour le semencier, mettre un échantillon de semences dans un frigo, ce qui stoppe sa coévolution avec son environnement et les paysans, est logique et nécessaire pour en conserver ses gènes. Seule précaution : les régénérer régulièrement (en gros tous les dix ans) afin de ne pas perdre leur pouvoir de germination. Mais pour le paysan, c’est une hérésie, car l’arrêt de cette coévolution bloque le pouvoir adaptatif de la variété, qui s’effectue, entre autres, par des échanges incessants de gènes avec les espèces interfertiles [19]. Didier Bazile, chercheur au Cirad, relate que les paysans andins dénombrent pas moins de sept principales espèces sauvages apparentées au quinoa, avec lequel ils tentent de « sélectionner parmi les croisements naturels, disent-ils, ceux qui peuvent redonner de la force aux cultures ». Par ailleurs, ces plantes sauvages peuvent aussi être consommées en cas de mauvaises récoltes…
Conscients de l’importance de l’environnement naturel de la plante, les chercheurs ont récemment étendu le champ de leurs collectes aux « espèces sauvages apparentées à des espèces cultivées et des végétaux sauvages constituant une source d’aliments » [20]. Bel effort, mais qui là encore réclame de nombreuses infrastructures, coûteuses, fragiles (car elles dépendent de moyens souvent absents dans les pays du Sud, notamment d’alimentation électrique), et souvent éloignées des paysans. Les pratiques paysannes sont à l’opposé de l’ex situ, même si certains paysans ne s’interdisent pas de puiser dans ces réserves, quand ils le peuvent, pour retrouver des variétés anciennes.
Cela a été le cas en France de Jean-François Berthelot, un paysan-boulanger, cofondateur du réseau semences paysannes, qui est allé chercher une trentaine de variétés anciennes de blé à l’Inra de Clermont-Ferrand, et qui aujourd’hui conserve, à la ferme, plusieurs centaines de variétés, anciennes ou de pays, de blé. Mais ces pratiques constituent plutôt des exceptions, les Centres de ressources génétiques publics servant plutôt des objectifs de recherche et de formation.
Vers des systèmes paysans de conservation ?
Les communautés paysannes, on l’a vu, ne raisonnent pas en terme de « ressources génétiques ». Ces communautés coévoluent avec des centaines de variétés paysannes, le mot « variété » étant pris ici au sens premier du terme, c’est-à-dire avec une grande diversité génétique (et non dans le sens industriel de la variété homogène, distincte et stable des semenciers… c’est-à-dire tout sauf variée). Elles disposent d’un savoir-faire pour chacune de ces variétés qui ont toutes différents usages précis (alimentaires, culturels, religieux…) [21]. L’évolution de ces variétés paysannes se fait d’une part avec les échanges génétiques entre plantes (cultivées et sauvages), ainsi qu’en lien avec le milieu, et d’autre part par l’apport de variétés venues d’échanges avec d’autres communautés paysannes. La conservation des semences est gérée collectivement, dans des endroits spécialement conçus (greniers, cases…).
On assiste aujourd’hui dans les pays du Nord à un renouveau des semences paysannes, avec des systèmes de gestion inspirés des pays du Sud (et parfois même des semences ramenées du Sud, comme ce fut le cas pour la collection de maïs non hybrides de AgroBioPérigord – avec, entre autres, des semences guatémaltèques).

À l’initiative du réseau semences paysannes, des maisons de semences paysannes [22], copiées du modèle brésilien, voient le jour (une vingtaine en France) : elles sont autogérées par les paysans, qui en définissent progressivement des droits d’usage propres à chacune. Robert Ali Brac de la Perrière confie à Inf’OGM : « le système idéal de conservation, ça serait une maison de semences autogérée par territoires, avec une gestion de recherche participative et des relations de paysans à paysans. Mais il faudrait aussi des banques publiques pour maintenir à long terme certains échantillons utiles, le tout dans un cadre de cogestion avec les paysans ».
Différentes types de conservation de « matériel végétal »
1/ ex situ : voir dans l’article ;
2/ in situ : c’est la « conservation des écosystèmes et des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de populations viables d’espèces dans leur milieu naturel et, dans le cas des espèces domestiquées et cultivées, dans le milieu où se sont développés leurs caractères distinctifs » (art. 2 de la Convention de diversité biologique – CDB) [23] ;
3/ « on farm », ou « à la ferme » : c’est la « gestion durable de la diversité génétique des variétés traditionnellement cultivées au niveau local, ainsi que de leurs espèces ou formes sauvages et adventices apparentées, par les agriculteurs dans les systèmes agricoles, horticoles ou agro-forestiers traditionnels » [24] [25] ;
4/ in vitro : il s’agit de la conservation (à court et moyen terme) de parties de plantes (ovules, pollen, cellules…) dans des tubes à essai ou boîtes de Pétri au laboratoire, sous forme d’amas de cellules qui, régénérées, peuvent redonner une plante. « Cependant, (…) son utilisation nécessite une adaptation à chaque nouveau matériel ainsi que des intrants continus, et des questions se posent quant à la stabilité génétique du matériel stocké pour certaines espèces » [26].
5/ in silico : c’est la conservation, dans la silice des puces informatiques, des données transcrites issues du séquençage des gènes.
[1] … ou parfois pour d’autres usages : industriels, pharmaceutiques…
[2] On parlera dans cet article de graines (pour les plantes sauvages), et de semences (pour les plantes cultivées), même si ce récit est valable pour des tubercules, rhizomes, et autres parties variées de plantes qui en permettent leur reproduction.
[3] Cet article n’utilise pas l’écriture inclusive, mais ce terme de « paysan », surtout en matière de semences, évoque aussi les paysannes, principales gardiennes de vie et de biodiversité.
[4] , « Semence : de la sélection paysanne aux entreprises semencières », Inf’OGM, 25 juin 2013
[5] Ce fort rendement reflète essentiellement la capacité de ces variétés à valoriser les intrants (engrais, pesticides…).
[6] Ancien président d’Inf’OGM
[7] ,
, « Hybrides F1 : un outil efficace pour mettre les paysans sous dépendance », Inf’OGM, 22 mai 2012
[8] Voir en p. 69 de « Semences paysannes, plantes de demain », Robert Ali Brac de la Perrière, ECLM, 2014, 226 p.
[10] « Semences paysannes, plantes de demain », op.cit.
[11] Voir Le deuxième rapport sur l’état des ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde – compte rendu synthétique. À noter qu’au début des années 70, on comptait moins de 10 banques de gènes qui ne détenaient guère plus d’un demi-million d’échantillons (source : http://www.fao.org/FOCUS/F/96/06/04-f.htm#gcrai).
[13] Échantillons, ressources génétiques, banques de gènes : dans tous les cas, il s’agit de conserver du matériel végétal comprenant un génome. La plus grande partie des échantillons de graines distribués entre 1995 et 2005 (80%) est allée dans des universités ou des centres des systèmes nationaux de recherche, dans le but de développer de nouvelles variétés (source : La recherche agronomique française pour le développement : enjeux internationaux évaluation des relations entre la recherche agronomique française pour le développement et le groupe consultatif pour la recherche agronomique internationale (GCRAI), février 2005.
[14] , « Svalbard : pour l’humanité ou pour les semenciers ? », Inf’OGM, 14 décembre 2016
[15] , « DivSeek : chronique d’une biopiraterie légalisée », Inf’OGM, 5 juillet 2017
[16] Les ressources génétiques utilisées par l’agriculture constituent-elles un bien public ? Louafi S., Charrier A., Innovations Agronomiques 29 (2013), 113-123.
[17] Dans le langage des « améliorateurs des plantes », « développer » veut dire homogénéiser et stabiliser les caractères d’une population hétérogène pour en faire un ensemble végétal correspondant à la définition de la variété commerciale.
[18] , « Biofortification : une définition pleine d’enjeux », Inf’OGM, 11 juillet 2020
[19] , « Comment enrayer l’érosion de la biodiversité cultivée ? », Inf’OGM, 21 octobre 2016
[20] Voir Directives d’application volontaire pour la conservation et l’utilisation durable des plantes sauvages apparentées à des espèces cultivées et des végétaux sauvages constituant une source d’aliments, 2017, FAO.
[21] Voir notamment Carine Pionetti, Semences et savoirs en Inde, Éditions cultures croisées, 1998.
[22] Les maisons de semences paysannes, RSP, 2014.
[24] Hunter D., Heywood V. (eds.). 2011. Espèces sauvages apparentées à des plantes cultivées. Manuel de conservation in situ. Bioversity International, Rome, Italie.
[25] À noter que si la conservation in situ dépend souvent des ministères de l’environnement, celle « à la ferme » dépend en général des ministères de l’agriculture. Depuis 2012, l’organisation pour l’alimentation et l’agriculture des Nations unies (FAO) a réuni ces deux réseaux pour qu’ils travaillent ensemble (communication de D. Bazile, chercheur au Cirad).
[26] Il s’agit ici de vitro-plants et non de multiplications cellulaires in vitro : « Les techniques de stockage in vitro en croissance ralentie sont utilisées en routine pour la conservation à moyen terme de nombreuses espèces, à la fois d’origine tropicale et tempérée, comme la pomme de terre, les Musa, l’igname et le manioc. En 1996, la FAO recensait environ 38 000 accessions conservées in vitro en vie ralentie (FAO, 1996). ». (source : Conservation des ressources génétiques du palmier dattier, Florent Engelmann). Voir aussi : Reed B.M., Engelmann F., Dulloo M.E., Engels J.M.M., 2004 – Technical Guidelines for the Management of Field and In Vitro Germplasm Collections. Handbook for Genebanks N° 7. Rome, IPGRI/SGRP.