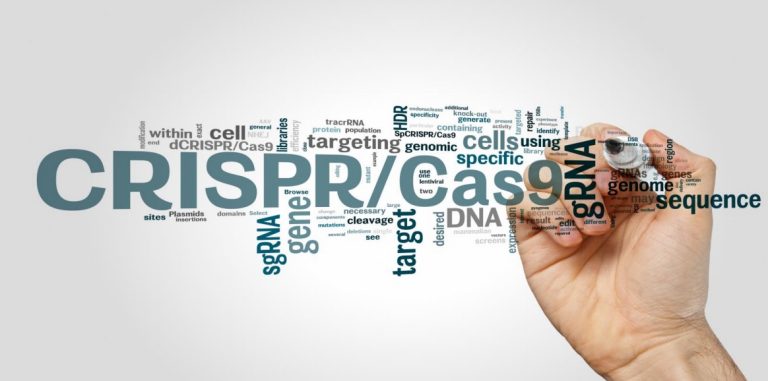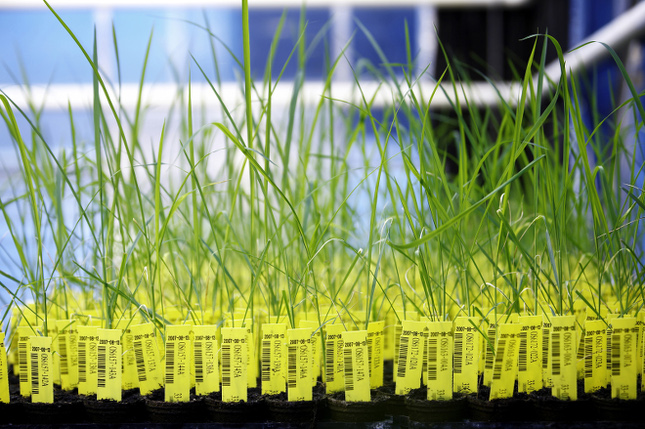Etats-Unis et OGM : les problèmes s’accumulent
Après l’Inde (Inf’OGM le journal n°107) et la Roumanie (n°108), Inf’OGM poursuit son tour du monde en s’arrêtant aux Etats-Unis, berceau des plantes génétiquement modifiées (PGM). Après 15 ans de cultures de PGM, les problèmes s’accumulent : condamnation de l’administration pour avoir mal évalué les risques, plaintes d’agriculteurs au Congrès pour des adventices envahissantes, guerre commerciale entre entreprises… Le tout dans un pays où les consommateurs ne peuvent savoir s’ils consomment des PGM mais où la société civile s’impose de plus en plus dans le débat.
La production agricole étasunienne concerne 3,3% de la population active (en 2009), soit 5,4 millions d’agriculteurs (contre 4,7% en France pour un million d’actifs). Mais le secteur agroalimentaire représente 20% de la balance totale des exportations avec un quart de la production annuelle exportée, notamment vers l’Union européenne et le Japon. Les Etats-Unis disposent d’une surface agricole utile (SAU) de 370 millions d’hectares, soit 1,2 ha de SAU par hab. (contre 0,45 ha de SAU/hab en France [1]). Cet espace est réparti aujourd’hui sur un peu plus de deux millions de fermes [2], dont la surface moyenne est d’environ 200 hectares (contre 35 ha en France). Mais cette moyenne est peu significative, puisque 125 000 exploitations (soit 6% du total des fermes) réalisent 75% du chiffre d’affaires de l’agriculture et que les 449 plus grosses ont une surface moyenne de 2 316 hectares.
Une agriculture très industrialisées et fortement soutenue par l’Etat
Enfin, l’agriculture étasunienne se caractérise par une forte mécanisation : elle utilise la moitié des tracteurs du monde et les pesticides sont répandus par avion. Cette mécanisation sert une forte utilisation d’intrants avec engrais et pesticides. Les PGM sont donc particulièrement « pertinentes » dans un tel contexte (grandes surfaces, forte mécanisation…), notamment celles tolérant des herbicides totaux (RoundUp, Liberty, etc.). Au final, les grandes exploitations pratiquent une agriculture monolithique bien adaptée aux soja, maïs ou coton GM. De plus, elles reçoivent de fortes subventions (cf. encadré ci-dessous).
Des PGM omniprésentes pour trois cultures
Pour 2011 , il y a 346 dossiers d’essais en champs, portés par 45 entreprises et structures [5]. Monsanto est concernée par plus de la moitié de ces dossiers (180) [6]. Si le secteur public est présent dans le développement des PGM, ce dernier est surtout le fait de structures privées qui totalisent 90% des dossiers de 2011 (78% de structures privées en Europe pour les dossiers déposés en 2011 ). 31 PGM sont testées en champ. Le maïs représente près de 50% des dossiers, le soja 20% et le coton 8% [7]. Sans surprise, ces trois espèces sont également les plus commercialisées (cf. le tableau ci-dessous montrant le pourcentage des surfaces de cultures GM par rapport aux surfaces totales pour chacune de ces plantes). Elles représentent 18% de la SAU (contre 0,06%
dans l’UE). Peu d’entreprises se partagent le marché, et la guerre qu’elles se livrent est à un tel point que Monsanto fait l’objet d’une enquête pour un possible abus de position dominante (cf. encadré page 7).
Quasiment la totalité des maïs, coton et soja sont donc aujourd’hui transgéniques, avec une adoption rapide des plantes à plusieurs caractères.
| Plante | Type | 2000 | 2010 |
| Maïs | Tolérance herbicide | 6% | 23% |
| Résistance insecte | 18% | 16% | |
| Empilement | 1% | 47% | |
| Total | 25% | 86% |
| Coton | Tolérance herbicide | 26% | 20% |
| Résistance insecte | 15% | 15% | |
| Empilement | 20% | 58% | |
| Total | 61% | 93% |
| Soja | Tolérance herbicide | 54% | 93% |
Source : http://www.data.gov/raw/4708
Une législation obsolète et lacunaire
Selon le site gouvernemental sur les biotechnologies [8], « les États-Unis utilisent des lois sur la santé et la sécurité rédigées avant l’avènement de la biotechnologie moderne pour évaluer les produits génétiquement modifiés ». C’est donc sur la base de textes non spécifiques aux PGM que repose leur encadrement [9].
Le Food, Drug and Cosmetic Act et son texte d’application de 1992 régissent la présence d’OGM dans l’alimentation [10]. Ce texte pose le concept d’équivalence en substance comme base de travail. Une fois démontré que la PGM n’est pas différente en substance de plantes déjà commercialisées, aucune évaluation supplémentaire n’est requise. Néanmoins, d’autres analyses peuvent être fournies par des entreprises comme des analyses nutritionnelles sur poulet [11]. Mais cette évaluation des risques sanitaires liés aux PGM par la FDA est une démarche volontaire des entreprises. Toutefois, à ce jour, toutes les PGM commercialisées pour l’alimentation sont passées par la FDA, l’intérêt des entreprises étant de se voir dédouanées de toute responsabilité en cas de dommages. Bien sûr, l’évaluation des risques sanitaires n’est pas exempte de critiques. Outre le reproche d’une évaluation trop succincte car sans analyse de toxicologie de la plante entière par exemple, l’autorisation en 1994 de la tomate Flavr/Savr a montré que la FDA pouvait aller à l’encontre de l’avis de ses experts [12].
Pour l’évaluation des risques environnementaux, deux autres agences interviennent : le ministère de l’agriculture (USDA) pour la culture de PGM et l’Agence de protection de l’Environnement (EPA) pour l’alimentation et la culture des PGM produisant un
pesticide [13]. Les lois générales utilisées sont la Plant Protection Act (règlement sur la protection des plantes) et le Federal Insecticides Fungicide and Rodenticide Act (règlement fédéral sur les insecticides, les fongicides et les rodenticides). Ainsi, pour cette évaluation, les pétitionnaires doivent fournir nombre d’éléments qui pourraient la rapprocher de celle conduite en Europe. Mais en pratique, les évaluations de risques environnementaux sont conduites en deux fois, une première évaluation « légère » devant conclure ou non au besoin d’une évaluation plus complète. Cette dichotomie est à la base de plaintes sur les autorisations données à une betterave et deux luzernes GM ayant abouti à la condamnation de l’USDA pour lacune d’évaluation (cf. article page 3).
Pour ce qui est de l’information du consommateur, aucun étiquetage ni traçabilité ou ségrégation n’existent. Enfin, pour la culture, si l’EPA impose des zones refuge et distances d’isolation, ces mesures ne sont pas respectées alors même qu’elles ne concernent que les PGM produisant un insecticide. En l’absence de règles de coexistence malgré le précédent scandale du maïs Starlink [14], certaines structures, comme le National Organic Program ou encore l’Association of Official Seed Certifying Agencies, se sont organisées pour parvenir à exclure les PGM de leurs filières et d’autres, à l’instar du Non GMO project, ont initié une surveillance en matière de contamination pour protéger des filières sans OGM [15].
La société civile : peu informée, elle souhaite a minima un étiquetage
Dans un pays où la prise de conscience du dossier OGM ne semble pas totalement acquise, le premier sujet de mobilisation porte, comme en Europe, sur l’étiquetage. Car les citoyens étasuniens souhaitent cet étiquetage comme le montre un récent sondage (certes en ligne) de MSNBC Poll auprès de 40 000 personnes avec 96% en faveur de l’étiquetage [16]. Cette bataille mobilise associations de consommateurs, de défense de l’environnement et des parlementaires. Des campagnes sur d’autres sujets sont menées, contre l’autorisation de luzernes ou betteraves GM par exemple. Le Center for Food Safety est un des acteurs majeurs de l’opposition aux OGM. Il mène des actions en justice contre des autorisations commerciales avec, à la clef, des victoires non négligeables (cf. article page 3). Une forte opposition, notamment avec des cyber-pétitions, s’est aussi focalisée contre les eucalyptus et saumons GM via la mise en avant d’arguments écologiques. De façon plus marginales, quelques actions de désobéissance civile, de structures parfois clandestines, ont eu lieu depuis douze ans : blocage d’entrepôts [17], destructions de melons GM à l’Université de Californie, de colza, de maïs transgénique et de serres [18] contenant entre autre du riz, du tabac, des tomates… Le National Family Farm Coalition, syndicat qui défend l’agriculture « familiale » sur de petites surfaces, a participé à plusieurs actions, notamment judiciaires, contre Monsanto et les PGM. Enfin, avec un fort impact médiatique du fait des réactions hostiles qu’elles ont engendrées, près d’une centaine de municipalités et comtés ont adopté des mesures réglementaires interdisant les OGM sur leur territoire ou incitant les agriculteurs à ne pas en cultiver [19].
Pertes économiques et résistances d’adventices aux herbicides
L’apparition de plantes tolérant les herbicides est sans doute l’un des problèmes environnementaux majeurs posés par les PGM aux Etats-Unis. Données scientifiques et témoignages d’agriculteurs s’accumulent jusqu’au Congrès des Etats-Unis. Dernière en date, l’étude scientifique de C. Sagers, de l’Université d’Arkansas, révèle que 80% des plantes de colza sauvages prélevées contenaient au moins un transgène de résistance à un herbicide et deux plants contenaient deux transgènes (tolérance au RoundUp de Monsanto et au Liberty de Bayer). Preuve que des PGM apparaissent maintenant dans la nature par croisement. Pour C. Sagers, « l’ampleur de la dissémination est sans précédent. […] Les protocoles de réglementation […] sont inefficaces. La traçabilité et la gestion actuelles des OGM sont insuffisantes » [20]. Ce constat recoupe celui porté par des agriculteurs en 2010 auprès du
Congrès des Etats-Unis. Le vice-président de l’association nationale des maïsiculteurs a expliqué que les herbes résistantes au glyphosate, apparues dans ses champs dès 2005, l’ont contraint à utiliser de plus en plus de RoundUp sur les conseils de Monsanto, avant d’utiliser un autre herbicide puis un cocktail d’herbicides, sans résoudre le problème. Dans les Etats du Michigan, de Géorgie et d’Arkansas, les agriculteurs ont fait face à une amarante résistante au glyphosate [21]. Pour toute réponse, Monsanto a mis en place en 2010 un rabais pour les agriculteurs confrontés aux herbes devenues résistantes au RoundUp [22].
A ces surcoûts de production, s’ajoutent les pertes de marché. En 2006, la contamination de la production de riz non GM aux Etats-Unis par du riz GM tolérant l’herbicide LibertyLink de l’entreprise Bayer a provoqué un arrêt des exportations vers l’étranger, notamment au Japon et dans l’UE. Conséquence directe pour les producteurs : une perte de 831 millions d’euros selon Greenpeace (2007). David Coja de la Fédération étasunienne du riz, avait, lui, estimé qu’ « il est impossible d’évaluer le coût [de cette contamination]. C’est certainement l’événement le plus marquant de l’histoire de la filière riz aux Etats-Unis » [23] [24]. Depuis, Bayer fait face à plusieurs plaintes déposées par des riziculteurs étasuniens, qui totalisent déjà, après quelques procès, près de 200 millions d’euros d’amende (cf. nos articles précédents) [25]
Le développement accéléré des OGM aux Etats-Unis place donc les agriculteurs dans des situations assez contrastées, comme on vient de le voir. Le gouvernement ne semble cependant pas vouloir adopter une politique différente, et continue d’appuyer les autorisations commerciales de PGM (cf. en page 3). Mais les consommateurs pourraient bien changer la donne. Car la demande en produits issus de l’agriculture biologique est croissante. Ainsi, en 2009, « malgré l’état dépressif de l’économie, les ventes de produits bio ont continué d’augmenter […] de 5,3%, pour atteindre 26,6 milliards de dollars » [26]. Mais n’est-ce pas trop tard ? Car la multiplication des cultures GM, engendrant inévitablement des contaminations, pourrait bien remettre en cause le développement même de l’agriculture biologique…
[1] A titre de comparaison, la SAU en France représente environ 29 millions d’hectares (54 % du territoire national). Elle se répartit en terres arables pour 62 %, en surfaces toujours en herbe pour 34 % et en cultures pérennes pour 4 %
[2] Les chiffres de ce paragraphe sont tirés en partie de APCA, FOCUS Économie, L’agriculture en chiffres Mai 2009, http://paris.apca.chambagri.fr/apca/data/focus/090515.pdf
[6] Arborgen : 8 essais, BASF : 5, Bayer : 14, Dow AgroSciences : 8, Forage Genetics International : 12, Monsanto : 180, Pioneer : 21, Syngenta : 31, Universités : 30 et USDA : 5. Ont également des dossiers : American Crystal Sugar Company, Applied Biotechnology Institute, Arcadia Biosciences, Betaseed, Betaseed Inc, BHN Research, CBI, Cold Spring Harbor Laboratory, Forster & Associates Consulting LLC, J R Simplot Company, Max Planck Institute for Chemical Ecology, Montana State University, MS Technologies LLC, SemBioSys Genetics, Ses Vanderhave Usa, Stine Seed Farm Inc, Texas AgriLife Research.
[7] alfalfa : 11 essais, maïs : 160, coton : 27, Pomme de Terre : 6, riz : 2, soja : 71, betterave : 12, cannes à sucre : 12, blés : 2. Et aussi le châtaigner, l’orme, la pomme, l’orge, la morelle noire, le tabac coyote, le lis de Pâques, le peuplier siouxland, l’eucalyptus, le pamplemousse, le peuplier et le peuplier hybride, le pin rigide, le canola, la noisette, le colza, le carthame, le sorgho et le copalme d’Amérique (Liquidambar).
[8] Site commun entre le ministère de l’Agriculture, l’Agence de protection de l’Environnement et l’Agence des Aliments et médicaments : http://usbiotechreg.epa.gov
[10] Loi sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques et le « Statement of policy foods derived from new plant varieties » 29 mai 1992
[11] Voir le dossier du maïs Mir162 de Syngenta
[12] , « OGM aux Etats-Unis : quand l’administration ignore ses experts », Inf’OGM, mars 2004
[13] , « ETATS-UNIS – Les zones refuges largement sous respectées », Inf’OGM, décembre 2009
[14] , « STARLINK – Chronique d’un scandale annoncé », Inf’OGM, mars 2001
[15] Non GMO project, http://www.nongmoproject.org/industry/become-non-gmo-project-verified/
[16] http://health.newsvine.com/_question/2011/02/25/6131050-do-you-believe-genetically-modified-foods-should-be-labeled
[17] , « ETATS-UNIS – Blocage de protestation », Inf’OGM, 19 décembre 2000
[18] , « ETATS-UNIS – Destruction de plantes OGM », Inf’OGM, 1er août 2000
[19] , « ETATS-UNIS – Qui peut définir des zones sans OGM ? », Inf’OGM, septembre 2005
[20] , « Aux Etats-Unis, les résistances aux herbicides se multiplient », Inf’OGM, 21 janvier 2011
[21] , « ETATS-UNIS – Coton GM et mauvaises herbes, ça empire », Inf’OGM, octobre 2008
[22] Monsanto, 19 octobre 2010 et http://blogs.desmoinesregister.com/dmr/index.php/2010/10/19/monsanto-paying-farmers-to-increase-herbicide-use/
[23] , « ETATS-UNIS – Coût de la contamination aux riz LL », Inf’OGM, novembre 2007
[24] Reuters, 5 novembre 2007
[25] , « ETATS-UNIS – Amendes ou arrangements amiables : Bayer n’en finit plus d’indemniser des riziculteurs contaminés », Inf’OGM, 10 février 2011
[26] http://www.organic-world.net/fileadmin/documents/yearbook/2011/world-of-organic-agriculture-2011-page-1-34.pdf
[29] CNN, 6 mai 2010