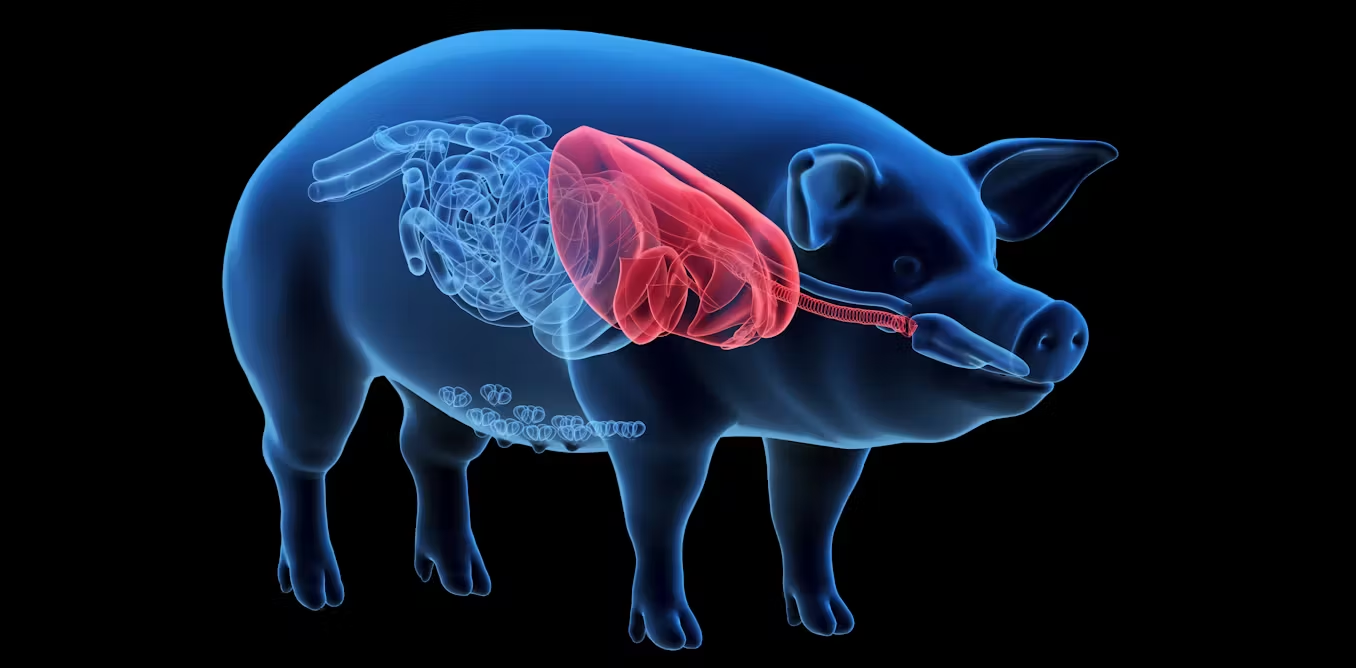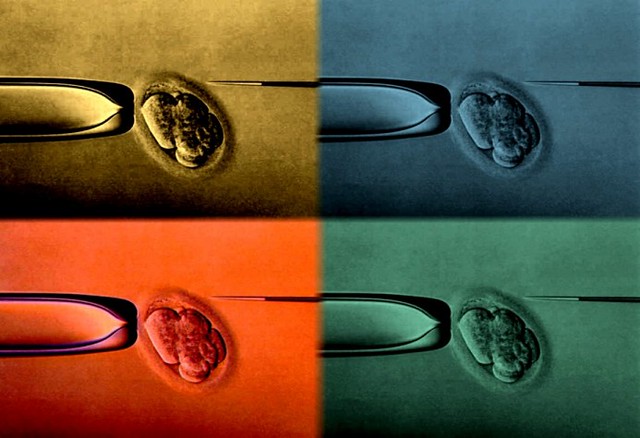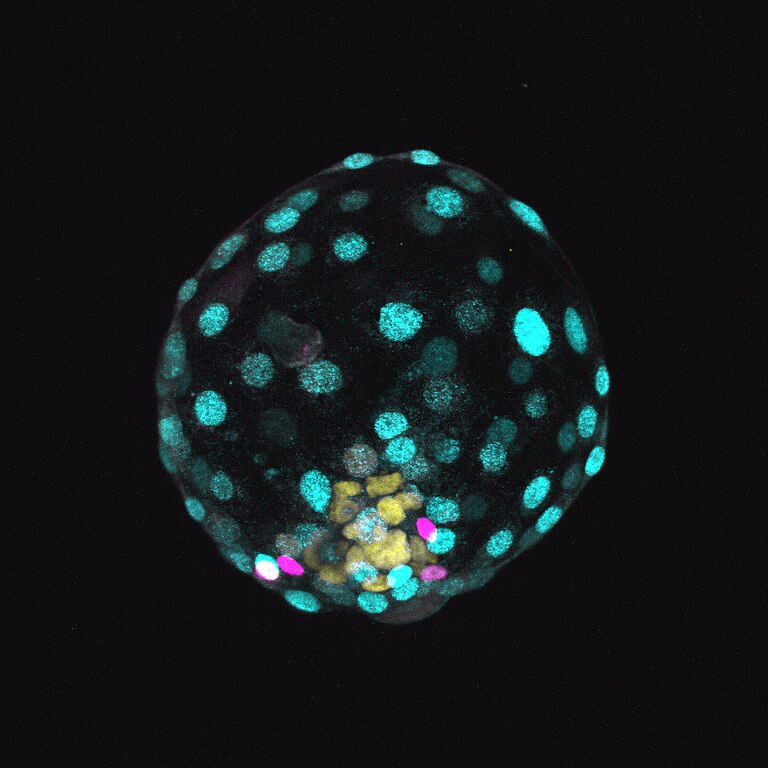Actualités
UE – Le lobby OGM continue de s’implanter dans les instances européennes
Lors d’une conférence de presse, organisée mercredi 29 septembre, José Bové, euro-député Europe Ecologie et vice-président de la commission Agriculture du Parlement européen, a dénoncé un nouveau cas de conflit d’intérêt caché : la présidente du Conseil d’administration de l’Agence Européenne de Sécurité Alimentaire (AESA), Diána Bánáti, nommée à ce poste en juillet 2010, est membre du Conseil des Directeurs de l’International Life Science Institute (ILSI) Europe, le « lobby de l’agrobusiness », selon les mots du député. Or, le député nous informe qu’elle n’a pas mentionné cette fonction dans sa déclaration d’intérêt. Et il précise en effet : « Elle se contente d’indiquer un rôle de conseil scientifique. Lors d’une visite d’une délégation de parlementaires au siège de l’EFSA en avril 2010, Mme Banati a déclaré « qu’au travers de ses activités à l’ILSI, elle n’avait jamais été approchée par des lobbyistes ». Cette affirmation est de nature à tromper le jugement des parlementaires qui l’ont interrogée » [1]. José Bové a demandé sa démission : il a averti la Commission européenne dès le 14 juillet et nous informe qu’à l’heure actuelle, il attend toujours une réponse. José Bové est soutenu dans ce combat par une autre euro-députée, Corinne Lepage (ALDE).
L’influence de l’ILSI est réelle dans le dossier OGM au sein de l’AESA. En effet, dans l’avis rendu par ce comité à propos du maïs MON 89034 x 1507 x NK603 (mis au point par Monsanto et DOW Agrosciences), on peut lire que « la composition du maïs MON 89034 correspond à la variation naturelle telle que reportée dans la littérature et dans la base de données ILSI CropComposition ». Or, parmi les membres de l’ILSI, on retrouve la quasi totalité des très grosses entreprises de l’agro-alimentaires et des OGM, comme Kraft Food, Coca Cola, Kellogg’s, Cargill, Monsanto, BASF, Syngenta ainsi qu’un certain nombre d’universitaires. Telle que décrite sur son site Internet http://www.ilsi.org, ILSI « est une organisation internationale sans but lucratif dont la mission est d’améliorer la santé publique et le bien-être en engageant des scientifiques universitaires, gouvernementaux ou de l’industrie dans une tribune neutre pour faire avancer la compréhension scientifique dans les domaines liés à la nutrition, la sécurité alimentaire, l’évaluation des risques, et de l’environnement ». L’ILSI est aussi accrédité auprès de l’OMS et de la FAO, mais en 2006, l’OMS a publié un communiqué de presse dans lequel elle précise que l’ILSI « ne peut plus jouer un rôle dans l’élaboration des normes sanitaires de l’OMS, car ses membres ont un intérêt financier dans le résultat » [2]. Cette structure est en effet directement au service de ses membres : ainsi, cet institut a cherché à influencer un rapport qui établissait l’influence du sucre sur l’obésité [3]. José Bové rappelle aussi qu’on retrouve aussi son nom associé au débat sur le teflon, mis au point par Dupont : l’ILSI a publié des rapports non consistants prouvant son innocuité. Or, la nocivité du teflon a finalement été reconnue, et suite à une plainte de l’EPA, DuPont a été condamné à payer 16 millions de dollars [4].
Les députés et associations ont déjà, à plusieurs reprises, dénoncé des conflits d’intérêt au sein de l’AESA. Dès 2004, les Amis de la Terre publiaient un rapport intitulé « La prudence jetée aux orties » [5] qui illustrait les nombreuses passerelles entre l’industrie et l’AESA.
Ces conflits d’intérêt éclairent les faiblesses de l’AESA. En effet, la critique de cette agence européenne, au niveau de ses méthodes, n’est plus à faire : le Conseil des ministres de l’Environnement de décembre 2008 a demandé de nombreuses évolutions [6]… Deux ans après, ces évolutions sont toujours en discussions avec les parties prenantes, notamment pour modifier les lignes directrices de l’évaluation des risques liés aux PGM. D’autre part, l’AESA, comme les instances nationales d’évaluation des dossiers de demande d’autorisation des OGM, se contente d’une « lecture » du dossier fourni par les pétitionnaires, agrémentée d’une discussion avec le pétitionnaire et d’une recherche bibliographique. Mais plus fondamentalement, le caractère non scientifique des avis rendus par l’AESA a déjà été démontré. Les membres du Haut Conseil sur les Biotechnologies (HCB) précisaient en effet dans un avis sur le renouvellement du maïs Mon810 que le dossier fourni n’était pas suffisant pour répondre à la question d’existence ou d’absence d’impact sur la santé [7]. Inf’OGM a lancé en avril 2010 une pétition demandant au gouvernement français d’appuyer auprès de la Commission européenne sur la nécessité de reconsidérer toutes les autorisations (y compris celles précédemment données) [8].