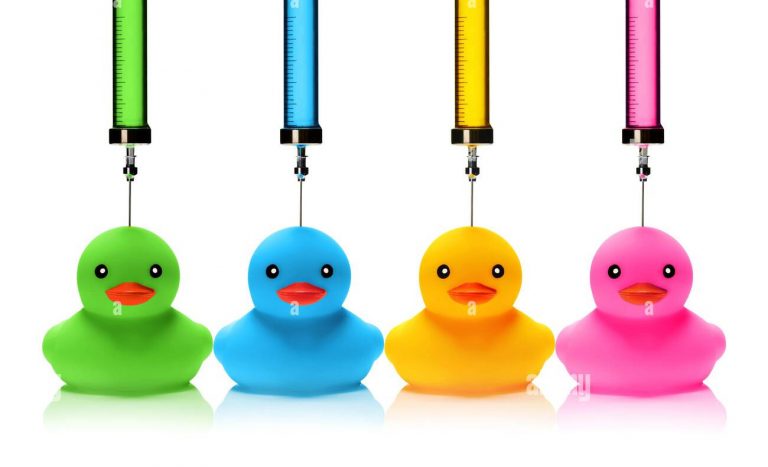OGM : les experts se renvoient la balle
CGC, CGB, AFSSE, AFSSA, AFSSAPS… Mais quels sont ses sigles qui sifflent sur les OGM ? L’expertise et la réglementation liées aux plantes génétiquement modifiées sont relativement floues et complexes et mobilisent des instances diverses, tant au niveau national qu’européen. Ce dossier met en exergue que ce flou existe pour tout un chacun, notamment sur l’articulation des missions de ces instances. Les entretiens menés par la mission parlementaire, dont les annexes de son rapport rendent compte, en sont un témoignage éclatant. Morceaux choisis.
Jean-YVes Le Déaut, Président de la mission parlementaire
À l’initiative du Président de l’Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, une mission parlementaire d’information sur les OGM a été créée en 2004, intitulée : “Les OGM, une technologie à maîtriser”. Son champ, d’abord limité aux “conséquences environnementales et sanitaires des essais d’OGM” fut ultérieurement élargi, à la demande du député J.-Y. Le Déaut, son président, aux “enjeux des essais et de l’utilisation des OGM”. Nous avons sélectionné et classé ici certains témoignages et commentaires de personnes auditionnées par la mission, à partir des presque 800 pages du second tome du rapport élaboré à la suite de la mission.
Rôles et fonctionnement des commissions
À quoi sert la CGG ?
La première phase des essais préalables à l’autorisation de commercialisation d’une plantes génétiquement modifiées (PGM) se déroule en milieu confiné. Ces derniers sont théoriquement supervisés par la Commission du génie génétique (CGG). R. Rosset, son président, rappelle que la CGG doit “évaluer les risques liés aux OGM” et “prévoir les mesures de confinement préventives de ces risques” (p.69). Toutefois, il ajoute “notre dernier domaine d’intervention porte sur les essais au champ” (p.71), une prérogative que l’on croyait être celle d’une autre commission.
Quoi qu’il en soit, si le rôle de la CGG est de prescrire des niveaux de confinement en fonction du risque présumé qui est associé à chaque PGM, il s’arrête à cette prescription. En effet, R. Rosset explique : “Le 11 septembre 2001, j’avais envoyé une note au ministre de la Recherche en lui indiquant que le système de contrôle n’existe pas. Je n’ai jamais reçu de réponse […]” (p.80). En clair, la CGG ne peut pas contrôler la bonne mise en application des mesures préventives qu’elle édicte. Quant à son rôle dans l’expérimentation en milieu confiné, il n’est pas mieux confirmé. Quand R. Rosset déclare que l’ “on nourrit des animaux de toutes tailles pendant de longues périodes avec ces OGM pour observer d’éventuels effets adverses qui influeraient sur la croissance, la fertilité, ou des aspects de ce type” (p.79), nous ignorons si ce « on » désigne des organismes prestataires de la CGG ou d’autres intervenants, comme les industriels promoteurs des PGM par exemple. De même, à une question sur la réalisation de tests visant à déceler une toxicité éventuelle des PGM pour la descendance, la réponse fut : “Ces essais ont été réalisés […] rien n’a été trouvé […]” (p.80). Ce qui est pour le moins ambigu : les essais furent réalisés par qui ? Sur quels animaux ? Avec quels protocoles ? Les familiers du dossier PGM ne disposent pas d’informations objectives et crédibles en ce sens. Rappelons ainsi à ce propos qu’à l’occasion du débat de 2002, les “quatre sages”, avaient souhaité dresser un bilan de l’action de la CGG. Malgré plusieurs relances et la caution d’un mandat interministériel, il ne leur fut pas possible d’obtenir des informations claires sur le type de recherches menées, les protocoles mis en œuvre et les résultats obtenus.
Après la CGG, vient la CGB
Les essais des PGM avant commercialisation mobilisent une deuxième structure d’expertise, la Commission du Génie Biomoléculaire (CGB), qui conseille le ministre de l’Agriculture sur l’opportunité de sortir la PGM du laboratoire. M. Fellous, son président, indique que “le milieu confiné permet d’étudier si la protéine produite par la plante est toxique ou non sur des souris ou des rats […]” et rappelle que R. Rosset (lequel n’a donné aucune information sur les travaux réalisés) “est responsable de la partie OGM en milieu confiné” (p.84). On retiendra donc que, selon les responsables de la CGB, toute PGM testée au champ a fait l’objet de tests d’innocuité préalables… dont nul ne dit comment et par qui ils furent réalisés. L’affirmation sécurisante de la CGB est d’autant plus relativisée quand D. Marzin, président de la Commission des toxiques (cf. plus loin), affirme que les PGM ne donnent lieu “à aucune véritable étude toxicologique” (p.301).
Concernant les responsabilités de la CGB, A. Messéan, son vice-président, souligne qu’elle “ne se prononce pas sur la pertinence d’un essai [en plein champ] mais seulement sur le risque pour l’environnement” (p.54). Et il ajoute : “Nous ne sommes pas gestionnaires du risque”, puisque, selon lui, c’est le ministre de l’Agriculture qui suit les essais au champ… (p.89) (cf. encadré ci-contre). Selon G.-É. Séralini, membre de la CGB, cette commission n’a “jamais analysé de dosages réalisés sur des OGM expérimentaux par le secteur public” (p.703). Ce à quoi G. Pascal, expert européen, répond que “ce n’est pas la CGB qui effectue les tests”… dans la mesure où aucun laboratoire français, explique-t-il, n’est agrémenté auprès des structures internationales (OMC, OMS, OCDE) pour effectuer de telles mesures (p.513). Le joli bateau de l’expertise tangue de plus en plus !
À ce moment, on est en droit de s’interroger sur la réalité de l’évaluation des PGM, tant en milieu confiné (carences de la CGG) qu’en milieu ouvert (carences de la CGB). Tout laisse à croire que ces deux commissions d’experts ne réalisent que des évaluations théoriques, à partir des informations que fourniraient les demandeurs d’autorisations, autrement dit les industriels ayant développé les PGM soumises à évaluation.
Par chance, il y a l’AFSSE
Le Président J.-Y. Le Déaut mentionne avoir invité l’Agence française de sécurité sanitaire environnementale (AFSSE). Il explique : “[…] Il nous a été répondu qu’elle n’avait pas conduit de sujet sur cette question, ce qui peut paraître étonnant […]” (p.142). Pas pour le ministre de l’Environnement de l’époque, S. Le Peletier, qui précise : “L’AFSSE est compétente pour ce qui touche aux conséquences sur la santé et non sur l’environnement” (p.749).
Voilà pourquoi on ne dispose en réalité d’aucune véritable évaluation de l’innocuité des PGM, tant pour la santé que pour l’environnement, avant la phase de commercialisation.
Rassurons-nous, on a la Commission des toxiques
“La commission des toxiques n’a pas connaissance des dossiers concernant les OGM : cela ne fait pas partie de ses missions” (p.298), indique D. Marzin, son président. Ce que confirme J.-Y. Le Déaut : “La commission des toxiques ne s’occupe que des produits phytosanitaires, elle ne s’occupe pas des OGM” (p.320). Il ajoute que les expérimentations autour des PGM “n’exigent pas d’étude de toxicologie”. Voilà donc pourquoi on fait fausse route en cherchant qui pourrait mener de telles études. Le ministre délégué à la Recherche, F. d’Aubert, surenchérit et élargit l’évidence précédente aux produits dérivés d’OGM : “Il n’y a pas de raison particulière de soumettre [les OGM] […] à un passage devant des commissions chargées d’évaluer la toxicité […] On ne peut pas passer tous les produits d’OGM au crible d’une analyse de toxicité identique à celle conduite pour un médicament” (p.678). Une thèse pourtant contredite par P. Kourilsky, qui affirme que “nous avons pour les OGM des exigences que nous n’avons même pas pour les médicaments” (p.233)… Si le patron de l’Institut Pasteur dit vrai, il y a de bonnes raisons de s’inquiéter de l’évaluation des médicaments !
Le spécialiste en toxicologie et président de la commission émet une hypothèse intéressante pour expliquer que les PGM échappent aux analyses : “La peur que si l’on trouvait quelque chose de dangereux, cela ne freine le développement d’un produit dans lequel on a beaucoup investi […]” (p.304). De toute façon, A. Rerat (Académie de médecine et Académie vétérinaire) exclut la présence de pesticides dans les PGM car “cette éventualité est prévenue, en principe, par les examens préalables de la Commission des toxiques” (p.311)… dont le président a rappelé, on vient de le voir, qu’il ne s’occupe pas d’OGM !
Est-on rassuré quand G. Pascal affirme que “la Commission des toxiques sera évidemment interrogée sur les risques […] le jour où l’autorisation de traiter le maïs par le round-up sera demandée” ? Il suffirait donc d’attendre ce moment utile, tout en procédant à des implantations aventureuses des PGM et à la dissémination de leurs constructions génétiques dans l’espace public.
Enfin, vient l’AFSSA
La demande de mise sur le marché des PGM et de leurs produits mobilise une nouvelle structure, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), laquelle doit s’assurer de l’innocuité de ces végétaux quand ils sont ingérés par l’homme ou l’animal. Mais l’AFSSA n’ayant pas les moyens de se livrer aux expériences nécessaires, ses experts, comme ceux de la CGG et de la CGB, se consacrent essentiellement à analyser les données expérimentales produites par les industriels, dont on imagine la neutralité scientifique.
Le président de l’AFSSA, M. Hirsch, constate que “les dossiers sont étonnamment incomplets […] comme si les industriels attendaient que notre niveau d’exigence faiblisse” (p.152). Tout cela n’est pas bien grave, puisque G. Pascal rappelle que, de même que l’AFSSE ne s’occupe pas d’environnement (cf. plus haut), “l’AFSSA n’est pas chargée d’évaluer les risques liés à l’utilisation des produits phytosanitaires” (p.365), un point pourtant crucial en ce qui concerne l’évaluation de la toxicité des produits issus de PGM. Alors, elle fait quoi l’AFSSA ? Elle donne son avis, explique M. Hirsch, “seulement pour l’autorisation de mise sur le marché de produits destinés à l’alimentation humaine ou animale” (p.152), mais pas sur la viande, les œufs ou le lait des animaux nourris avec des PGM, dont l’étiquetage serait “irrationnel, complexe et incontrôlable” indique la proposition 49 du rapport.
On notera les états d’âme de M. Hirsch, qui s’indigne que “quatre ans après la décision de le créer, l’Observatoire des résidus de pesticides n’existe toujours pas, faute de texte, faute de moyens, mais pas faute de groupes de pression […]” (p.157). On voit bien que tout est en règle, et parfaitement démocratique !
D’ailleurs, le ministre de la Santé, P. Douste-Blazy, affirme que les prérogatives des différentes commissions sont claires : “La CGB principalement pour les risques environnementaux mais aussi pour la santé publique, l’AFSSA pour l’alimentation humaine et animale, la Commission du génie génétique (CGG) pour les recherches conduites en milieu confiné” (p.773). Il suffit donc de croire, comme le ministre, que chacune de ces commissions assume complètement ses prérogatives…
En plus, on a l’AFSSAPS
P. Douste-Blazy souligne que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) “est chargée de l’évaluation et de la gestion du risque [pour les médicaments produits par génie génétique] et s’assure de l’absence de risque pour les personnes. Les procédés de fabrication sont particulièrement contrôlés et réalisés en milieu confiné” (p.772). Donc, tout le contraire des PGM…
Si des citoyens éprouvent encore quelque inquiétude, c’est qu’ils doivent ignorer la biovigilance exercée par un comité ad hoc, quoique provisoire.
Le comité (provisoire) de biovigilance
La surveillance des cultures commerciales est confiée à un Comité (toujours provisoire) de biovigilance. Ce dernier s’est développé, selon le ministre de l’Agriculture, D. Bussereau, “au point d’être devenu totalement opérationnel” (p. 684)… bien que “les registres [qui répertorient les cultures commerciales] n’existent pas” (p.685). P.-H. Gouyon, membre de ce comité dont, selon lui, “la composition actuelle ne correspond pas à la loi” ajoute que “son poids est resté très faible, car il n’avait le droit de travailler que sur les cultures commerciales” (p.141), encore très rares. De toute façon, explique le généticien, “il n’est pas informé du lieu des essais” (p.144)…
Les essais en plein champ Contrairement aux pratiques habituelles de la recherche, avec les PGM des essais sont réalisés hors du laboratoire car, explique R. Douce (Académie des sciences) “l’expérimentation en plein champ est une étape absolument incontournable pour juger de l’innocuité ou de l’utilité d’une plante transgénique” (p.310). La formule confirme donc que l’innocuité n’a pas été “jugée” au préalable en milieu confiné, et donc que ces essais présentent des risques inconnus. Peut-être les insuffisances des études en milieu confiné résultent-elles du fait que “la majorité des serres dans lesquelles sont autorisés les essais d’OGM ne sont pas des serres en pleine terre : il faut y cultiver [les plantes] en pots […] parce qu’avec une plante en pleine terre, même sous serre, vous n’êtes plus en conditionnement confiné. Ou alors il faudrait prévoir deux mètres de terre, à récupérer par la suite […]” (G. Freyssinet, p. 344-345). Si, plutôt que des pots de fleurs, on propose de construire de vastes serres-laboratoires pour recréer les conditions variées du climat ou de la dissémination de pollen, M. Guillou, présidente de l’Inra répond qu’ “il faut vraiment de grandes serres” (p.172). Certes ! Mais n’avons-nous pas de vastes porte-avions nucléaires, beaucoup plus compliqués, énormément plus chers, et absolument inutiles ? |
PGM et société
Réglementation
On sait qu’aux États-Unis, les PGM sont mises sur le marché sans suivi spécifique. Selon la formule heureuse de Pascal Lamy (directeur de l’Organisation mondiale du commerce, cité par J. Bizet) : “Les États-Unis considèrent que les OGM ne sont pas dangereux jusqu’à preuve du contraire, l’Union européenne estime qu’ils sont dangereux jusqu’à preuve du contraire […]”. C’est pourquoi l’étiquetage des produits alimentaires est obligatoire en Europe à partir d’une teneur en OGM de 0,9 %, même si ce taux, complètement arbitraire, n’est rassurant que “jusqu’à preuve du contraire”. Lucide, M. Hirsch, alors directeur de l’AFSSA rappelons-le, explique : “Je suis persuadé que le seuil de 0,9 % ne tiendra pas longtemps […] On acceptera que le seuil passe à 3 % en expliquant : « Vous en avez mangé et vous n’êtes pas morts » ” (p.159). C’est effectivement ce que l’on nous a déjà dit en se référant aux “étatsuniens”… A.-M. Chèvre ajoute que 0,9 % “c’est totalement impossible pour le colza” (p.769) et elle est soutenue par D. Chéron (Limagrain) : “Nous ne pourrons jamais le tenir [le seuil de 0,9 %] le jour où les OGM deviendront une réalité en France” (p.410). Il est dommage que ces avis éclairés n’aient pas dépassé l’enceinte de la mission parlementaire, et n’apparaissent même pas dans le tome 1 du rapport, qui contient l’argumentation et les propositions.
De telles évidences amènent le député G. Dubrac à exiger une banalisation totale des PGM : “Si l’on accepte 3 % de plante naturelle dans la plante génétiquement modifiée, acceptons 3 % dans l’autre sens, au lieu de chercher à diaboliser l’une ou l’autre” (p.412). Plus œcuménique que la coexistence, voici le PACS des cultures !
Il appartenait au président Le Déaut d’exprimer définitivement ce que le terme « coexistence » signifie grâce à cette formule extraordinaire : “L’agriculture “bio” sera-t-elle compatible avec les OGM ?” (p.324). Cela nous ramène à la couverture des risques de dissémination accidentelle des PGM, pour laquelle D. Chéron sort de son chapeau une proposition qui ne devrait pas coûter trop cher aux industriels : “Pour les risques non identifiés (au moment de l’homologation de l’événement), il serait logique que l’indemnisation relève d’un fonds d’État dans la mesure où l’autorisation de mise en marché relève des autorités publiques, CGB et autres” (p.41). Dans la même veine, on pourrait également tenir un instituteur comme directement responsable de l’échec professionnel de l’un de ses anciens élèves. En tout cas, c’est dire les responsabilités que prend l’État, en notre nom, quand il laisse s’implanter les PGM !
La question des experts Certains se sont interrogés sur le mode de recrutement des experts car, comme le dit C. Lepage (Comité de recherches et d’informations indépendant sur le génie génétique, CRII-GEN), “il faut fixer le profil des experts. Aujourd’hui, ils sont généralement choisis parmi les demandeurs, ce qui pose tout de même un problème” (p.579). G.-É Séralini ajoute : “Pendant plus de 10 ans, le seul expert de la commission [la CGB] était en fait choisi par l’entreprise pétitionnaire sur une liste de trois personnes […]” (p.703). Un peu comme si un assassin pouvait choisir son juge parmi trois individus dont l’un était son complice ! |
Rôle de la société civile
La présence de représentants de la société civile dans la CGB est prévue mais, remarque son président M. Fellous, ceux-ci “n’en voient pas l’intérêt pour leur “promotion” et ils ne se sentent pas très à l’aise au sein de cette commission où ils sont minoritaires” (p.96). Comment en effet “être à l’aise” quand on ne sert que de caution dans une assemblée savante ? La difficulté à intégrer des profanes dans les collèges d’experts (cf. encadré p.6) souligne l’intérêt de créer, au sein du futur Conseil de la biotechnologie (qui regrouperait CGB et CGG) une commission “société civile” autonome (section économique et sociale), à côté de la commission scientifique (une mesure réclamée, rappelons-le, dès 1998 par la conférence de citoyens). Mais, pour J.-C. Mounolou (Académie d’agriculture), il est “difficilement concevable de soumettre une commission scientifique à une tutelle” (p 332). Serait-ce que les scientifiques peuvent décider de droit divin ou de droit commercial ? R. Rosset s’inquiète également du rapport des forces au futur Conseil, et souhaite que “seule la sous-commission scientifique soit requise pour émettre un avis” (p.74), ce qui renvoie la commission “société civile” à sa fonction décorative. Cette position est avalisée par le projet de loi, qui impose la présence de scientifiques dans la section économique et sociale du Conseil mais préserve l’intégrité (l’intégrisme ?) de la section savante.
Finalement, la recherche devrait rester une chasse gardée ne serait-ce que, comme le prétend J.-Y. Le Déaut, parce qu’ “il paraît impossible que le citoyen participe à la programmation de la recherche car celle-ci doit être libre” (p.584). Où le parlementaire cautionne la fiction du chercheur libre, alors que son activité dépend des ressources octroyées par les acteurs économiques. Et sous-entend qu’il y aurait péril si un “lobby citoyen” se faisait entendre… sans dire en quoi une telle situation serait à risque.
Il en résulte que la participation des citoyens ne peut avoir que des vertus décoratives ou, au mieux, pédagogiques. Pour reprendre les mots du député P. Cohen : “La démocratie participative et les référendums sont indispensables pour améliorer l’état de connaissance des citoyens” (p.404). Les décisions concernant la technoscience seraient des choses trop sérieuses pour tenir compte de l’avis de ceux qui en devront supporter les effets… Quand on songe que “l’état des connaissances” de bien des citoyens est cent coudées au-dessus de celui de la plupart des élus…
La méfiance envers les citoyens transparaît encore dans le souhait de P. Feuillet de réfléchir à la création d’une Cité de l’alimentation “avec communication non pas vers les citoyens mais vers les relais d’opinion : les médecins, les diététiciens, les enseignants et les médias” (p.333). Les “relais d’opinion”, voilà des acteurs sérieux, et aisément convertibles aux idéaux du progrès ! On regrettera que le déni démocratique, que dénonce pourtant C. Lepage, puisse se nourrir du prestige des experts quand celle-ci déclare : “Je me réjouis que la société civile soit représentée par des médecins, c’est-à-dire des personnes capables de comprendre la discussion et d’y intervenir” (p.589). Il me paraît heureux que dans les procédures réellement démocratiques, telles les conférences de citoyens, la société civile soit représentée par des profanes, lesquels deviennent, grâce à la formation qu’on leur dispense et à la confiance qu’on leur témoigne, des “personnes capables de comprendre”.
La mission parlementaire a également évoqué les “opposants” aux PGM, dont F. Guillaume décrit la puissance insoupçonnée. Une véritable armée de “Terminators” : “Nous avons à faire face à un combat de fond mené avec des moyens financiers considérables par des gens qui y ont tout intérêt […]” (p.220). Tant d’absurdité permet de cacher l’activité intense du lobby pro-PGM auprès de la représentation nationale… Le président Le Déaut veut sans doute encore apparaître au-dessus de la mêlée en regrettant que “des activistes des deux bords ne veulent pas discuter ou portent le débat dans l’irrationnel et le tactique, sur de faux sujets – cela vaut d’ailleurs aussi pour le traitement des déchets nucléaires” (p.306). Ce qui montre seulement que la même attitude responsable vaut pour des plantes inutiles mais éventuellement toxiques, et pour l’accumulation de déchets qui resteront mortels pendant des millénaires…
Mais personne ne répond à D. Benoit-Browaeys (journaliste) quand elle affirme que, pour ses prises de position publiques, un chercheur critique que nous avons déjà cité, P.-H. Gouyon, a été “démis de ses fonctions de directeur adjoint du département Sciences de la Vie du CNRS”… (p.656). Serait-ce que la jungle libérale a déjà envahi les institutions scientifiques publiques ?
Au sein même de la mission d’information parlementaire, l’objectivité s’avère douteuse. Ainsi, son vice-président, F. Guillaume, note que la plupart des chercheurs auditionnés étaient favorables aux OGM et ajoute : “Quelques-uns, certes ne l’étaient pas, ils n’étaient du reste pas toujours très sérieux […]” (p.747). Mais comment paraître “sérieux” quand on critique des projets à plusieurs milliards d’euros ?
Pour rompre avec ces “querelles d’activistes”, c’est encore F. Guillaume qui avance que les pouvoirs publics devraient avoir un droit de réponse si des informations erronées sont publiées dans la presse, cette réponse étant produite par une autorité reconnue : “par exemple [l’]Académie des sciences, de médecine, de l’agriculture […]” (p.657). Toutes structures dont les témoignages ont ici prouvé l’objectivité… Et pourquoi les citoyens n’auraient-ils pas un droit de réponse quand des académiciens, séniles ou abusés, se lancent dans des “querelles d’activistes” en proclamant des informations partiales ou erronées ?
Pour J. Bizet, président de la commission sénatoriale sur les OGM, “nous sommes arrivés au terme du débat démocratique […] il faut maintenant un débat politique […]” (p.243), des formules qui questionnent le rapport du politique à la démocratie… Le terme du débat démocratique serait-il la production de ce rapport partial, tendancieux, pro-OGM, selon les mots du député et membre de la mission d’information parlementaire F. Grosdidier ? Ce rapport est tellement en décalage avec ce qu’ont exprimé les citoyens en 1998 (conférence de citoyens) ou en 2002 (débat des quatre sages) qu’il est, effectivement, plus que temps de mener un débat politique… mais portant sur le sens du mot “démocratie”.