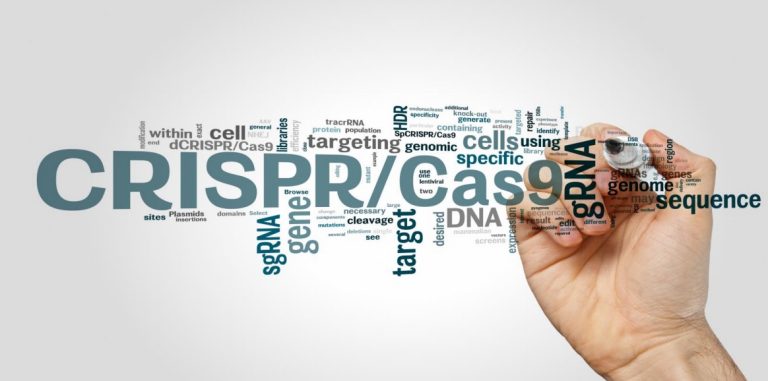Actualités
La dernière de la Commission européenne : tolérer l’importation d’OGM non autorisés
Dernière minute !
Selon les propos d’une source de l’Union européenne rapportés par Reuters, les Etats membres ont discuté hier, lundi 15 novembre 2010, de la proposition de la Commission européenne de lever la politique de tolérance zéro dans les lots à destination de l’alimentation animale, comme expliqué dans notre article (ci-dessous).
Selon cette source, les Etats membres auraient témoigné de positions diverses, allant de l’approbation au refus, en passant par des demandes de clarification. Mais surtout, certains auraient demandé que la proposition soit élargie aux lots destinés à l’alimentation humaine. Interrogée par Inf’OGM, la Commission européenne a confirmé que, pour l’instant, elle souhaitait finaliser la question des lots à destination de l’alimentation animale et verra par la suite la question de ceux pour l’alimentation humaine. Mais surtout, pour la Commission européenne, la présente proposition n’est « en aucun cas une proposition de lever la politique de tolérance zéro mais une proposition d’officialiser que la politique de tolérance zéro se repose sur des analyses dont le 0 technique est défini à 0,1% ».
De son côté, le 11 novembre 2010, le Parlement européen s’est également positionné sur le sujet dans le cadre du vote sur une résolution concernant la crise du secteur de l’alimentation animale. Dans la résolution adoptée, le Parlement européen demande à ce que la Commission européenne propose un seuil, qualifié de pragmatique, quant à la tolérance dans les importations de maïs et de soja pour l’alimentation animale, de plantes transgéniques non autorisées dans l’Union européenne mais en cours d’évaluation. Ce qui est en fait la proposition de la Commission, mais qui elle n’utilise pas le terme flou de « pragmatique »…
Le débat en cours devrait aboutir sur l’adoption d’un règlement, si les Etats membres ne s’opposent pas à la proposition, au cours du printemps 2011.
Article original du 12 novembre 2010
La Commission européenne vient de proposer aux États membres d’abandonner la politique de « tolérance zéro » sur les produits à destination de l’alimentation animale en leur soumettant une proposition de règlement [1]. A l’heure actuelle, la « tolérance zéro » européenne signifie que l’Union rejette systématiquement toute importation qui arrive sur son territoire et qui contient des plantes transgéniques non autorisées et non évaluées par l’AESA [2]. Ainsi en fut-il en 2006 et 2007 avec le riz LL de l’entreprise Bayer en provenance des États-Unis, ou avec le riz Bt63 en provenance de Chine. La Commission européenne souhaite donc définir un seuil en dessous duquel les lots importés en Europe contenant des PGM non autorisées pourraient être acceptés.
La proposition concerne uniquement les lots d’importation d’aliments à destination des animaux. Elle sera discutée le 15 novembre, lors de la réunion du Comité permanent de la chaîne alimentaire. L’adoption ou le rejet final de la proposition sera discuté selon la procédure de comitologie (procédure utilisée pour les autorisations).
Concernant le contenu de la proposition, il est assez simple. Il s’agit de modifier les règles européennes de contrôles (définies par le règlement 882/2004) des produits alimentaires à destination des animaux. La Commission européenne propose aux États membres que les plantes transgéniques en cours d’autorisation dans l’Union européenne et celles dont l’autorisation a expirée soient tolérées dans les lots importés à condition que leur taux soit inférieur à 0,1%. Pour celles dont l’autorisation a expirée, la Commission propose que la tolérance soit effective après le 25 avril 2012. Interrogée sur le choix de cette date, la Commission européenne semble en difficulté pour répondre, puisqu’elle retarde de jours en jours sa réponse… Dans tous les cas, la condition indispensable est qu’une méthode de détection et de quantification de ces plantes transgéniques ait été validée par le Centre Commun de Recherche, l’organe européen en charge de valider les méthodes de détection fournies par les entreprises pour chaque dossier.
Cette proposition représente une avancée majeure pour les industriels. En ouvrant cette brèche, la Commission européenne se dirige progressivement vers une probable synchronisation mondiale des autorisations, ce que les Etats-Unis ont toujours souhaité. Car si les considérations économiques et le souhait d’avoir une agriculture « compétitive » sont à la base de cette proposition, seule une autorisation donnée par un pays et valable automatiquement internationalement (donc synchrone par définition) répondrait pleinement à ce souci d’éviter les écueils économiques dus aux contaminations. Cette proposition d’en finir avec la politique de tolérance zéro semble donc, potentiellement, contenir plus qu’une simple obligation à tolérer certaines PGM…
La proposition ne concerne donc pas les plantes GM pour lesquelles aucune demande d’autorisation n’a été déposée dans l’Union européenne (cela sera peut-être l’objet d’une future proposition de la Commission). Mais il suffit dorénavant aux entreprises de déposer un tel dossier pour que l’Union européenne ne renvoie pas les lots contaminés comme ce fut le cas avec les riz LL et Bt63 en 2006. Par contre, le travail du Centre Commun de Recherche devrait en toute logique augmenter, ce dernier étant voué à devoir valider très rapidement les méthodes de détection pour les plantes contaminantes.
D’où une question pratique qui se pose. Ce Centre Commun de Recherche (CCR) fait actuellement déjà difficilement face aux nombreux dossiers en cours. Il devra dorénavant – si la proposition est adoptée – répondre en urgence aux dossiers de ces PGM non autorisées mais tolérées. Face à cette surcharge, un allègement du travail sera probablement souhaité. Soit le CCR maintiendra son travail en passant sur des questions « gênantes » comme celle d’une méthode non spécifique et donc non adéquate [3]. Soit le CCR suggèrera de ne plus avoir à valider les dossiers pour les plantes contenant plusieurs transgènes si les méthodes de détection des dits transgènes ont déjà été validées dans d’autres dossiers. Une telle simplification ne sera pas sans poser de question quant à la réelle applicabilité des méthodes pour permettre de détecter et tracer tout au long d’une chaine de transformation les plantes à plusieurs transgènes.
[1] cf. le document joint à cet article
[2] Inf’OGM rappelle qu’une première dérogation avait été accordée via l’article 47 du règlement 1829/2003 qui stipule que « la présence dans les denrées alimentaires […] contenant des OGM, […] dans une proportion n’excédant pas 0,5 % n’est pas considérée comme une infraction […] à condition que : a) cette présence soit fortuite ou techniquement inévitable ; b) que le matériel GM ait obtenu un avis favorable du ou des comités scientifiques de la Communauté ou de l’Autorité avant la date d’application du présent règlement ; c) que la demande d’autorisation n’ait pas été rejetée conformément à la législation communautaire en la matière, et d) que les méthodes de détection soient accessibles au public ».
[3] cf. Inf’OGM le journal n°107, EUROPE – Amflora : une autorisation illégale selon les experts français