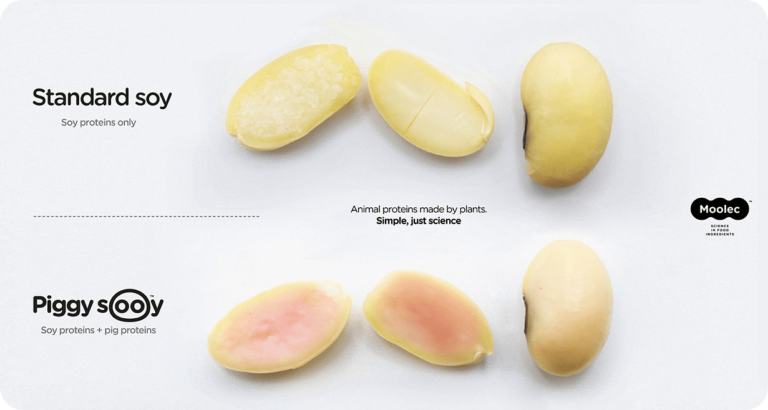Actualités
International – Importations d’OGM : vers un système mondial d’autorisations ?
Il existe aujourd’hui une grande disparité entre les pays, à l’échelle mondiale, en ce qui concerne les autorisations d’OGM. L’autorisation d’un OGM dans un pays donné n’implique pas qu’il soit autorisé, en même temps, dans d’autres pays (sauf à l’échelle de l’UE, mais là encore, il y a des restrictions nationales), ni que les protocoles d’évaluation soient similaires d’un Etat à l’autre. Ces différences ont déjà été sources de conflits et pourront l’être encore à l’avenir, notamment entre pays exportateurs et importateurs si ces derniers refusent légitimement l’accès à leur marché à des produits non encore autorisés [1]. Une situation pénalisante pour les principaux pays producteurs d’OGM qui peinent à garantir l’étanchéité de leur filière et n’acceptent pas de voir leurs produits contaminés refoulés.
Depuis de nombreuses années, sont discrètement discutés les moyens de réduire ces perturbations du marché international… L’objectif immédiat est de faire accepter, par tous les États, une faible présence d’OGM non autorisé dans un produit. L’objectif à plus long terme pourrait bien être d’uniformiser à l’international les procédures d’autorisations et donc d’évaluation des risques, en demandant par exemple à ce qu’une autorisation donnée dans un pays puisse être valable partout…
L’Union européenne applique une politique de « tolérance zéro » vis-à-vis des OGM non autorisés sur son territoire : un OGM ne peut être mis sur le marché à moins d’avoir été évalué et autorisé. Jusqu’à présent, cette règle était appliquée strictement sans que la législation en précise le seuil. Mais la Commission européenne a souhaité légiférer sur ce point, en commençant par l’alimentation animale. Aujourd’hui, un seuil de détection de 0,1% est établi par un règlement pour l’alimentation animale [2] : à la condition que cet OGM soit en cours d’autorisation au sein de l’UE et que l’AESA n’ait pas émis un avis négatif à son encontre, la présence de cet OGM peut être admise jusqu’à hauteur de 0,1% [3], seuil au-dessous duquel on autorise donc l’importation. Pour l’alimentation humaine, les discussions sur un règlement sont en cours [4].
Le Codex pour contourner les autorisations ?
Ainsi, que ce soit pour l’alimentation humaine ou animale, tout lot importé en Europe et qui contient des traces de plante génétiquement modifiée (PGM) non autorisée est renvoyé, sauf pour l’alimentation animale qui bénéficie donc, on l’a vu, d’une tolérance à hauteur de 0,1%. Les pays exportateurs se retrouvent donc avec des lots qui leur reviennent comme ce fut le cas avec le riz LL62 aux États-Unis [5] ou le lin en provenance du Canada [6]. Pour que cela ne se reproduise pas, l’entreprise qui commercialise la PGM incriminée doit alors déposer une demande d’autorisation commerciale complète. Mais la procédure apparaît longue et coûteuse pour ces entreprises. En 2008, le Codex alimentarius qui gère les règles sanitaires internationales avait abouti [7] à une solution intermédiaire : préconiser la mise en place d’un système d’échange d’information entre pays ayant autorisé une PGM et ceux ne l’ayant pas autorisé. Par ce canal, des informations scientifiques a minima, dont la liste est définie par le Codex, pourraient transiter et permettre aux entreprises de ne pas avoir à déposer de demande d’autorisation commerciale. Avec le gain de temps que cela représente… Le Codex propose ici une alternative pour éviter des situations de blocage entre pays. Si son contenu n’est pas obligatoire à l’échelle internationale, il peut en revanche servir de base en cas de conflit devant l’OMC. Et son contenu ne va pas vraiment dans le sens de la législation européenne sur le sujet.
Fluidifier le commerce international coûte que coûte ?
En mars 2012, treize États [8] – dont aucun de l’Union européenne – faisant référence au travail du Codex alimentarius, ont annoncé, par le biais d’une déclaration commune, avoir amorcé un travail sur les faibles taux de contaminations. Ces États estiment que le commerce international est menacé par les autorisations asynchrones et donc, par les faibles présences d’OGM non autorisés. Et ce, que ce soit dans l’alimentation humaine ou pour les semences, car ces dernières sont également sujettes à possibles contaminations des lots exportés à l’international.
Cependant la déclaration commune reste discrète sur ce que ces pays vont mettre en œuvre. En effet, s’ils annoncent se baser sur le travail du Codex, ils peuvent par exemple décider de mettre en place le système d’échange d’information et que chaque pays délivre une autorisation temporaire pour des PGM présentes à faible taux dans des lots importés. Ils pourraient aussi aller plus loin en décidant qu’une autorisation donnée pour une PGM par un État, et dont l’évaluation est considérée comme conforme aux lignes directrices du Codex alimentarius, suffit pour que les autres États acceptent cette PGM dans de faibles quantités, sans l’évaluer eux-mêmes. De là, le pas à franchir pour généraliser ce système aux autorisations commerciales de tous les pays serait plus facile à faire…
[3] Règlement 619/2011 du 24 juin 2011 fixant les méthodes d’échantillonnage et d’analyse du contrôle officiel des aliments pour animaux en vue de la détection de matériel génétiquement modifié faisant l’objet d’une procédure d’autorisation ou dont l’autorisation a expiré.
[8] Australie, Argentine, Brésil, Canada, Chili, Costa-Rica, États-Unis, Mexique, Paraguay, Philippines, Russie, Uruguay, Viêt Nam.
http://www.fas.usda.gov/internation…