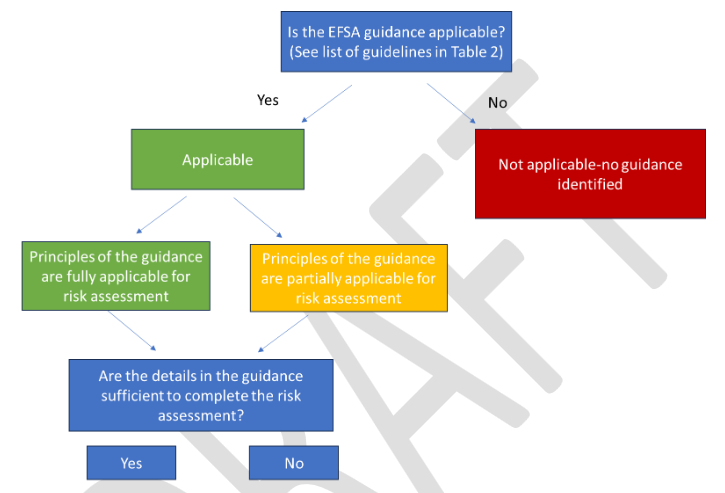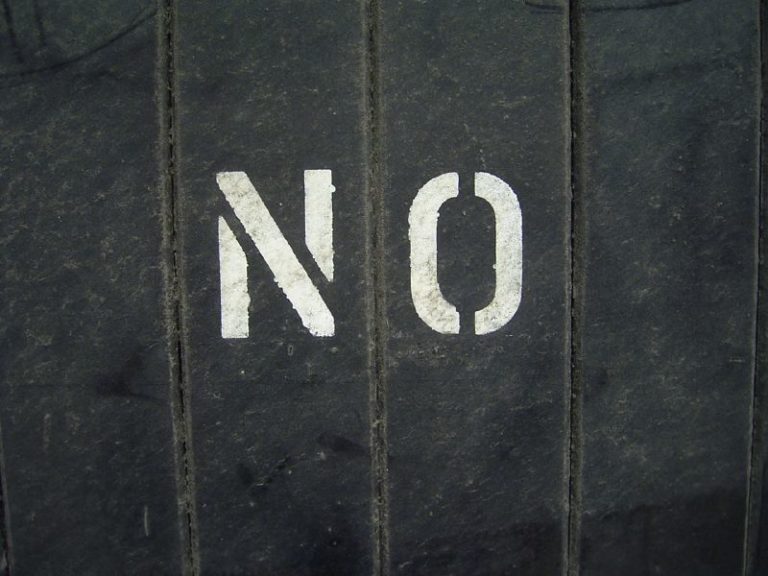Actualités
Effets à long terme des OGM : l’UE et la France lancent deux appels d’offres différents

Et si G.-E. Séralini avait raison ? Son étude, publiée en septembre 2012, a certes été critiquée par les comités d’experts, mais l’onde de choc qu’elle a provoquée n’en a pas été pour autant stoppée. Avant l’été, la France et la Commission européenne ont chacune publié un appel d’offres autour de la question des effets à long terme des OGM sur la santé. Ainsi, la Commission européenne a proposé un budget de trois millions d’euros pour une « étude de carcinogenèse de deux ans sur rats avec du maïs NK603 » [1] dont les résultats devront être rendus sous quatre ans. En France, un budget un peu plus modeste (2,5 millions d’euros) a été débloqué, dans le cadre du programme Risk’OGM, pour que soit constitué un « consortium de recherche pour l’étude des effets sanitaires à long terme liés à la consommation d’OGM » [2]. Ce travail, étalé sur trois ans et demi, est présenté comme « un projet de recherche complémentaire du projet de la Commission européenne ».
L’évaluation des risques des plantes génétiquement modifiées (PGM) est critiquée depuis longtemps : manque de connaissances sur les risques à long terme, faiblesse de la puissance statistique des études de toxicologie, etc. L’étude de G.-E. Séralini qui concluait à des impacts sanitaires sur des rats nourris avec du maïs GM NK603 et son herbicide associé, le Roundup, est une des trois seules études de toxicologie faites à long terme [3]) selon le Haut Conseil des biotechnologies (HCB). En France, suite à cette publication, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses) avait recommandé que soient conduites « des recherches visant à décrire les effets potentiels sur le long terme d’OGM », une demande également relayée par le Comité éthique, économique et social du Haut Conseil des biotechnologies [4]. Fin 2012, le gouvernement français avait annoncé retenir cette idée [5].
Mais dans la même période, la Commission européenne faisait courir le bruit qu’elle réfléchissait également à la mise en œuvre d’une étude européenne similaire. Avait alors suivie une période assez floue où le chaud et le froid soufflaient quant à la mise en œuvre d’une telle étude en France, le gouvernement souhaitant éviter de faire doublon avec l’étude européenne. Si ce flou est aujourd’hui levé, l’appel d’offres de la Commission apparaît réduit par rapport à ce qui aurait pu être demandé comme analyse.
La Commission souhaite une étude de cancérogenèse sur le maïs NK603 sans Roundup
En premier lieu, l’appel d’offre européen ne fait aucunement référence à l’herbicide Roundup, pourtant étroitement lié au maïs NK603 qui le tolère. Il n’est donc pas demandé aux chercheurs d’étudier la toxicité du Roundup ni du couple NK603 et Roundup. Or, intégrer l’herbicide dans l’étude semble relever du bon sens. La consommation humaine ou animale d’un tel maïs se fera en effet après que ce dernier ait été exposé à l’herbicide. Étudier les effets du maïs NK603 revient donc logiquement à étudier ces deux éléments, ensemble et séparés. Mais la logique n’est pas du côté de la Commission européenne, qui a donc fait le choix de n’étudier que le NK603 seul, sans Roundup.
Ensuite, l’étude demandée est une étude de carcinogenèse. Les chercheurs étudieront donc le possible développement de cancers suite à la consommation de ce maïs. Une étude moins large (puisque focalisée sur les apparitions de cancer) qu’une étude de toxicité chronique dont l’objectif aurait été d’analyser les potentiels effets toxiques de la consommation de ce maïs – comme celle qu’a réalisée l’équipe du professeur Gilles-Eric Séralini ! Enfin, le budget de trois millions d’euros alloué par la Commission européenne apparaît assez faible : en effet, une telle étude nécessiterait, selon les lignes directrices de l’OCDE, au moins 50 rats par groupe. Or G.-E. Séralini a dépensé un budget de trois millions d’euros pour une étude mobilisant 20 rats par groupe pour un total de 200 rats (nombre de rats qu’on lui a assez reproché…). La question est donc de savoir si trois millions suffiront, même si l’étude demandée par la Commission est moins large étant donné que le couple maïs-herbicide ne sera pas étudié. L’étude comportera donc moins de lots.
La France veut compléter le projet européen
Le 12 juillet 2013, le programme de recherche Risk’OGM [6] a publié un appel d’offres qui vise à « améliorer les connaissances sur l’évaluation des effets sanitaires à long terme de la consommation d’OGM afin de contribuer à une meilleure analyse des risques dans ce domaine ».
Concrètement, le gouvernement français attend donc des scientifiques des suggestions sur l’étude d’effets à long terme. Le choix est libre quant à l’OGM étudié, les paramètres à étudier et donc les analyses à conduire. L’appel d’offre français laisse donc la porte ouverte à l’étude des herbicides dans le cas d’OGM les tolérant. Mais le budget de 2,5 millions d’euros obligera très certainement les scientifiques à aller trouver des compléments financiers. Les projets devront être proposés avant le 20 septembre 2013, un délai très, très court…
Si les scientifiques ont le choix de l’OGM (maïs ou soja par exemple), l’appel d’offres précise néanmoins deux points importants. Il est ainsi clairement énoncé d’une part, que la mise en œuvre d’une telle étude ne donnera pas lieu à un essai en champ puisque « les plantations expérimentales de l’OGM choisi seront déléguées à un prestataire chargé d’assurer sa culture selon les bonnes pratiques agricoles et dans des conditions maîtrisées, dans un pays où cette culture est autorisée » [7]. Et, d’autre part, devront être identifiés, et donc déclarés, les « conflits d’intérêt potentiels des membres du consortium en matière d’OGM et de produits phytosanitaires ».
G-E. Séralini a souligné la lacune sur l’herbicide du projet européen [8]. Mais plus fondamentalement, il considère que le problème majeur de l’appel d’offres français – et de celui de la Commission européenne – est que la « plupart des membres du comité scientifique du groupe Risk’OGM – dont [il fait] partie – étaient d’accord à l’époque [de l’évaluation de la demande d’autorisation du maïs NK603] pour que ne soient pas menés les tests à long terme et pour que soit autorisé le maïs NK603 ». En d’autres mots, G.-E. Séralini considère anormal que des experts ayant validé la demande d’autorisation du maïs NK603 soient ceux qui aujourd’hui jugent les protocoles de recherche présentés. Pour G.-E. Séralini, ces experts « seraient alors discrédités si la recherche [conduite via ces deux appels d’offre] leur donnait tort ». Le scientifique français considère donc que « ce n’est pas à eux de juger de la pertinence de tel ou tel protocole ».
Une chose est sûre : la question des effets à long terme des OGM n’est pas encore résolue. Les deux appels d’offres soulignent que la question des risques à long terme n’a pas encore été suffisamment et correctement traitée. La publication des résultats sera une nouvelle occasion de débattre de l’évaluation des PGM. Mais si les études à long terme deviennent une donnée pertinente, alors que faire des autorisations de PGM données ou en cours ? Ces PGM ne devraient-elles pas, elles aussi, être soumises à une telle analyse ?
[3] , « Evaluation des OGM : agences et gouvernement français s’accordent pour refaire une expérimentation », Inf’OGM, 9 novembre 2012
[4] , « Besoin de recherches sur les effets à long terme des OGM », Inf’OGM, 4 décembre 2012
[6] Ce programme de recherche du Ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (MEDDE) fut lancé en 2010, suite aux engagements pris dans le cadre du « Grenelle de l’Environnement ». Intervenant en appui à la décision publique, ses objectifs généraux sont formulés pour prendre en compte les deux grandes caractéristiques de l’action publique concernant les OGM : la mise en place d’un cadre légal et réglementaire nouveau ; l’évolution des sciences et des techniques. Il est piloté par un comité d’orientation, composé de représentants des ministères et des parties prenantes impliqués ; et par un conseil scientifique, composé de chercheurs représentant la palette de disciplines concernées et dont fait partie Gilles-Eric Séralini [[http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RiskOGM-APR2010.pdf
[7] cf note 2, page 6
[8] « Il faut des études de toxicité chronique pour les OGM », Journal de l’environnement, 22 juillet 2013