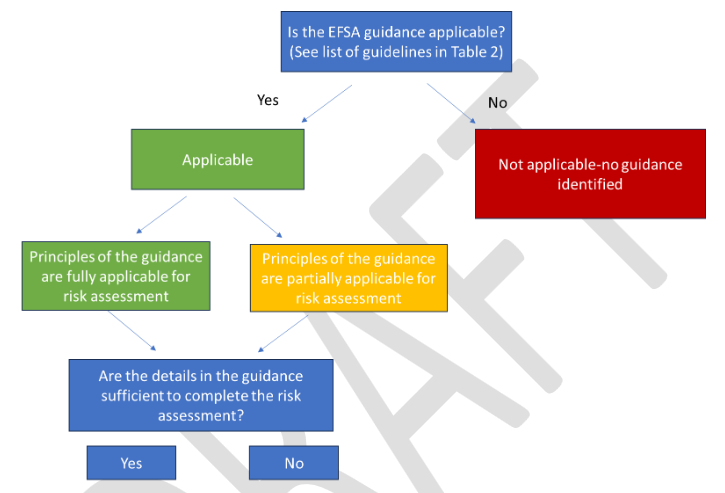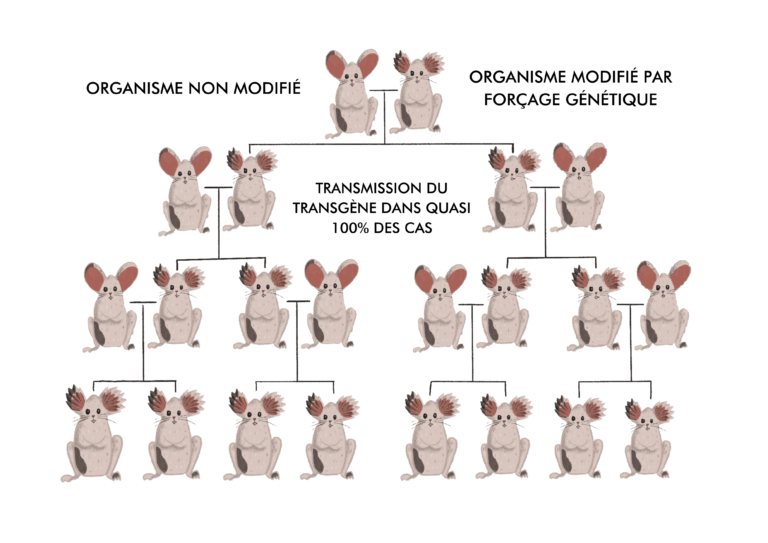Actualités
Organes et tissus bio-imprimés : où en est-on ?

La bio-impression 3D est une technologie ambitionnant la fabrication de tissus et d’organes biocompatibles, implantables sur le corps humain. Née à la fin du 20ème siècle, elle cherche encore à atteindre une maturité qui contribuerait à l’avènement de l’« homme augmenté », avec les problèmes éthiques et légaux que cela impose.
La bio-impression 3D (BI-3D) est une technologie appartenant au domaine de la biologie de synthèse [1]. Elle a pour objet la production de tissus et autres constructions biologiques au moyen de bio-imprimantes 3D. Cette « fabrication additive » utilise un principe d’empilage de couches successives de cellules vivantes sur des bio-matrices via une assistance informatique. Une telle structuration spatiale permettrait de « réparer » des tissus, voire de reconstituer artificiellement un organe entier. Aujourd’hui, certaines salles d’opération se dotent de bio-imprimantes 3D pour fabriquer et greffer de la peau, notamment pour les grands brûlés [2].
Une technologie « inspirée » des imprimantes à jet d’encre…
Les premières expériences de bio-impression auraient été menées dans les années 1980. En 1988, R. J. Klebe, chercheur à l’Université du Texas, met au point le Cytoscribing [3], une méthode de micro-positionnement des cellules, inspirée de l’imprimante à jet d’encre classique. Elle utilise de la « bio-encre », dénomination trompeuse puisqu’il s’agit en fait de matériaux utilisés pour produire des tissus artificiels à l’aide de l’impression 3D. Ces bio-encres sont principalement composées de cellules et sont souvent combinées à des matériaux supplémentaires, comme des biopolymères, qui enveloppent lesdites cellules. Mais la véritable émergence de cette technologie se fait dans les années 90, et son transfert au secteur industriel n’a lieu qu’au 21ème siècle avec des approches plus coûteuses mais plus performantes, comme la bio-impression par micro-extrusion [4]. Dans cette technique, des « bio-encres » chargées de cellules sont distribuées par une buse ou une seringue pour former des filaments, des fibres ou des gouttelettes et réaliser des échafaudages chargés de cellules, couche par couche. La BI-3D par micro-extrusion est couramment utilisée pour imprimer des tissus biologiques en 3D de haute viscosité. Elle n’offre cependant qu’une faible résolution, c’est-à-dire un placement peu précis des cellules par l’imprimante, ce qui impacte le bon déroulement de la phase finale de développement des cellules ainsi que la forme recherchée du tissu. Une troisième approche basée sur le laser, la LAB (Laser-Assisted Bioprinting), reste peu utilisée en raison du nombre restreint de biomatériaux compatibles, sa lenteur et son coût encore élevé [5].
Une production par bio-impression 3D commence par la numérisation – un scan – tridimensionnelle de l’objet que l’on veut produire. Un logiciel de conception assistée par ordinateur (CAO) est utilisé pour modéliser cet objet lorsque celui-ci n’est pas disponible. Le scan est ensuite traduit par un logiciel de fabrication assistée par ordinateur (FAO) en un chemin que l’imprimante peut suivre. L’objet est enfin imprimé couche par couche à l’aide de bio-imprimantes, dispositifs robotisés guidés par un logiciel.
… pour produire des tissus ou des organes « humanisés »
La bio-impression 3D ambitionne d’être utile pour la recherche en biologie, mais aussi en médecine régénérative. Les tissus ou organes « imprimés » devant être in fine implantés, il faut tenir compte de l’environnement dans lequel cela se fait. L’acte de transplantation doit aussi prendre en compte le phénomène de rejet. La bio-impression 3D doit donc employer des biomatériaux qui n’induisent pas de réaction immunitaire, notamment des hydrogels et des sucres. Ces derniers constituent un « échafaudage » dans le processus d’impression qui permet aux cellules imprimées en 3D de se répliquer [6]. La méthode de BI-3D utilisant la « bio-encre » prétend résoudre cette question du rejet en utilisant les cellules de l’individu receveur du transplant ou d’un autre individu de la même espèce, apparenté (de la même famille) et/ou possédant des caractéristiques biologiques semblables.
Mais la bio-impression 3D semble surtout buter sur l’ampleur de ses objectifs. Les projets les plus avancés seraient pour le moment la production de tissus simples, comme la peau de la société française Poietis [7], émanation de l’Inserm [8]. Son co-fondateur, Bruno Brisson, estimait lui-même, en avril 2020, que « malgré les avancées des recherches, il n’est actuellement pas possible d’imprimer des organes entiers fonctionnels » [9]. Certains tentent néanmoins de repousser les limites de la bio-impression 3D, à l’instar de l’Université de Tel-Aviv qui a fabriqué, en 2019, le premier cœur avec les propres cellules d’un patient [10]. Les chercheurs de cette université ont démontré en laboratoire une contractilité et une certaine vitesse de conduction, comme le souligne le Journal of Material Science en mai 2021, dans un bilan des projets de cœur bio-imprimés [11]. Mais, comme pour les différents projets de cœurs évoqués par cet article, on en est encore au stade expérimental. La société de conseil Alcimed le confirme en mars 2021 dans un autre article sur les avancées du cœur bio-imprimé [12] : « De nombreux défis restent à relever avant que des cœurs imprimés en 3D soient disponibles pour être implantés sur des patients. Le cœur en bio-impression 3D a encore un long chemin à parcourir ».
Des projets semblent cependant toujours en développement autour d’organes moins complexes. En juin 2022, la société 3D Biotherapeutics annonce être en essai clinique pour examiner la sécurité et l’efficacité préliminaire d’une oreille fabriquée par BI-3D pour les patients atteints de microtie. Cette pathologie rare correspond à l’absence partielle ou totale du pavillon d’oreille [13].
Des questions éthiques et épistémologiques surgiront, notamment en raison de l’attirance de certains par le transhumanisme. Le « marché » auquel s’adresse la BI-3D devrait attirer, pour sa part, l’industrie puisqu’il est actuellement évalué à environ 3 milliards de dollars [14] . Les dispositifs permettant de mettre en œuvre les différentes techniques de bio-impression 3D sont d’ailleurs déjà commercialisés par de nombreuses entreprises [15]. Des gros laboratoires de l’industrie pharmaceutique emboîtent le pas en proposant des composants pour la fabrication de nouveaux tissus et organes, comme les « bio-encres » du laboratoire Merck et de sa filiale Sigma-Aldrich [16].
De nouveaux enjeux éthiques et légaux
En 2014, dans son article intitulé « To Bioprint or Not to Bioprint », le juriste Jasper L. Tran, de la Harvard Business School, examine, sous un angle éthique, les « pour » et les « contre » de la BI-3D [17]. Les raisons qu’il avance sont essentiellement sociétales. Il estime qu’une interdiction pure et simple serait une « réponse facile à la question de savoir comment réglementer la bio-impression » mais que cela « empêcherait de sauver de nombreuse vies ». Jasper L. Tran ajoute qu’une telle interdiction mettrait un terme à toute recherche et constituerait un frein à l’innovation, comme si toute innovation était par principe positive. En outre, une telle proscription serait, selon lui, en raison de sa radicalité, peu probable d’être acceptée politiquement [18]. Une restriction intermédiaire pourrait, selon le juriste, être à l’origine d’autres types de problèmes, notamment le « développement du marché noir des organes imprimés », avec les risques sanitaires inhérents. À l’opposé de l’interdiction pure et simple, on pourrait opter pour l’autorégulation. Elle est évoquée par Jasper L. Tran comme une option envisageable mais cela impliquerait qu’un gouvernement « dépende du marché et fasse confiance à chaque individu » . Il devrait de plus « jouer un rôle de soutien en éduquant le public et en lui communiquant des informations sur la sécurité (NDLR : de la BI-3D) ». On peut aisément y voir un vœux pieu ou une croyance excessive dans les capacités de l’ingénierie sociale.
L’option proposée par Jasper L. Tran de responsabilisation des individus et des institutions qui les gouvernent serait en tout cas très probablement celle défendue par les industriels de la bio-impression 3D. Et rien ne peut exclure que cette dernière soit, à terme, techniquement et économiquement accessible à (presque) tous. Qu’en sera-t-il alors du coût social, écologique et humain de la BI-3D ? Est-on fatalement face à une incapacité collective de décider ce que l’on souhaite ?
L’avènement de la bio-impression 3D dans le quotidien des « malades » reste une hypothèse possible sans qu’on en maîtrise les limites ni les risques. Elle suscite des inquiétudes sur le sujet du transhumanisme et sa version extrême, la conception d’un humain artificiel. Elle soulève aussi une autre question d’ordre légal, autour du droit de la propriété intellectuelle. Dans leur étude, les chercheurs N. Althabhawi et Z. Zainol [19] examinent la question de la brevetabilité de la bio-impression 3D et de ses produits dans différentes juridictions, notamment l’Europe et les États-Unis. Ils soulignent, entre autres, les spécificités de cette technologie, et leur impact possible sur l’interprétation des notions d’exclusion de la brevetabilité et de « produits issus de la nature ». Se pose aussi la question de « à qui appartient le corps de chaque individu dès lors qu’il comprend des composants brevetés ? ».
[1] , « Biologie synthétique : un développement discret », Inf’OGM, décembre 2008
[2] « Greffe de peau : la bio-imprimante arrive au bloc ! », Science et Vie, mars 2022
[3] Klebe, RJ., « Cytoscribing : a method for micropositioning cells and the construction of two- and three-dimensional synthetic tissues », Exp Cell Res, décembre 1988
[4] Davoodi, E., « Extrusion and Microfluidic-Based Bioprinting to Fabricate Biomimetic Tissues and Organs », Adv.Mater. Technol., mai 2020
[5] Dou, C., « A State-of-the-Art Review of Laser-Assisted Bioprinting and its Future Research Trends », ChemBioEng Rev., juin 2021
[6] Ammar, J., « Defective Computer-Aided Design Software Liability In 3d Bioprinted Human Organ Equivalents », High Technol. Law J., février 2019
[7] Site Internet de Poietis : https://poietis.com/about-us/
[8] Institut national de la santé et de la recherche médicale
[9] « À la découverte de la bio-impression : 2 experts français répondent sur ses avancées réelles », avril 2020
[10] Noor, N., « 3D Printing of Personalized Thick and Perfusable Cardiac Patches and Hearts », Advanced science, avril 2019
[11] Kato, B., « 3D bioprinting of cardiac tissue : current challenges and perspectives », Journal of Material Science, mai 2021
[12] « Impression 3D en santé : l’avancée du coeur en bio-impression 3D », Les Articles d’Alcim, 30 mars 2021
[13] « 3DBio Therapeutics implants 3D-printed ear in first-in-human trial », NS Medical Devices, juin 2022
[14] Ammar, J., Op. cit
[15] Benedict O’Neill, « Qu’est-ce que la bio-impression 3D ? », Aniwaa, 21 mai 2022
[16] Page « Bio-impression 3D » du laboratoire Merck : https://www.sigmaaldrich.com/FR/fr/products/materials-science/biomedical-materials/3d-bioprinting
[17] Tran, JL., « To Bioprint or Not to Bioprint », Social Science Research Network, décembre 2014
[18] Jasper L. Tran se place dans un contexte juridique étasunien.
[19] Althabhawi, NM., « The Patent Eligibility of 3D Bioprinting : Towards a New Version of Living Inventions’ Patentability », Biomolecules, 2022