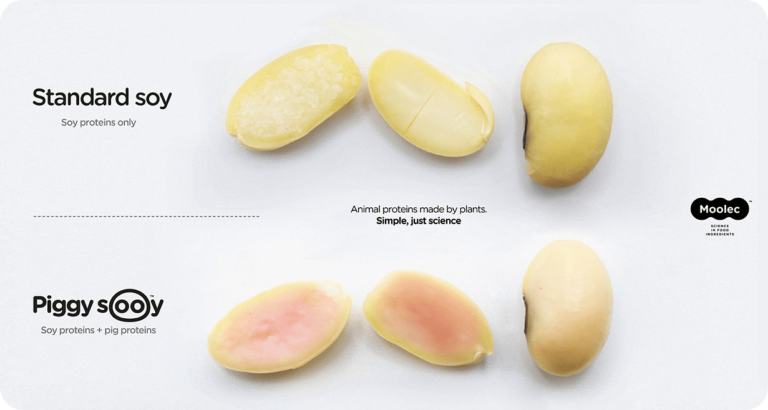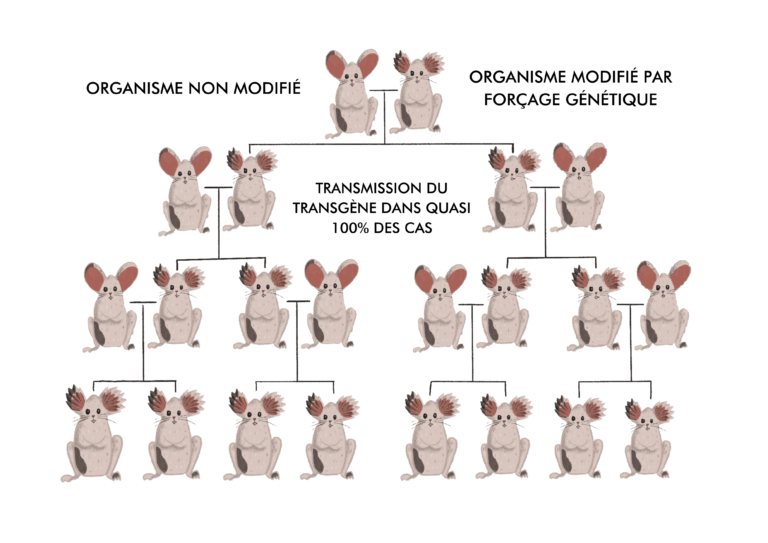Actualités
La déréglementation des OGM se poursuit en Angleterre

Le Royaume-Uni a déjà allégé, par voie réglementaire, les règles applicables aux essais en champ pour les « nouveaux OGM » début 2022. Désormais, il souhaite adopter une législation plus souple pour la commercialisation de certaines plantes et certains animaux génétiquement modifiés. Le projet de loi est défendu par le gouvernement avec des arguments scientifiquement douteux et ressassés dans le cadre d’une indépendance retrouvée par le Brexit.
Le Premier ministre britannique, Boris Johnson, aura tenu parole. Dès le premier jour de son mandat, il avait promis de « libérer » les OGM dans l’agriculture et l’alimentation des réglementations européennes jugées étouffantes et disproportionnées. Après l’adoption, par voie réglementaire, de règles plus souples pour les essais en champ [1], un projet de loi a été présenté à la Chambre des communes le 25 mai 2022 pour assouplir les règles concernant la dissémination des OGM dans l’environnement (commercialisation et recherche) [2].
Le discours de la Reine, prononcé en son nom quelques jours plus tôt par le Prince Charles, présentait les objectifs visés par ce projet de loi. Le Prince Charles a ainsi déclaré que « (m)es ministres encourageront l’innovation agricole et scientifique chez nous. La législation libérera le potentiel des nouvelles technologies pour promouvoir une agriculture et une production alimentaire durables et efficaces » [3]. Une déclaration vague pour un projet de loi aux lourdes implications mais truffé d’imprécisions.
Une nouvelle catégorie juridique pour des OGM qui ne seraient pas des OGM
Le projet de loi, dont les règles ne s’appliqueront qu’à l’Angleterre [4], vise à faire sortir du champ de la législation OGM certains OGM pour lesquels est créée une nouvelle catégorie juridique : les « organismes issus de sélection de précision » (« precision bred organisms » ou « PBOs »), végétaux ou animaux. Un néologisme de plus dédié à noyer le poisson, après les « NBT » et autres techniques d’édition de gène.
Ces OGM relèveront de règles spécifiques moins contraignantes. Mais les contours de cette nouvelle catégorie juridique sont flous. Le projet de loi définit les « organismes issus de sélection de précision » comme des organismes dont les caractéristiques du génome auraient pu résulter d’un « processus traditionnel » ou d’une « transformation naturelle« [5], sans pour autant définir clairement ces notions ni de quelles caractéristiques il s’agit [6]. La définition est très large et met l’accent sur les caractéristiques du produit final, sans égard aux techniques utilisées pour l’obtenir. Une manière de se démarquer clairement de la réglementation OGM de l’Union européenne qui, jusqu’à présent, définit les OGM par les procédés de modification génétique utilisés.
Pour Pat Thomas, directrice de l’association Beyond GM [7], l’emploi de l’expression « sélection de précision » est une manœuvre pour éviter que soient associées à ces OGM prétendus d’un genre nouveau les questions scientifiques, éthiques et environnementales que la population se pose à propos des OGM. Elle insiste sur le fait que l’expression, peu connue et peu comprise du grand public, trouve son origine dans le marketing et non dans la science [8]. D’ailleurs, des sociétés savantes, comme le Nuffield Council on Bioethics, le Roslin Institute et l’Insitute of Food Science & Technology ont émis de sérieuses réserves sur cette expression jugée trop simpliste et hasardeuse [9].
C’est pourtant précisément la science que le gouvernement britannique invoque à l’appui de son projet de loi. Le ministre de l’environnement, M. George Eustice, justifie en effet cette différence de traitement entre OGM par le fait que « (l)a grande majorité des scientifiques sont d’avis que ces techniques de sélection de précision, qui ne produisent rien qui ne puisse être obtenu par des processus de sélection naturels, ne sont en fait pas des OGM » [10]. Une manière peu subtile de signifier que la question ne souffre aucun débat. Pourtant, cette position prend le contre-pied de toutes les définitions juridiques des OGM (directive 2001/18 et Protocole de Cartagena) qui reposent sur les techniques utilisées et non sur les seules caractéristiques du produit final et de leur confirmation par un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne de 2018 [11]. Surtout, l’affirmation du ministre britannique justifie le fait d’accorder à ces OGM une présomption d’absence ou de moindre risques en dépit des études scientifiques tendant à prouver le contraire.
Un régime juridique peu contraignant fondé sur une présomption de sécurité
Une présomption de moindre risques se trouve clairement reflétée dans le projet de loi. Celui-ci crée certes deux systèmes de notification préalable obligatoire pour ces OGM répondant à la définition « d’organisme issu de sélection de précision », l’un pour la commercialisation, l’autre pour la dissémination à des fins non commerciales (recherche et développement).
Mais le projet de loi n’insiste pas sur le caractère obligatoire de l’évaluation des risques environnementaux et sanitaires. Il se contente d’indiquer que des mesures réglementaires ultérieures « peuvent » exiger une évaluation des risques préalable. Et, en toute logique, les modalités de cette évaluation des risques « peuvent » elles aussi être précisées par voie réglementaire… Cela n’empêche pas le ministre M. George Eustice d’affirmer que « (l)e projet de loi n’aura pas pour effet de réduire le niveau de protection de l’environnement prévu par toute loi environnementale existante » [12].
Le fait que des dispositions aussi importantes soient laissées à d’hypothétiques mesures réglementaires a été critiqué lors de la première lecture du projet de loi à la Chambre des communes (l’Assemblée nationale britannique) le 15 juin dernier. Le contrôle parlementaire s’en trouve en effet largement réduit. Pour le député travailliste Daniel Zeichner, plutôt favorable aux OGM, le Gouvernement demande aux députés de lui donner « un chèque en blanc ». Or, « sur une question qui repose autant sur la confiance et l’acceptation du public, ce n’est pas un bon point de départ » [13].
Autre point problématique : l’information du public. Quelle transparence est-il prévu, quel étiquetage des OGM concernés par le projet de loi ? Le texte se contente de renvoyer là aussi à de futures éventuelles dispositions réglementaires, sans préciser la moindre exigence devant y figurer obligatoirement… pas même l’étiquetage. La seule mesure de transparence prévue est la publication d’un registre en ligne contenant une liste des produits autorisés. L’absence d’étiquetage, tout comme des règles plus souples pour certains OGM, va pourtant à l’encontre de la consultation du Gouvernement organisée en amont de la présentation du projet de loi. Selon cette consultation, 88 % des personnes interrogées souhaitent que les nouveaux OGM utilisés en agriculture continuent d’être réglementés de la même manière que les autres OGM [14]. Pour la députée Caroline Lucas, membre du Green Party (Parti Vert), « (l)es ministres partent tout simplement du principe que les risques sont inexistants ou infimes, mais ces vœux pieux n’ont rien de scientifique » [15].
Des contradictions internes au Royaume-Uni
Le Gouvernement érige le projet de loi en une sorte de symbole de l’indépendance retrouvée par rapport à l’Union européenne. Selon lui, « (e)n dehors de l’UE, et libre d’établir des règles qui servent au mieux les intérêts du Royaume-Uni [et cette] nouvelle législation fera du Royaume-Uni le meilleur endroit au monde pour investir dans la recherche et l’innovation agroalimentaire » [16].
Mais tous les pays constitutifs du Royaume-Uni ne l’entendent pas ainsi. L’Écosse, qui était opposée au Brexit, ne souhaite pas modifier le régime réglementaire applicable aux OGM. Or, bien que les dispositions du projet de loi ne s’appliqueront qu’en Angleterre, le principe de reconnaissance mutuelle de la loi sur le marché intérieur du Royaume-Uni fera que les produits entrant sur le marché en Angleterre seront également commercialisables en Écosse (et au Pays de Galles et Irlande du Nord). Pour la ministre écossaise de l’Environnement, Mairi McAllan, cet empiétement sur les compétences dévolues au Parlement écossais est inacceptable [17]. L’Écosse est par ailleurs soucieuse d’éviter des divergences réglementaires avec l’Union européenne qui est le principal partenaire commercial du Royaume-Uni. Elle suivra donc de près l’issue de la consultation publique européenne actuellement en cours et la proposition législative que la Commission européenne a annoncée pour 2023.
Quant au Pays de Galles et à l’Irlande du Nord, ils veulent eux aussi, pour le moment, s’en tenir à la réglementation européenne sur les OGM.
[1] , « Essais en champ des OGM non transgéniques version Brexit », Inf’OGM, 16 mars 2022.
[3] Queen’s speech 2022, 10 mai 2022.
[4] Le Royaume-Uni est constitué de quatre pays que sont l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande du Nord. L’agriculture est une compétence dévolue aux pays, d’où l’application des règles du projet de loi à la seule Angleterre.
[5] Plus précisément, le projet de loi dispose : « « un organisme est « sélectionné avec précision » si –
(a) toute caractéristique de son génome résulte de l’application de la biotechnologie moderne,
(b) chaque caractéristique de son génome qui résulte de l’application de la biotechnologie moderne est stable, et
(c) chaque caractéristique de son génome aurait pu être obtenue par
(i) des processus traditionnels, associés ou non à des techniques de sélection, ou
(ii) d’une transformation naturelle » (notre traduction).
[6] Le projet de loi précise que certaines caractéristiques génétiques n’ont pas à être prises en compte pour déterminer si un organisme aurait pu être obtenu par un processus traditionnel ou apparaître naturellement et, par conséquent, s’il doit être soumis au système réglementaire plus strict des OGM ou s’il peut bénéficier du régime allégé : nombre de copies de gènes, les changements épigénétiques, l’emplacement de la caractéristique dans le génome, etc. La question de savoir si ces caractéristiques mettent en danger la santé humaine et animale ainsi que l’environnement est évacuée alors qu’elle est scientifiquement essentielle…
[8] Thomas, P., The public wants gene-editing regulated – the government should listen, Reaction, 26 mai 2022, (consulté le 22 juin 2022).
[9] Michaels, L. and al., Filling in the blanks : What Defra didn’t say, An alternative analysis of the UK Government’s consultation on the regulation of genetic technologies, A bigger conversation, janvier 2021.
[10] UK Parliament, Commons Chamber, Genetic Technology (Precision Breeding) Bill, Volume 716 : debated on Wednesday 15 June 2022 (consulté le 20 juin 2022).
[11] , « Europe – Les nouveaux OGM sont des OGM comme les autres », Inf’OGM, 25 juillet 2018.
[13] UK Parliament, Commons Chamber, Genetic Technology (Precision Breeding) Bill, op. cit.
[14] Department for environment and rural affairs, Summary of responses to a consultation on the regulation of genetic technologies, 29 septembre 2021.
[15] UK Parliament, Commons Chamber, Genetic Technology (Precision Breeding) Bill, op. cit.
[16] UK Government, Press release : Genetic Technology Bill : enabling innovation to boost food security, 25 mai 2022 (consulté le 9 juin 2022).
[17] Scottish Government, Genetic Technologies (Precision Breeding) Bill : letter to UK Government, 10 juin 2022 (consulté le 22 juin 2022).