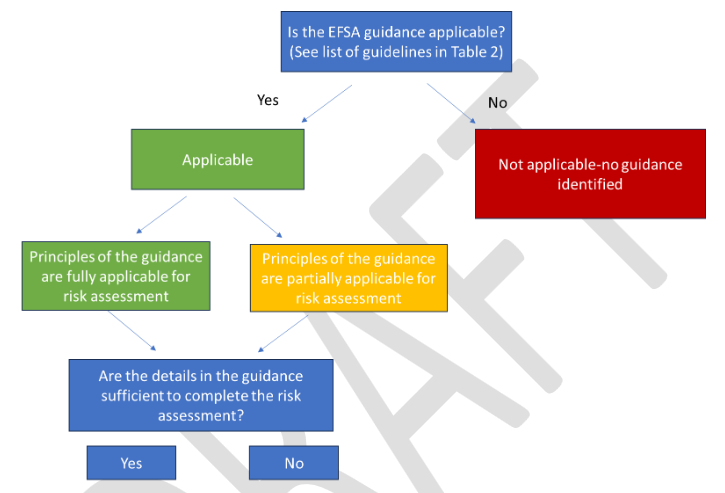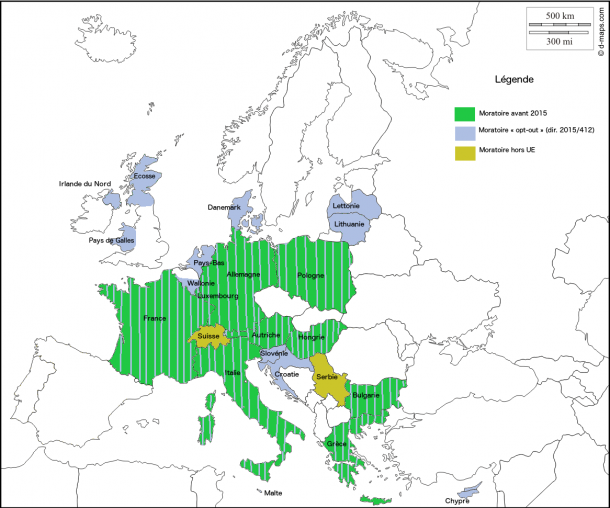Actualités
Mexique – La Cour suprême valide le moratoire sur le maïs OGM

Le Mexique, que ce soit par le décret présidentiel de décembre 2020, par la décision de l’agence d’évaluation des OGM (Cofepris) d’août 2021 ou, plus récemment, par le jugement de la Cour suprême rendu en octobre 2021, renforce son opposition à la culture des maïs transgéniques sur son territoire.
En 2013, un jugement interdit les cultures commerciales et expérimentales de maïs transgéniques au Mexique. L’autorisation avait été donnée par le gouvernement en 2009 et ne concernait alors que des essais en champs sur quelques milliers d’hectares. Depuis, les entreprises avaient contre-attaqué, en vain [1]. Plus d’une centaine d’appels ont été rejetés.
La demande de 2013, qui attend toujours d’être entendue par les tribunaux mexicains, faisait valoir que la Constitution mexicaine garantit le droit à un environnement propre et que la pollinisation croisée du maïs génétiquement modifié menace l’intégrité des variétés de maïs indigènes. Or, ces maïs indigènes doivent être considérés comme une partie importante de cet environnement étant donné la place centrale de cette culture dans les paysages, les cultures et les cuisines du pays. C’est pourquoi les tribunaux ont adopté une injonction de précaution au gouvernement jusqu’à ce que l’affaire puisse être entendue.
Ce combat judiciaire est d’une extrême importance. En effet, le Mexique est largement autosuffisant en maïs blanc, utilisé pour fabriquer les tortillas, mais dépend des importations de maïs jaune, principalement des États-Unis, pour l’alimentation du bétail. Ces importations sont alors largement issues de variétés transgéniques, étant donné qu’aux États-Unis 92 % de la sole du maïs est transgénique.
Un nouveau revers pour l’industrie des biotech
Le 13 octobre 2021, la Cour suprême mexicaine a refusé d’annuler l’injonction préventive adoptée en 2013 [2] [3]. Cette demande en annulation avait été présentée par les entreprises de biotechnologies semencières. A nouveau, la Cour suprême établit clairement que la culture du maïs génétiquement modifié constitue une menace crédible pour la riche biodiversité indigène du Mexique, en raison d’une pollinisation croisée incontrôlable. Elle souligne qu’il » existe des indications fondées de risque, de sorte que, face à l’incertitude et compte tenu de la possibilité de dommages graves et irréversibles à l’environnement, cette chambre considère que, conformément au principe de précaution, la mesure est correcte « .
D’après la coalition « Demanda Colectiva » (le collectif qui a demandé l’injonction de précaution en 2013), la plus grande perte pour les entreprises biotechnologiques est sans doute le retrait du soutien du gouvernement mexicain. En effet, les gouvernements précédents leur avaient apporté leur soutien dans les différents procès. Or, le gouvernement du Président Andrés Manuel Lopez Obrador, élu en 2018, a déposé un mémoire soutenant l’injonction auprès de la Cour suprême.
Cette action n’est pas surprenante. Le 31 décembre 2020 [4], un décret présidentiel a été publié au Journal Officiel [5]. Ce décret interdit la culture du maïs génétiquement modifié et impose l’élimination progressive des importations de maïs génétiquement modifié ainsi que de l’utilisation du glyphosate, l’ingrédient clé de l’herbicide Roundup [6] [7]. D’après Timothy A. Wise, journaliste pour Food Tank (États-Unis) [8], « les entreprises [étasuniennes comme Corteva, Bayer] ont demandé directement à l’administration Biden de considérer les actions du Mexique comme une violation de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM) ». La nouvelle représentante commerciale des États-Unis, Katherine Taï (gouvernement Biden), qui s’est récemment illustrée pour avoir notamment contribué à supprimer le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États de l’ACEUM [9], acceptera-t-elle de résister aux pressions des entreprises ? Son prédécesseur, le Républicain Robert Lighthizer (gouvernement Trump) avait menacé le Mexique de poursuites s’il maintenait son interdiction des maïs OGM, ce qui est conforme à la défense économique des OGM par les gouvernements étasuniens [10].
Enfin, précisons aussi que, fin août 2021, la Cofepris, en charge de l’évaluation sanitaire des OGM, a rejeté la demande de Bayer d’autoriser à l’importation une nouvelle variété de maïs génétiquement modifié. Elle a explicitement cité le principe de précaution [11].
Le jugement de la Cour suprême confirme l’injonction de précaution adoptée en 2013, laquelle ne visait que les cultures de maïs OGM. Cependant, le décret présidentiel adopté en décembre 2020, vise, lui, les cultures et les importations de maïs transgénique. Le rejet de la demande de Bayer d’autoriser à l’importation un maïs transgénique va également dans ce sens. Interdire seulement les cultures ne permettra pas d’éviter les contaminations, comme cela a déjà été montré par plusieurs études, notamment celle d’Ignacio Chapela, en 2001 [12].
[1] , « Mexique : pas encore de maïs OGM dans les champs », Inf’OGM, 7 mars 2017
[2] Communication de la Cour suprême : https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6624
[3] Communiqué de presse de Colectividad Demandante en Defensa del Maíz Nativo : https://drive.google.com/file/d/1fiYbsVGG-0f_orHa0muHACxRxvnbYInA/view
[4] , « Pérou : 15 ans de prolongation du moratoire sur les cultures d’OGM », Inf’OGM, 14 janvier 2021
[6] https://conacyt.mx/cibiogem/index.php/sistema-nacional-de-informacion/documentos-y-actividades-en-bioseguridad/repositorio-glifosato
[7] L’article 6 du décret dit précisément : « Afin de contribuer à la sécurité et à la souveraineté alimentaires et à titre de mesure spéciale pour protéger le maïs indigène, la milpa, la richesse bioculturelle, les communautés paysannes, le patrimoine gastronomique et la santé des Mexicains, les autorités chargées de la biosécurité (…) révoqueront et s’abstiendront d’accorder des permis pour la dissémination de semences de maïs génétiquement modifié dans l’environnement.
De même, les autorités de biosécurité, (…), sur la base de critères de suffisance dans l’approvisionnement en grain de maïs sans glyphosate, révoqueront et s’abstiendront d’accorder des autorisations pour l’utilisation de grain de maïs génétiquement modifié dans le régime alimentaire des Mexicains et des Mexicaines, jusqu’à son remplacement complet à une date qui ne pourra être postérieure au 31 janvier 2024 »
[8] Mexico’s Highest Court Rejects Appeal of GM Corn Ban (La Cour suprême du Mexique rejette l’appel contre l’interdiction du maïs GM), Foodtank, octobre 2021.
[9] Seulement entre les États-Unis et le Canada mais pas entre les États-Unis et le Mexique, https://view.livingstonintl.com/aceum-reglements-des-differends/p/1
[10] , « États-Unis : l’arme de la « science » pour ouvrir les marchés aux OGM », Inf’OGM, 23 juin 2017
[11] Niega México permiso para cultivo de maíz transgénico (Le Mexique rejette l’autorisation de cultiver du maïs génétiquement modifié), Tiempo Digital, octobre 2021.
[12] , « Contamination du maïs mexicain : la controverse scientifique », Inf’OGM, 1er novembre 2003