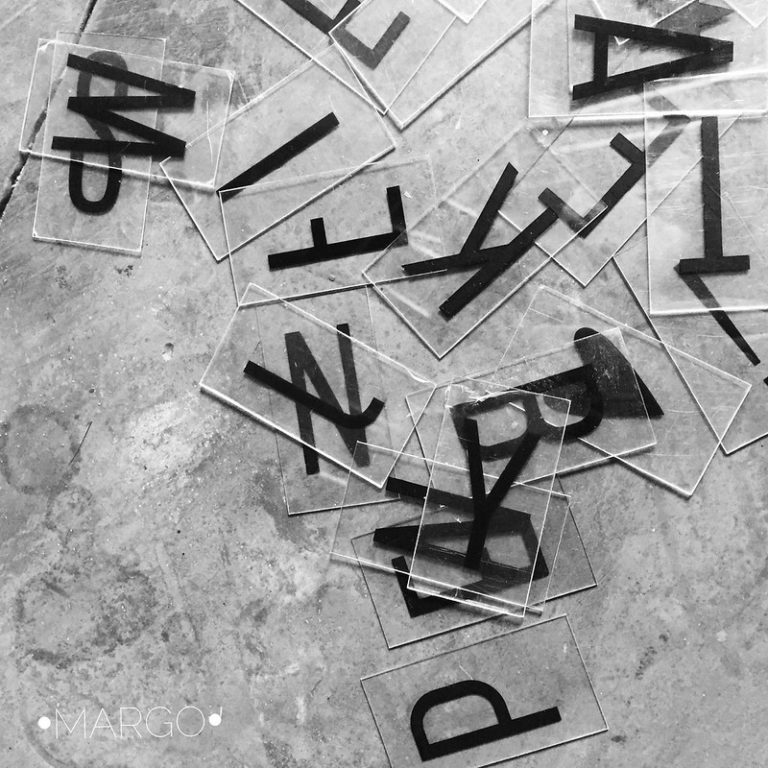Actualités
Vers une nouvelle législation européenne sur les semences ?

Fin 2019, le Conseil de l’Union européenne invitait la Commission à étudier les moyens à disposition pour actualiser la réglementation sur les semences, dans l’optique de formuler d’éventuelles propositions législatives [1]. La publication de cette étude, prévue pour fin 2020, a été retardée. De quoi s’agit-il exactement et où en est-on ?
Le 8 novembre 2019, le Conseil européen a invité la Commission à soumettre, au plus tard le 31 décembre 2020, « une étude sur les moyens à disposition pour actualiser la législation existante relative à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux » [2]. Il l’invitait également à soumettre « une proposition, le cas échéant pour tenir compte des résultats de l’étude ».
Une première tentative de réforme, avortée en 2014
En 2013 déjà, après plus de cinq années de discussions, une tentative de simplification de la législation sur les semences avait été présentée par la Commission européenne [3] : près de 70 textes relatifs à la chaîne de production des denrées alimentaires (semences, mais aussi contrôles officiels, santé animale et végétale, etc.) devaient être remplacés par seulement cinq règlements européens d’application directe dans les États membres [4].
Mais en 2014, le Parlement européen, à deux mois des élections européennes, a rejeté cette proposition, arguant d’un manque de temps pour examiner les nombreux amendements déposés par les députés et d’une crainte d’un manque de souplesse avec un seul règlement semences remplaçant 12 directives sectorielles, organisées auparavant « par filières » [5].
Simplifier et assouplir la législation semences
Pouvoir simplifier la législation sur les semences reste aujourd’hui encore l’un des objectifs de la Commission européenne. Mais derrière cet objectif qui peut paraître louable, se cache en fait un risque de renforcement des grosses entreprises semencières. En effet, assouplir cette législation est une autre demande des États membres, qui comptent bien pouvoir introduire plus facilement certaines évolutions : par exemple, inclure des nouvelles espèces actuellement exclues du champ d’application des directives sur la commercialisation des semences (comme le sarrasin), autoriser les mélanges variétaux, déterminer de nouveaux critères de description biomoléculaires, ou encore légiférer sur les nouvelles techniques de modification génétique (plus connues sous leur sigle anglais NBT – New breeding techniques) [6].
En août 2020 le Commissaire à l’Agriculture, Janusz Wojciechowski, rappelait que « l’un des sujets centraux de cette étude était de faciliter l’enregistrement des variétés traditionnelles et adaptées localement » [7]. On retrouve cet objectif dans au moins deux autres axes forts de la politique européenne : la stratégie « de la ferme à la table » approuvée par le Conseil en octobre 2020 [8] ; et la stratégie européenne de Biodiversité 2030 [9].
Selon Päivi Mannerkorpi, de l’unité pour le matériel de reproduction végétale à la Commission européenne, l’étude concerne également la commercialisation de variétés destinées aux amateurs, l’introduction de nouveaux critères de durabilité pour l’enregistrement des semences aux Catalogues, des expérimentations temporaires sur des approches innovantes, le contrôle… Pour Guy Kastler, de la Confédération paysanne, « la plupart de ces éléments de langage qu’on retrouve dans le « green deal » flattent les aspirations de la société civile en lui promettant quelques libéralisations du marché des semences traditionnelles sur lesquelles elle pourra concentrer ses mobilisations. Mais ils cachent mal la volonté des quatre ou cinq plus grandes firmes semencières (européennes pour la moitié d’entre elles) qui contrôlent 60 % du marché mondial des semences de « libéraliser » toujours plus, c’est-à-dire de supprimer la majorité des restrictions administratives d’accès au marché pour leur laisser le contrôler elles-mêmes grâce à leur puissance logistique et financière, à leurs immenses porte-feuille de brevets sur la quasi totalité des « innovations » technologiques, au fichage génétique généralisé des variétés et des ressources génétiques et aux « autocontrôles sous contrôle officiel » ».
La Commission avance mais a pris du retard
Deux questionnaires ont été lancés en novembre 2020 par le consultant extérieur choisi par la Commission européenne : l’un à destination des jardiniers amateurs, l’autre des semenciers professionnels (mainteneurs et metteurs en marché), dont la date limite de réponse était le 20 novembre 2020. Aucune consultation de la société civile n’a été ouverte.
Lors d’une réunion du Comité permanent sur les plantes, les animaux, l’alimentation et le fourrage, en novembre 2020 [10], la Commission européenne a précisé que le consultant extérieur avait finalisé une série d’entretiens et d’enquêtes avec les acteurs et autorités compétentes et qu’elle en tiendrait compte. Elle a également précisé qu’elle prendrait aussi en compte « les résultats de différentes expérimentations temporaires et de discussions au niveau international (OCDE, Commission économique pour l’Europe des Nations unies, UPOV), y compris pour les fruits et les forêts », même si, pour les forêts, du fait de leur spécificité, le traitement se fera à part. La Commission a précisé à Inf’OGM qu’une enquête de validation des résultats de l’étude avait été menée en janvier auprès des gouvernements, entreprises et associations. Puis l’étude, complétée des réponses anonymes fournies à cette enquête de validation, sera soumise aux États membres, accompagnée du rapport du consultant, dans la seconde moitié d’avril, en même temps qu’il sera transmis au Conseil. La Commission décidera alors des étapes suivantes.
Selon Päivi Mannerkorpi, de la Commission européenne, l’étude sera présentée simultanément à la commission agriculture du Parlement européen, et « si les résultats de l’étude le justifient, la Commission entamera le processus de réalisation d’une étude d’impact, sur laquelle elle fondera sa modification ciblée de la législation sur les semences » [11].
Quelques évolutions possibles, selon la Commission
Päivi Mannerkorpi a présenté quelques points clé d’évolution possible dans un récent article [12] : une forte politique de protection intellectuelle en lien avec le nouveau plan d’action de la Commission sur la propriété intellectuelle [13] ; des modifications ciblées des directives sur le « matériel de reproduction des plantes » (donc des semences et des plants) et un traitement séparé de la directive sur le matériel de reproduction des forêts, et non plus un unique règlement comme dans la proposition rejetée de 2013 ; un enregistrement des variétés qui, pour faciliter l’identité variétale des semences, « s’adapte pour permettre des essais efficaces avec des outils modernes, des procédures et des bases de données efficaces » : une allusion aux marqueurs moléculaires, sans doute.
Elle préconise également d’anticiper sur l’adaptation au changement climatique, en posant une série de question comme « devrait-il y avoir des informations sur le type d’environnement dans lequel les variétés sont adaptées, par exemple une description de la variété ? À long terme : quel serait l’impact si nous déplacions la production agricole vers des environnements protégés tels que les serres ou la production verticale ? ».
Vers une numérisation tous azimuts ?
D’autres questions sont aussi abordées dans cet article, comme la certification publique des semences versus les systèmes privés d’assurance de la qualité des auto-contrôles de « maîtrise » des risques ; la demande des consommateurs sur la base de questions pour le moins orientées comme « demandent-ils des semences de qualité contrôlée ou préfèrent-ils plutôt un plus grand choix de matériel non contrôlé risquant d’être de moindre qualité ? » ; l’adéquation de la nouvelle législation avec une agriculture urbaine, des circuits courts ; et l’utilisation de technologies numériques pour la sécurité des étiquettes sur les semences.
Enfin, Päivi Mannerkorpi conclut ses préconisations sur le big data : « En matière d’informatique, de numérisation et de big data, nous devons effectivement voir grand et nous préparer à l’avenir avec des systèmes communs pour tous les aspects des semences, y compris la protection et l’enregistrement des variétés, la certification des semences et donc améliorer la sécurité de nos systèmes. Nous ne devons pas nous limiter à l’UE mais continuer à coopérer avec l’OCDE, l’UPOV et l’ISTA [14] ».
Nous voilà prévenus !
[1] , « Semences et OGM : des études pour changer la législation de l’UE ? », Inf’OGM, 2 décembre 2019
[2] Décision (UE) 2019/1905 du Conseil du 8 novembre 2019 invitant la Commission à soumettre une étude sur les moyens dont dispose l’Union pour actualiser la législation existante relative à la production et à la mise à disposition sur le marché de matériel de reproduction des végétaux, et une proposition, le cas échéant pour tenir compte des résultats de l’étude.
[3] , « UE : une législation « semences » en pleine évolution », Inf’OGM, 26 septembre 2013
[4] En plus des semences, étaient également concernés les contrôles officiels, la santé des végétaux, la santé animale et le règlement sur le cadre financier de la chaîne alimentaire.
[5] , « UE : une législation « semences » en pleine évolution », Inf’OGM, 26 septembre 2013
[6] Une liste de ces enjeux se trouve dans un article de Päivi Mannerkorpi, chef d’équipe pour le matériel de reproduction végétale à la Commission européenne : « Quality Seed for Professional Use », 26 février 2021.
[7] E-003316/2020 Answer given by Mr Wojciechowskion behalf of the European Commission.
[8] « Les producteurs primaires devraient bénéficier d’un accès plus aisé au marché des races et des variétés traditionnelles adaptées aux conditions climatiques locales et au terroir. [Le Conseil] se félicite, dans ce contexte, que la Commission ait pour objectif de faciliter l’enregistrement des variétés de semences, y compris des variétés utilisées pour l’agriculture biologique », voir paragraphe 23 de Conclusions du Conseil sur la stratégie « De la ferme à la table », Conseil de l’Union européenne, 15 octobre 2020.
[9] « Le déclin de la diversité génétique doit également être enrayé, notamment en facilitant l’utilisation de races et de variétés de culture traditionnelles, ce qui aurait également des effets positifs sur la santé en offrant des régimes alimentaires plus diversifiés et plus nutritifs. La Commission envisage de réviser les règles de commercialisation des variétés traditionnelles afin de contribuer à leur préservation et à leur utilisation durable. La Commission prendra également des mesures pour faciliter l’enregistrement des variétés de semences, notamment dans le cadre de l’agriculture biologique, et faciliter l’accès au marché des variétés traditionnelles et adaptées aux conditions locales », voir paragraphe 2.2.2 de Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions : « Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, Ramener la nature dans nos vies », COM/2020/380 final.
[10] Section semences et propagation du matériel pour l’agriculture et l’horticulture des 26 et 27 novembre 2020.
[11] « Quality Seed for Professional Use », article cité.
[12] Ibid.
[13] Ce plan, dont nous reparlerons prochainement, généralise le fichage génétique des variétés (couvertes par des droits d’obtention végétale), des caractères d’intérêt des plantes (couverts par des brevets sur les informations génétiques) et de toutes les ressources génétiques des plantes. À l’abri des regards du public et hors de cette proposition de la Commission, ces évolutions sont l’objet de travaux discrets de différentes instances internationales (UPOV, OCVV, ISTA, OEB, OMPI, OCDE, TIRPAA, FAO/Codex Alimentarius, CDB…).
[14] UPOV : Union pour la protection des obtention végétale ; et ISTA International Seed Testing Association (Association internationale d’essais de semences).