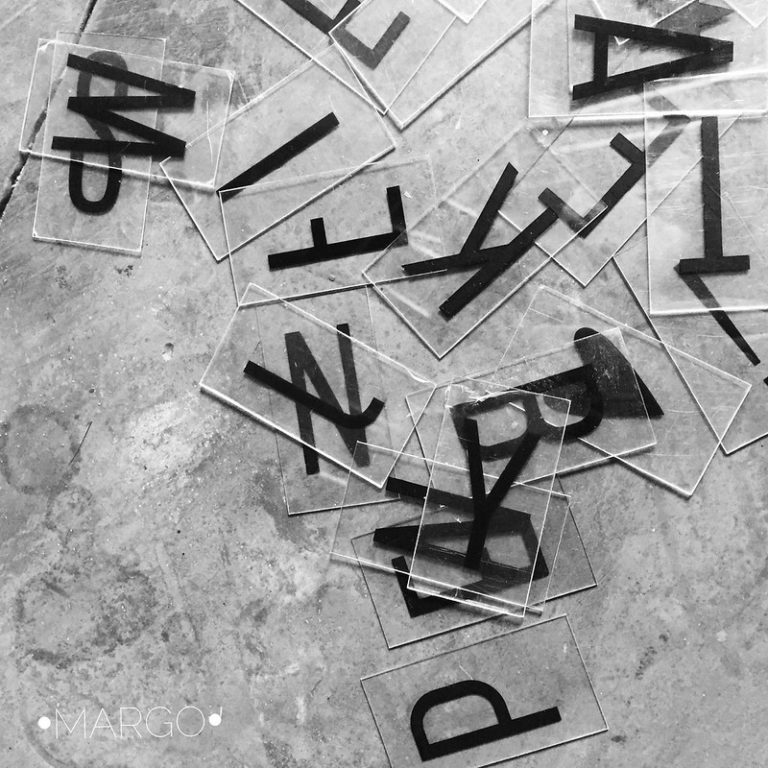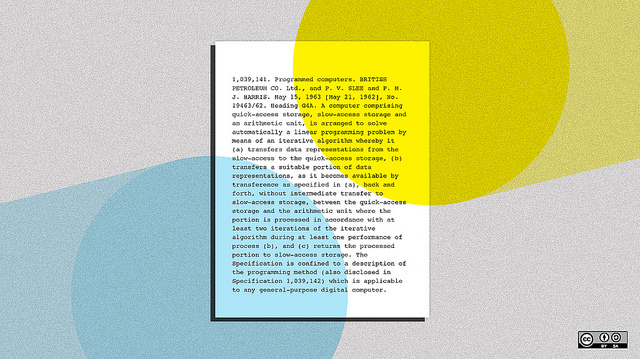Actualités
Séquencer le génome de l’ensemble des êtres vivants sur Terre

La « proposition la plus ambitieuse de l’histoire de la biologie » [1] : les promoteurs du projet de séquençage du génome de l’ensemble des être vivants sur Terre n’y vont pas par quatre chemins. Leur objectif ? « Fournir de nouvelles ressources pour faire face à la perte rapide de la biodiversité, (…) [et fournir de] nouvelles sources de nourriture, des matériaux révolutionnaires bio-inspirés et des innovations pour traiter les maladies des êtres humains, des animaux et des plantes »… Inf’OGM s’est penché sur ce projet de « bibliothèque numérique complète de la vie » qui « déterminer[a] la survie de la vie sur notre planète ». Ambitieux certes, mais potentiellement dangereux, on vous explique pourquoi.
En 2003, après treize années d’efforts et pour un coût de 4,8 milliards de dollars [2], le Projet Génome humain (Human Genome Project) annonçait le décryptage de l’ensemble du génome humain. Lors du Sommet de Davos de 2018, un nouveau projet était annoncé : celui de décrypter le génome de tous les êtres vivants sur Terre, en dix ans, et pour une somme de 4,7 milliards de dollars, ce qui, au passage, en dit long sur la chute drastique du coût de séquençage [3]. Ce projet, appelé EarthBioGenome Project (EBP), était né en novembre 2015, au Smithsonian Institution, institution publique de recherche scientifique à Washington (États-Unis) (voir encadré ci-dessous).
Séquencer le génome de tous les êtres vivants : pour quoi faire ?
Le nombre exact d’espèces d’êtres vivants sur terre est inconnu. On estimait en 2014 le nombre d’espèces d’eucaryotes (c’est-à-dire avec une cellule délimitée par une membrane et possédant un noyau) entre 10 et 15 millions [4] (dont seuls 1,5 million sont connues), dont 7,77 millions d’espèces animales et 300 000 végétales. Ce sont ces 1,5 million d’espèces connues d’eucaryotes qui sont visées dans ce projet, le génome des autres, les procaryotes, étant étudié dans le cadre d’un autre projet, le Earth Microbiome project [5].
On se doute que pour se lancer dans une telle initiative, de nombreux objectifs sont mis en avant. Ils vont depuis l’acquisition de connaissances sur la biologie, les écosystèmes et l’évolution, jusqu’aux bénéfices pour le bien-être humain (santé, agriculture, biomatériaux…), en passant par la protection de l’environnement et de ces êtres vivants [6].
Gene Robinson, co-manager de EBP, a récemment détaillé ces objectifs à nos confrères de The News Gazette [7] : « nous pouvons fournir essentiellement une nouvelle bibliothèque, une bibliothèque des plans de la vie, qui servira de base pour extraire les connaissances nécessaires à la découverte de nouveaux médicaments, à la découverte de nouveaux aliments, à une meilleure compréhension de la manière dont les organismes font face aux changements climatiques, comprendre l’évolution de la vie sur cette planète ». Rien que ça !
Mais le projet fait surtout miroiter des retombées financières phénoménales, à partir d’extrapolations aussi simples qu’invérifiables : on a séquencé aujourd’hui le génome de seulement 0,2 % des eucaryotes ; et les revenus annuels aux États-Unis des plantes et microbes génétiquement modifiés se monteraient déjà à 300 milliards de dollars, soit 2 % du PIB [8]. Les promoteurs du projet soulignent également que si le gouvernement étasunien a investi trois milliards de dollars pour décrypter le génome humain, les retombées économiques sont déjà chiffrées à plus de… mille milliards de dollars, là encore, un chiffre invérifiable [9] ! Bref, la démonstration serait faite : de gros bénéfices sont à attendre de ce décryptage général des génomes des êtres vivants.
Qui est impliqué dans le projet EBP ?
En février 2017, le Smithsonian Institution et le Beijing Genomics Institute (BGI, Chine), le plus grand centre (public-privé) de séquençage au monde, s’accordent sur le Earth BioGenome Project, avec une feuille de route sur dix ans. Et le 1er novembre 2018, le projet a été officiellement lancé [10] à Londres, en collaboration avec le projet Darwin Tree of Life Project, en Grande-Bretagne, qui va séquencer l’ensemble des espèces présentes sur le sol britannique.
Dix-sept institutions de différents pays (États-Unis, Royaume-Uni, Chine, Allemagne, Danemark, Brésil…), ainsi que quinze communautés scientifiques internationales, participent à ce projet [11], harmonisant les méthodes de séquençage des génomes de différents groupes d’être vivants, séquençages souvent déjà enclenchés dans le cadre d’autres projets : poissons, oiseaux, insectes [12] (dont fourmis [13]), plantes [14], champignons [15]… À noter qu’il existe aussi de nombreux programmes de séquençages du génome des êtres humains, à des fins thérapeutiques ou de médecine préventive (par exemple, ablation des seins en cas de présence d’un gène associé au cancer du sein). C’est le cas du projet étasunien « All of Us » du NIH (National institute of health – institut national de la santé), lancé en mai 2018, qui vise à séquencer un million d’individus, dont ceux jusqu’à présent sous-représentés [16]. C’est aussi le cas, en France, avec le plan « France Médecine Génomique 2025 » [17] lancé en 2016, et la création de douze plateformes de séquençage à haut débit du génome couvrant l’ensemble du territoire…
Le projet implique une vaste collecte d’échantillons de tous les être vivants, d’où l’ambition de travailler avec différentes institutions qui gèrent la sauvegarde de la biodiversité, les jardins botaniques, les zoos, aquariums et autres muséums d’histoire naturelle. Mais les promoteurs du projet chercheront également la collaboration de « chercheurs citoyens », en surfant sur la vague des projets participatifs, ainsi que le déploiement de nouvelles technologies robotisées pour collecter les échantillons. Dont des drones aériens, terrestres et aquatiques, avec identifications à distance et séquenceurs d’ADN incorporés !
Données génomiques : les stocker, y accéder… et les pirater ?
Pour les promoteurs du projet, le volume de stockage de l’ensemble de ces données ne devrait pas poser de problème : les 20 pétabytes (1015 bytes) nécessaires les trois premières années du projet représentent l’ensemble des données traitées par Google chaque jour [18]. Et les 200 pétabytes de stockage nécessaires au bout des dix ans ont déjà été dépassés par le Cern [19], sans compter, nous disent les promoteurs, avec toutes les innovations de stockage à venir.
Ces problèmes techniques évacués, reste à s’interroger sur l’accès aux échantillons, leur propriété et le devenir, breveté ou non, des éventuelles innovations qui en seront tirées.
Car depuis la Convention sur la biodiversité (CBD) [20], les ressources génétiques sont sous la souveraineté des États qui les abritent. Et le Protocole de Nagoya [21], appendice de la CBD, oblige les bénéficiaires de ces échantillons à reverser une partie des avantages qu’ils en auront tirés (si leur pays est adhérent au Protocole). Même obligation dans le cadre du Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation (Tirpaa), à la seule différence que le reversement est géré dans le cadre d’un accord type global, et non plus ressource par ressource [22].
Le projet EBP mentionne ces exigences d’accès et de reversement des bénéfices : « L’EBP adhérera aux principes du Protocole de Nagoya (…). L’EBP a pour objectif spécifique de fournir un accès juste, équitable, ouvert et rapide aux avantages des génomes eucaryotes de la planète Terre, ainsi que leur partage » [23]. Essentielles, mais apparemment sans qu’il y ait le besoin de créer d’autres standards ou garde-fous pour éviter des appropriations indues…
D’après un article de Up Mag’, « la base de données d’informations génétiques serait construite en recourant à la technique de la blockchain, (…) [afin] d’identifier précisément toutes les transactions opérées et rémunérer à leur juste part les acteurs du processus. (…) L’accès à la banque des codes génétiques équivaudrait alors à signer un contrat numérique permettant de suivre à la trace toutes les utilisations ultérieures des connaissances obtenues. Si une telle utilisation était commerciale, il serait ainsi possible de transférer un paiement automatique aux propriétaires désignés des données utilisées » [24]. Contacté sur les garanties apportées, Harris A. Lewin, de l’Université de Californie, (Davis), responsable du projet, répond laconiquement à Inf’OGM : « Le projet Earth BioGenome s’engage à suivre le protocole de Nagoya et à mettre en place des mécanismes visant à garantir le respect de la propriété traditionnelle tout en permettant le développement de nouvelles connaissances. Les dirigeants de l’EBP travaillent activement sur cette question et en auront plus à dire dans les mois à venir… ». Dont acte !
Redoubler de vigilance pour protéger le bien commun
Deux types de critiques sont apportées à ce projet. Tout d’abord, sur le fond même du projet. Séquencer le génome des être vivants pour comprendre le vivant peut s’avérer illusoire, ou du moins très insuffisant : depuis les dogmes initiaux de la génétique, les scientifiques ont découvert l’épigénétique. Cette science montre que l’ADN n’est pas tout et que deux génomes aux gènes semblables peuvent générer des caractéristiques différentes, selon la conformation des gènes et les diverses molécules qui y sont attachées (méthylation par exemple). L’EBP ne serait dès lors qu’une étape vers la réelle compréhension du vivant.
L’autre critique concerne la propriété du vivant. Elle est exprimée entre autres par Lili Fuhr, de la Fondation allemande Heinrich Boell : « Si nous n’agissons pas maintenant (…), nous pourrions nous réveiller un jour et nous rendre compte que tout l’ADN des êtres vivants est décodé, placé dans une seule base de données et exploité à des fins commerciales et pour la création d’organismes synthétiques » [25]. Plane ici le spectre des séquences génomiques brevetées empêchant, entre autres, les paysans de les utiliser, comme ce fut le cas en France pour le semencier Gautier avec ses laitues [26].
Finalement, on comprend mieux que ce projet – que ses promoteurs qualifient d’« économie inclusive » et de « quatrième révolution industrielle » – ait été annoncé lors du Forum économique de Davos de 2018. Prévenus, les citoyens devront redoubler de vigilance pour éviter cette spoliation du patrimoine génétique de l’humanité, notre bien commun.
[1] Les citations non référencées de cet article sont tirées de « Earth BioGenome Project : Sequencing life for the future of life », Harris A. Lewin, et al. PNAS April 24, 2018 115 (17) 4325-4333 ; first published April 23, 2018 https://doi.org/10.1073/pnas.1720115115, Edited by John C. Avise, University of California, Irvine, CA, and approved March 15, 2018 (received for review January 6, 2018), https://www.pnas.org/content/115/17/4325#ref-10
[2] En tenant compte de l’inflation.
[3] En 2014, la société Illumina affirmait être en mesure de décrypter les 3 milliards de paires qui composent le génome humain pour 1000 dollars. La startup Complete Genomic (d’abord californienne puis rachetée par BGI-Shenzhen, une entreprise chinoise de séquençage) affirme pouvoir faire baisser le coût d’un séquençage à 100 dollars.
[4] « Earth BioGenome Project : Sequencing life for the future of life », article cité
[5] Gilbert JA, Jansson JK, Knight R, (2014) The Earth Microbiome project : Successes and aspirations. BMC Biol 12:69.
[6] Voir : « Earth BioGenome Project : Sequencing life… », article cité
[7] Campus Conversation : Gene Robinson, Julie Wurth, 24 juillet 2019, https://www.news-gazette.com/news/campus-conversation-gene-robinson/article_c94efeae-b5e9-5609-a7aa-b5d24c3809fd.html
[9] Wadman M, (2013) Economic return from Human Genome Project grows. Nature doi:10.1038/nature.2013.13187.
[10] https://www.ucdavis.edu/news/international-consortium-officially-launches-earth-biogenome-project-london
[12] i5K Consortium (2013-09-01). « The i5K Initiative : advancing arthropod genomics for knowledge, human health, agriculture, and the environment ». The Journal of Heredity. 104 (5) : 595–600. doi:10.1093/jhered/est050. PMC 4046820. PMID 23940263.
[13] Global Ant Genome Alliance (GAGA).
[14] 10,000 Plant Genomes Project (10KP), voir : Cheng S, Melkonian M, Smith SA, Brockington S, Archibald JM, Delaux PM, et al. (March 2018). « 10KP : A phylodiverse genome sequencing plan ». GigaScience. 7 (3) : 1–9. doi:10.1093/gigascience/giy013. PMC 5869286. PMID 29618049.
[17] https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/recherche-et-innovation/france-genomique
[18] Il semble vraisemblable que dans quelques années, les disques durs de nos ordinateurs aient des capacités de un pétabyte de stockage (source : https://www.vingthuitzerotrois.fr/technologie/quest-quun-petabyte-13210/)
[19] L’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, voir https://home.cern/about/updates/2017/07/cern-data-centre-passes-200-petabyte-milestone
[20] , « Convention sur la diversité biologique : nouveaux OGM en débat », Inf’OGM, 8 novembre 2017
[23] Voir : « Earth BioGenome Project : Sequencing life… », article cité
[24] http://up-magazine.info/index.php/bio-innovations/bio-innovations/7374-davos-lancement-de-la-banque-du-vivant
[25] Digital Sequence Information : The Earth BioGenome Project and the Earth Bank of Codes, Lili Fuhr, Heinrich Boell Foundation, ECO, vol 56, issue 3, 4 juillet 2018, http://cbd-alliance.org/sites/default/files/documents/ECO-3-SBSTTA-22.pdf
[26] , « FRANCE – Propriété industrielle sur les plantes : « halte aux brevets trop larges » recommande le CEES », Inf’OGM, 20 juin 2013