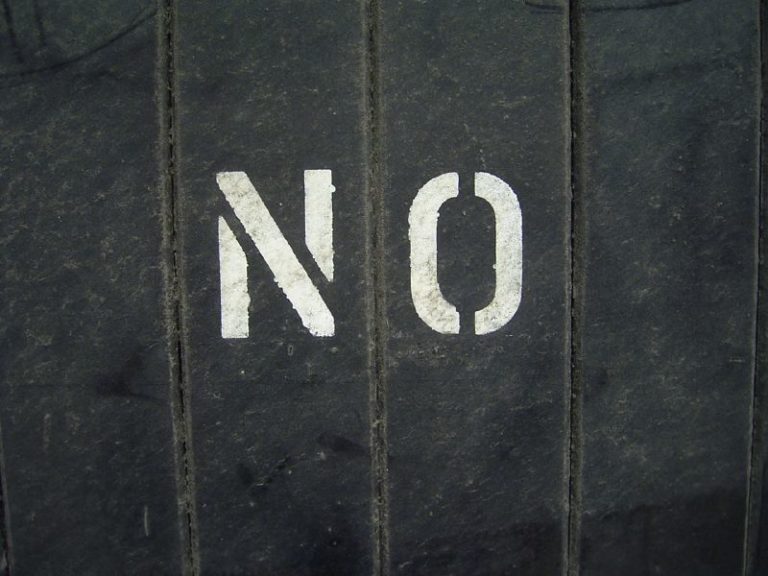Actualités
La Commission européenne confond transparence et confidentialité (1/2)
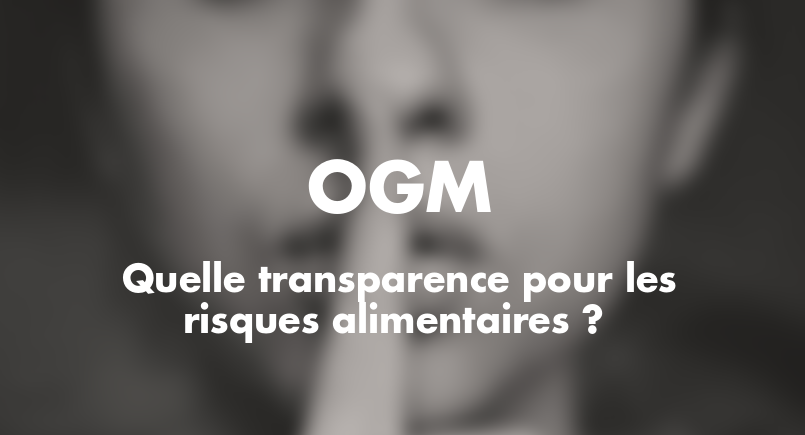
La tension entre l’exigence de transparence et la confidentialité d’informations au nom de la protection de certains intérêts est bien connue en matière d’OGM et de sécurité alimentaire. Et ce n’est pas toujours la transparence qui gagne. La proposition de la Commission européenne pour réviser la législation alimentaire générale en est une nouvelle illustration.
Le 11 avril 2018, la Commission européenne a présenté une proposition législative destinée à améliorer la transparence et l’indépendance dans la procédure d’évaluation des risques des aliments. Mais dans les faits, cette proposition renforce la confidentialité et réduit la transparence existante dans le dossier OGM.
Juridiquement, cette proposition, présentée notamment comme une réponse à l’initiative citoyenne européenne (ICE) « Stop glyphosate » [2] [3], vise à modifier le règlement sur la législation alimentaire générale mais aussi des directives et règlements portant sur des domaines alimentaires précis, parmi lesquels les OGM [4].
L’enjeu est de taille : pour la Commission européenne, il s’agit d’éteindre les incendies allumés avec les dossiers OGM et glyphosate par exemple, en essayant de prouver la qualité du travail de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) qui est régulièrement visée par des conflits d’intérêts. Pour les entreprises, il s’agit de profiter de l’occasion pour obtenir une confidentialité plus large des données soumises dans les dossiers de demande d’autorisation. Et pour la société civile, il s’agit d’obtenir une amélioration de la transparence.
La proposition de la Commission couvre donc toute une panoplie de mesures, allant de la communication sur les risques à la composition du Conseil d’administration de l’AESA. Mais un constat s’impose : derrière l’intention de transparence affichée, il y a surtout une proposition de renforcement des règles de confidentialité [5] [6].
Divulgation accrue d’informations ? En apparence seulement
Suite aux demandes des citoyens et des organisations de la société civile, la Commission propose d’élargir le champ des informations rendues publiques par l’AESA. À côté de la création d’un registre des études commandées par les entreprises (voir encadré ci-dessous) pour lequel les modalités d’accès ne sont pas connues, la Commission propose que les données et les études scientifiques accompagnant les demandes d’autorisation de mise sur le marché soient rendues publiques de manière proactive [7].
Un registre européen des études commandées par les entreprises
La Commission européenne propose de créer un registre des études commandées par les entreprises qui sera géré par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA). Ce registre est censé garantir que les entreprises fournissent toutes les études qu’elles ont réalisées, quel que soit leur résultat. Selon la proposition, les opérateurs économiques doivent ainsi notifier « sans délai » à l’AESA « l’objet de toute étude » commandée à l’appui d’une future demande d’autorisation.
Une mesure qui, dans la rédaction actuelle, a peu de chances d’être efficace. Car l’obligation de notification pourrait être aisément contournée en faisant passer les études réalisées comme des étapes de recherche et non d’une future demande d’autorisation. Surtout, seul « l’objet d’une étude » commandée doit être notifié, et non pas le résultat de l’étude. Or seule l’information notifiée sera rendue publique (si une demande d’autorisation est effectivement déposée et sous réserve des règles de confidentialité…). Le registre est donc plutôt un registre des commandes passées qu’un registre des études. Par ailleurs, il faudra être patient pour connaître les sanctions en cas de non-respect de l’obligation de notification, car la Commission européenne propose que ce soit l’AESA qui le précise dans ses règles internes.
La divulgation de ces informations est évidemment une bonne chose. Mais son apport est à nuancer fortement car, en parallèle, la Commission propose une liste assez large d’informations à considérer comme… confidentielles !
Il est ainsi précisé que la divulgation des données et études scientifiques accompagnant les demandes d’autorisation se fait sans préjudice de « tout droit de propriété intellectuelle pouvant exister sur les documents ou leur contenu » et « des éventuelles dispositions figurant dans la législation alimentaire de l’Union qui protègent les investissements réalisés par des innovateurs dans le cadre de la collecte des informations et des données étayant les demandes d’autorisation concernées (“règles concernant l’exclusivité des données”) ».
Et le citoyen devra se contenter de lire l’information divulguée. Car la divulgation de ces données ne vaut pas autorisation de les utiliser, de les reproduire ou de les exploiter sous une autre forme. Pour cela, il faut obtenir l’accord de l’entreprise. Des règles qui s’appliquaient déjà mais qui ne figuraient pas dans la législation alimentaire générale [8] [9]. Les inscrire dans ce texte n’est cependant pas anodin. Elles apparaissent ainsi comme la contre-partie à la divulgation proactive d’informations. Mais surtout comme une mise en garde qui pourrait avoir un effet dissuasif [10] [11].
Mais même si l’information divulguée pouvait être utilisée plus facilement, il n’est pas sûr qu’elle puisse être exploitée pour autant. D’une part, du fait de leur format. Car les informations (données et études scientifiques fournies par les entreprises notamment) seront publiées sur le site de l’AESA a priori dans le format PDF [12]. Or, ce format contraint les scientifiques à re-saisir les données pour pouvoir les analyser (on parle de dizaines de pages contenant des milliers de chiffres) [13]…
Des règles de confidentialité renforcées
D’autre part, le contenu même des informations pourrait priver d’intérêt leur utilisation. Aujourd’hui déjà, certaines informations ne sont pas divulguées. Ainsi, quand une entreprise dépose une demande d’autorisation de mise sur le marché d’OGM, elle peut demander un traitement confidentiel de certaines informations, en apportant une justification de cette demande. Certaines informations ne peuvent pas rester confidentielles. C’est le cas par exemple des informations sur la description générale de l’OGM (directive 2001/18 et règlement 1829/2003), sur l’évaluation des risques pour l’environnement (directive 2001/18), sur les effets de l’OGM sur la santé humaine ou animale ou l’environnement (règlement 1829/2003), ou sur les caractéristiques physico-chimiques et biologiques de l’OGM (règlement 1829/2003).
Mais avec la proposition législative de la Commission européenne, le champ de la confidentialité s’étendrait. Les entreprises pourront en effet demander que certaines informations ne soient pas divulguées si « la divulgation cause un préjudice sérieux aux intérêts concernés ». Jusqu’ici, en matière d’OGM, le seul motif qui pouvait justifier la confidentialité était l’atteinte à la position concurrentielle de l’entreprise… Et c’est l’AESA qui statuerait sur la confidentialité (voir encadré ci-dessous).
L’Autorité européenne de (…)
L’Autorité européenne de sécurité des aliments statue sur la confidentialité
Jusqu’à présent, c’était soit l’autorité nationale compétente saisie de la demande d’autorisation de mise sur le marché, soit la Commission européenne, qui statuait sur la demande de confidentialité de l’entreprise. Si la proposition de la Commission aboutit, ce sera désormais à l’Autorité européenne de sécurité des aliments de statuer sur cette demande, par une décision motivée qui ne sera pas rendue publique [14]…
Surtout, la Commission propose d’insérer dans la législation alimentaire générale une liste limitative d’informations dont la confidentialité peut être demandée par les entreprises, liste qui viendra s’ajouter aux informations dont la confidentialité peut être demandée sur le fondement de la législation spécifiquement applicable aux OGM. Or cette liste contient des informations permettant de savoir quelle méthode a été utilisée pour obtenir telle ou telle plante, et donc qui sont essentielles dans le contexte de l’essor des nouvelles techniques de modification génétique.
Une entreprise pourra ainsi demander que « la méthode et les autres spécifications techniques et industrielles relatives à cette méthode » ou encore la « composition quantitative » du produit soient traitées comme des informations confidentielles. Ces informations permettent pourtant aux citoyens, obtenteurs et agriculteurs de savoir à quel produit ils ont à faire… Elles sont également précieuses pour pouvoir tracer le lien entre le produit et l’éventuel brevet qui le couvre.
Mais la Commission européenne ne s’arrête pas là. Car au titre de la législation spécifiquement applicable aux OGM, une entreprise pourra en plus demander que les informations relatives aux séquences d’ADN et les « modèles et stratégies d’amélioration » ne soient pas divulgués [15]. La plupart de ces informations sont pourtant publiées dans le cadre d’un brevet. Et il serait particulièrement malvenu de pouvoir les rendre confidentielles à l’heure où les entreprises sont déjà peu enclines à révéler la méthode utilisée pour obtenir les plantes qu’elles mettent sur le marché et sont soucieuses de faire échapper les produits issus des nouvelles techniques de modification génétique de la réglementation applicable aux OGM… Car comment les citoyens pourront-ils s’assurer qu’un produit issu d’un OGM est bel et bien soumis à la réglementation dédiée si la méthode qui permet de l’obtenir n’est pas rendue publique ?
Face à cela, les garanties proposées paraissent peu efficaces. Le texte prévoit par exemple que « si une action urgente est essentielle pour protéger la santé publique, la santé animale ou l’environnement, comme dans des situations d’urgences, l’Autorité peut divulguer l’information […] ». Or cette disposition répond à des cas exceptionnels, et une divulgation d’informations dans une situation d’urgence sera trop tardive pour assurer une protection efficace de la santé publique ou animale ou de l’environnement.
[1] Dans le cadre du règlement 1829/2003, c’est la Commission qui statue sur la demande. Dans le cadre de la directive 2001/18, c’est l’autorité nationale compétente à laquelle une demande de dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement a été notifiée.
[2] , « Stop Glyphosate, une Initiative citoyenne européenne utile », Inf’OGM, 12 avril 2018
[3] La principale demande de cette initiative, l’interdiction des herbicides à base de glyphosate, n’avait pas abouti. Fin 2017, la Commission s’était cependant engagée à présenter une proposition législative pour répondre aux critiques concernant le manque de transparence de l’évaluation des risques réalisée par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, un point également soulevé dans l’initiative citoyenne.
[4] Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’UE dans la chaîne alimentaire, modifiant le règlement (CE) nº178/2002 [relatif à la législation alimentaire générale], la directive 2001/18/CE [relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement], le règlement (CE) nº 1829/2003 [concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés], le règlement (CE) nº1831/2003 [relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux], le règlement (CE) nº2065/2003 [relatif aux arômes de fumée], le règlement (CE) nº1935/2004 [concernant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires], le règlement (CE) nº1331/2008 [établissant une procédure d’autorisation uniforme pour les additifs, enzymes et arômes alimentaires], le règlement (CE) nº1107/2009 [concernant les produits phytopharmaceutiques] et le règlement (UE) 2015/2283 [relatif aux nouveaux aliments].
[5] Déjà dans la réponse de la Commission européenne à l’initiative citoyenne apparaissait la tension entre transparence d’une part et protection d’informations commerciales confidentielles d’autre part. La Commission européenne affirmait en effet que la transparence serait accrue « tout en respectant les principes énoncés dans le traité en matière de protection des informations commerciales confidentielles légitimes y compris des mesures telles que l’accès public aux données brutes des rapports d’études visant à limiter la nécessité pour les parties intéressées de recourir à des procédures d’accès à des documents » . Commission européenne, Communication de la Commission relative à l’initiative citoyenne européenne « Interdire le glyphosate et protéger la population et l’environnement contre les pesticides toxiques », 12 décembre 2017.
[6] Le présent article traite de l’accès aux informations marqué par un renforcement des règles de confidentialité. Dans un second article, nous verrons les autres changements proposés relatifs au fonctionnement de l’Autorité européenne de sécurité des aliments.
[7] Ces informations sont aujourd’hui accessibles sur demande. D’autres informations jusque-là non rendues publiques seraient publiées. C’est le cas notamment des données scientifiques et des informations accompagnant les demandes d’avis scientifique formulées par le Parlement européen, la Commission et les États membres.
[8] Par exemple, en janvier 2013 lors de la mise en ligne du dossier de demande d’autorisation de mise sur le marché du maïs NK603 de Monsanto, l’Autorité européenne de sécurité des aliments demandait aux internautes de signer un accord relatif aux droits d’auteur. Dans cet accord, il était prévu qu’il était de la responsabilité de toute personne ou organisme souhaitant diffuser ce dossier, librement et légalement obtenu via le site de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, de contacter Monsanto pour obtenir l’autorisation de l’entreprise.
[9] , « UE – Tandis que l’AESA publie les données du maïs NK603, sous forme non exploitable, Séralini remet les siennes à un huissier », Inf’OGM, 17 janvier 2013
[10] On pourrait voir dans cette inscription une réaction aux conséquences de la publication du dossier de demande d’autorisation du maïs NK603 sur le site de l’Autorité européenne de sécurité des aliments en janvier 2013. Monsanto avait alors menacé l’Autorité de poursuites judiciaires.
[11] ,
, « UE – Transparence des données sur les OGM : Monsanto s’oppose à l’AESA », Inf’OGM, 14 mars 2013
[12] La proposition de la Commission européenne précise que « Les éléments pertinents peuvent être téléchargés, imprimés ou faire l’objet d’une recherche dans un format électronique ».
[13] Selon la proposition de la Commission européenne, l’Autorité européenne de sécurité des aliments est chargée de fixer les modalités pratiques des règles de transparence dans son règlement intérieur. Notons par ailleurs que rien ne garantit que les données seront accessibles sans restriction, c’est-à-dire que la divulgation ne sera pas subordonnée à la création d’un compte personnel, sécurisé par un identifiant et un mot de passe, qui permettrait de savoir qui a accès aux données.
[14] Dans le cadre du règlement 1829/2003, c’est la Commission qui statue sur la demande. Dans le cadre de la directive 2001/18, c’est l’autorité nationale compétente à laquelle une demande de dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement a été notifiée.
[15] Selon la proposition de la Commission européenne, les informations relatives aux séquences d’ADN utilisées à des fins de détection, d’identification et de quantification de l’événement de transformation ne pourront pas être confidentielles.