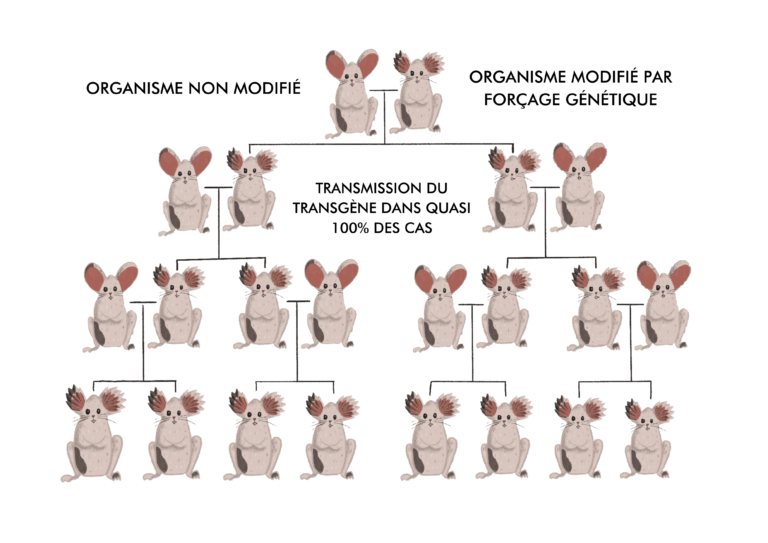Des OGM au service de la santé humaine ?

Les OGM constituent des outils de recherche fondamentale pour étudier divers processus biologiques. Mais les technologies OGM sont aussi beaucoup utilisées à des fins médicales, qu’il s’agisse là encore de recherche ou d’applications pharmaceutiques. État des lieux.
Le principal domaine d’utilisation des biotechnologies à des fins médicales concerne la production de protéines d’intérêt pharmaceutique. Les protéines – codées par des gènes – sont de très grosses molécules qu’il n’est pas possible de synthétiser chimiquement in vitro. Il faut alors les extraire et les purifier à partir des organismes qui les fabriquent naturellement, ce qui est souvent techniquement difficile et insatisfaisant en termes de quantités obtenues. De plus, ce procédé est également source de risques sanitaires importants en raison d’éventuels agents infectieux qui peuvent accompagner la protéine d’intérêt lors du processus d’extraction (en particulier à partir d’animaux). Dans un certain nombre de cas, l’une des technologies OGM – la transgenèse – a offert la possibilité de produire de telles protéines d’intérêt avec de très gros rendements tout en s’affranchissant des risques d’infections croisées. La technique consiste à introduire dans des cellules receveuses le gène (appelé alors transgène) codant la protéine d’intérêt (qui peut être d’origine animale, végétale, voire microbienne) et à multiplier les cellules transgéniques ainsi obtenues dans des fermenteurs (c’est-à-dire en milieu confiné). Ces cellules expriment alors le transgène comme s’il leur appartenait et fabriquent la protéine d’intérêt en question – appelée protéine recombinante – laquelle peut alors être extraite et purifiée avant d’être conditionnée sous forme de médicament.
Des protéines médicaments : sans risque ?
La première protéine recombinante d’intérêt pharmaceutique ainsi obtenue, dès le début des années 1980, est l’insuline humaine pour soigner les diabétiques, produite dans la bactérie Escherichia coli. Depuis, de très nombreuses protéines-médicaments sont produites par ce procédé : hormone de croissance, EPO (traitement des insuffisances rénales), facteurs de coagulation, interleukines (traitement de certains cancers)… Les cellules utilisées ne sont pas toujours des bactéries ; il s’agit aussi de levures (champignons unicellulaires, comme la levure de boulanger), de cellules de mammifères (d’ovaires ou de reins de hamster, cellules humaines de rétine, cellules humaines cancéreuses du col de l’utérus), de cellules d’ovaires d’insectes, de cellules souches embryonnaires aviaires… On trouvera en page 14 les projets pour produire des protéines-médicaments dans des plantes transgéniques cultivées en plein champ ou encore dans le lait, le sang ou le plasma séminal d’animaux transgéniques.
Mais cette approche n’est pas idéale et sans risque. Il y a des exemples où des doutes sérieux persistent. C’est le cas notamment du vaccin recombinant contre l’hépatite B (Engerix B) qui a été produit dans la levure de boulangerie, et qui est soupçonné d’être lié à l’apparition de sclérose en plaques chez un certain nombre de patients. Certes, l’origine de ce supposé lien de causalité n’a pas été élucidée et nous ne savons pas si cela pourrait être dû au mode d’obtention du vaccin, c’est-à-dire à la technique de transgenèse elle-même (par exemple un mauvais repliement de la protéine vaccinale recombinante dans les cellules de levure) ; ou à d’autres facteurs tels que la présence d’hydroxyde d’aluminium dans les adjuvants de ce vaccin (autre hypothèse avancée).
Un autre vaccin recombinant, contre les rotavirus responsables de nombreuses diarrhées à travers le monde, a été retiré en catastrophe en juillet 1999, quelque mois seulement après avoir été autorisé aux États-Unis, parce que des nourrissons vaccinés étaient atteints de diverticulose. Là encore, on n’a pas la preuve que c’est dû au mode de production de la protéine vaccinale recombinante. Mais le principal problème de cette approche est l’absence de contrôle du repliement de la protéine recombinante dans la cellule hôte. Or le repliement d’une protéine dans l’espace est tout aussi important pour sa fonctionnalité que sa formulation chimique.
Une protéine bien repliée
Si le gène détermine l’assemblage – et donc la formulation chimique – d’une protéine, il ne contrôle pas son repliement qui lui, est déterminé essentiellement par l’environnement cellulaire (pH, concentration en sels, etc.), lequel n’est bien sûr pas le même pour la cellule hôte que pour la cellule qui fabrique naturellement cette protéine dans la nature. Or une protéine mal repliée peut avoir des effets anodins mais peut aussi avoir de graves conséquences (maladies à prions telles que la vache folle, Creutzfeldt-Jakob, tremblante du mouton…). Je ne dis pas que toutes les protéines mal repliées font des prions, mais prions pour qu’elles se replient bien…
Par ailleurs, une fois son repliement terminé, la protéine peut faire l’objet de modifications chimiques secondaires (dites « post-traductionnelles ») telles que des ajouts de sucres, de phosphates, qui peuvent être nécessaires à sa fonctionnalité, à son activité, ou lui conférer des propriétés particulières telles que des propriétés immunogènes. Là encore, on n’aura jamais la certitude que ces modifications post-traductionnelles (qui ne sont pas « dictées » par le gène) sont absolument identiques dans les cellules de l’organisme transgénique à ce qu’elles sont dans les cellules où la protéine est naturellement fabriquée.
Des animaux transgéniques au service de la médecine ?
De nombreux animaux génétiquement modifiés, et notamment transgéniques, sont utilisés dans les laboratoires de recherche médicale pour servir de modèles à l’étude de maladies humaines. Ce sont essentiellement des lapins, parfois des souris et toujours en milieu confiné. À titre d’exemples, des souris transgéniques sont utilisées pour étudier ce qu’on appelle « les maladies à prions » (Creutzfeld-Jacob…), et des lapins sont utilisés comme modèles pour l’étude de l’athérosclérose, de la mucoviscidose, de l’infection par le virus du Sida, etc.
On utilise aussi des animaux transgéniques pour réaliser des xénogreffes. De toute évidence, les dons d’organes ne pourront jamais subvenir aux besoins des nombreux patients en attente de greffons. L’idée serait alors de réaliser, chez les patients en question, des xénogreffes, c’est-à-dire de leurs greffer des organes animaux. L’animal pressenti comme donneur d’organes pour l’homme serait alors le porc, d’une part parce que, comme le lapin, il est très proche de l’homme du point de vue des fonctions biologiques, et d’autre part parce qu’il y a a priori très peu de maladies transmises du porc à l’homme. Le problème des xénogreffes est qu’elles se caractérisent par un rejet immédiat du greffon, chacune des cellules qui le composent étant reconnue comme étrangère par l’organisme receveur.
L’idée est alors de fabriquer des porcs transgéniques qui expriment, à la surface des cellules de leurs organes, des protéines humaines dont la fonction naturelle est de préserver les organes de l’homme contre une attaque de son propre système immunitaire. Ces protéines humaines vont ainsi empêcher (ou au moins freiner) le processus de rejet immédiat lorsque ces organes de porc sont transplantés chez l’homme. Il s’agit, en quelque sorte, de créer un leurre pour faire croire à l’organisme humain que ces organes proviennent de l’espèce humaine. Des porcs, mais aussi des lapins et des souris portant les gènes humains qui codent les protéines humaines en question ont été obtenus. Ces études ont lieu essentiellement en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Australie où des cœurs et des reins de tels porcs transgéniques ont été transplantés chez des singes. Ces derniers survivent alors plusieurs semaines au lieu de quelques heures (dans les cas où les organes transplantés proviennent de porcs non transgéniques) : le but recherché est encore loin d’être atteint. De plus, outre les nombreuses questions éthiques et juridiques que posent les xénogreffes, beaucoup d’aspects scientifiques et techniques, concernant non seulement l’ensemble des mécanismes de rejet (les rejets immédiats ainsi que les rejets classiques, c’est-à-dire ceux que l’on observe dans le cas de greffons humains) mais également les effets à moyen et long termes de la transgenèse sur les organes transplantés, restent à élucider. Se posent également les risques considérables d’infections croisées entre l’animal donneur et l’homme telles que des maladies virales dues à des virus non détectés.
Crispr/Cas9 au secours de la thérapie génique ?
Après la transgenèse, les techniques de manipulation du génome se succèdent à une vitesse spectaculaire, avec des noms plus barbares les uns que les autres (mutagénèse dirigée par oligonucléotides, nucléases dirigées à doigt de zinc, Méganucléases, Talen, Crispr/Cas9, etc.). Ces techniques, pour lesquelles nous n’avons bien sûr absolument aucun recul, sont l’objet de tous les fantasmes et de toutes les promesses notamment dans le domaine médical pour soigner les maladies génétiques contre lesquelles on attend encore que se réalisent concrètement les « miracles » de la thérapie génique vantés depuis 30 ans (voir article p.16).
Mais la prétendue ultra-précision de la technique Crispr/Cas9 a pris tout récemment un sérieux coup dans l’aile : une étude, publiée dans la très sérieuse revue Nature Methods, vient de mettre en lumière des effets inattendus de cette approche. En analysant intégralement le génome de deux souris traitées contre la cécité par cette technique, les chercheurs ont détecté, outre la modification du gène d’intérêt, plus de 1 500 mutations non désirées. Cette technique est peut-être séduisante sur le papier glacé, mais le vivant n’est pas une feuille A4 ni un quelconque algorithme informatique.