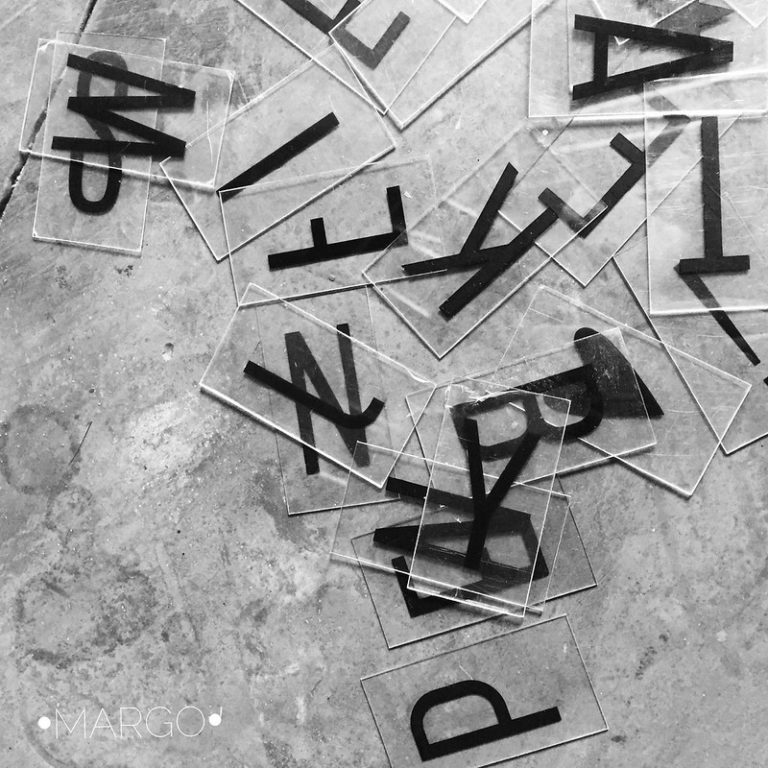Actualités
France – Un décret pour accéder aux savoirs traditionnels

Le 9 mai 2017, le gouvernement français a adopté le décret d’application du Protocole de Nagoya. Ce décret précise notamment les règles d’accès aux savoirs traditionnels et le partage des avantages qui en découlent.
Le Protocole de Nagoya, traité complémentaire à la Convention sur la diversité biologique adoptée dans le cadre des Nations unies, a pour but de mettre en œuvre le consentement préalable à l’accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels associés ainsi que le partage juste et équitable des avantages liés à leur utilisation [1]. En 2016, la loi pour la reconquête de la biodiversité a autorisé le gouvernement français à ratifier ce Protocole. Depuis, un certain nombre de décrets ont été adoptés [2]. Mais il manquait celui qui précise les mécanismes prévus dans le Protocole de Nagoya, notamment en ce qui concerne l’accès aux savoirs traditionnels et le partage des avantages qui en découlent. C’est désormais chose faite.
Le décret n°2017-848 [3] fixe d’abord les règles d’accès aux ressources génétiques situées sur le territoire national et le partage des avantages découlant de leur utilisation. À cet égard, le décret met en place deux régimes juridiques distincts en fonction des fins visées par l’utilisation.
Si l’utilisation ne vise pas de fins commerciales, c’est un régime de déclaration préalable qui s’applique. Concrètement, celui qui veut accéder à une ressource génétique doit faire préalablement une déclaration au ministre de l’Environnement [4]. Si cette déclaration est complète, le ministre ne peut refuser l’accès à la ressource génétique et délivre alors un récépissé [5]. Ainsi, pour les utilisations non commerciales de ressources génétiques, l’État français a donc renoncé à exercer un consentement préalable. Mais certains s’étonnent que l’État y renonce au nom et à la place des communautés qui conservent les ressources concernées. Les principes constitutionnels d’indivisibilité de la République et d’unicité du peuple français semblent justifier pour eux l’appropriation par l’État de tout droit sur les ressources conservées par des communautés vivant sur son territoire.
Autorisation préalable si business en vue
En revanche, si l’utilisation des ressources génétiques vise des fins commerciales, c’est un régime d’autorisation préalable qui s’applique. Celui qui veut accéder à une ressource génétique devra alors adresser une demande d’autorisation au ministre de l’Environnement. Comme sous le régime de la déclaration préalable, la demande doit contenir un certain nombre d’informations obligatoires, dont des propositions en matière de partage des avantages. Le ministre de l’Environnement peut non seulement assortir son autorisation de prescriptions en matière de conditions d’utilisation des ressources génétiques mais aussi refuser la demande [6]. Il est également chargé d’indiquer au demandeur un délai pendant lequel il doit parvenir à un accord sur le partage des avantages. Précision bienvenue apportée par le décret : si aucun accord n’est trouvé, la demande est refusée.
Le décret précise aussi les règles d’utilisation des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques. Ici, un seul régime est prévu : celui de l’autorisation préalable, plus lourd que celui de la déclaration. L’autorisation doit être présentée au ministre de l’Environnement et fait intervenir les personnes morales de droit public, désignées par la loi de 2016, chargées d’identifier les porteurs de savoirs et recueillir le consentement préalable en connaissance de cause. Curieusement, la procédure décrite ne concerne que les connaissances détenues par les communautés d’habitants de la Guyane ou des îles Wallis et Futuna, alors même que la loi de 2016 donne une définition très large de la notion de « communautés d’habitants » [7]. Qu’en est-il des connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues, par exemple, par des habitants de l’Ile de la Réunion, de Martinique… ou encore de métropole ? Le fait que le décret se cantonne aux communautés d’habitants de la Guyane et des îles Wallis et Futuna montre combien la question de l’identification des détenteurs de savoirs traditionnels, légitimes aux yeux de leur communauté et acceptant de signer des contrats de partage des avantages, a posé problème pour le gouvernement français.
Pour Catherine Aubertin, économiste et spécialiste des questions d’Accès et de Partage des Avantages (APA) « la mise en œuvre du protocole était attendue par le monde de la recherche afin de clarifier les procédures. Les principes du partage des avantages, et plus généralement l’accès aux ressources génétiques et leur utilisation (dont la gestion des collections) se heurtaient à l’absence d’interlocuteurs identifiés, de procédures de déclaration et de demande d’autorisation, de validation des collections ».
La loi de 2016 effectuait déjà un pas en ce sens, puisqu’elle désignait « les autorités administratives compétentes (qui instruisent les dossiers) et, en cas de connaissances traditionnelles, les personnes morales de droit public (qui identifient les porteurs de savoir, recueillent le consentement préalable en connaissance de cause et négocient les contrats de partage des avantages) ».
Les connaissances traditionnelles ont-elles des interlocuteurs légitimes ?
Pour les connaissances traditionnelles, la question de l’identification des interlocuteurs légitimes pour porter le savoir d’une communauté, pour donner un consentement préalable éclairé et signer un contrat valide reste toutefois posée, même après la publication du décret. Ce dernier décrit certes la procédure pour l’accès aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par les communautés d’habitants de la Guyane ou des îles Wallis et Futuna. Mais les personnes morales de droit public désignées par la loi de 2016 chargées d’identifier les porteurs de savoirs et recueillir le consentement préalable en connaissance de cause ne sont toujours pas en place. Pour la Guyane, cette personne morale de droit public peut être créée par la collectivité territoriale de Guyane elle-même, à la demande du Grand conseil coutumier des populations amérindiennes [8].
Catherine Aubertin affirme cependant que le fait « qu’Amérindiens et Bushinengué s’organisent entre eux pour désigner les porteurs légitimes de savoirs à signer des accords à travers la constitution d’un établissement public de coopération environnementale est une bonne chose ». Selon elle, « cela devrait permettre : d’une part de ne pas laisser la défense de leurs droits à des personnes extérieures plus ou moins bien intentionnées et, d’autre part, de ne pas laisser des chercheurs choisir d’ayant droits non légitimes ».
Le système d’accès et de partage des avantages décrit par le décret entrera en vigueur le premier juillet 2017. Il ne concerne que les ressources génétiques sous souveraineté française.
S’agissant du cas spécifique des « ressources génétiques des espèces cultivées et végétales sauvages apparentées », une ordonnance est toujours attendue.
[1] , « Lutte contre la biopiraterie : le Protocole de Nagoya et le TIRPAA », Inf’OGM, 1er décembre 2022
[2] C’est le cas par exemple du décret n° 2016-1842 du 26 décembre 2016 relatif à l’Agence française pour la biodiversité. L’une des missions de cet établissement public est de contribuer à la lutte contre la biopiraterie. Voir article 21 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.
[3] Décret n° 2017-848 du 9 mai 2017 relatif à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et au partage des avantages découlant de leur utilisation, Journal officiel du 10 mai 2017.
[4] Cette déclaration doit contenir un certain nombre d’informations obligatoires. Elle doit notamment comporter la description des activités en vue desquelles la déclaration est effectuée et leur objectif, la description des modalités techniques d’accès aux ressources génétiques et des conditions de collecte ou encore le choix de la modalité de partage des avantages applicables à son activité et le ou les bénéficiaires. Voir article 1 du décret précité.
[5] Ce récépissé est transmis au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages du Protocole de Nagoya.
[6] Si le ministre autorise l’accès aux ressources génétiques, le contrat de partage des avantages ainsi que l’arrêté d’autorisation sont transmis au Centre d’échange sur l’accès et le partage des avantages du Protocole de Nagoya.
[7] L’article L412-4 4° du Code de l’environnement définit les communautés d’habitants comme : « toute communauté d’habitants qui tire traditionnellement ses moyens de subsistance du milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité ».
[8] Pour les Iles Wallis et Futuna, cette personne morale de droit public est la (ou les) circonscription(s) territoriale(s) sur la(les)quelle(s) est(sont) établie(s) la (ou les) communauté(s) d’habitants concernée(s).