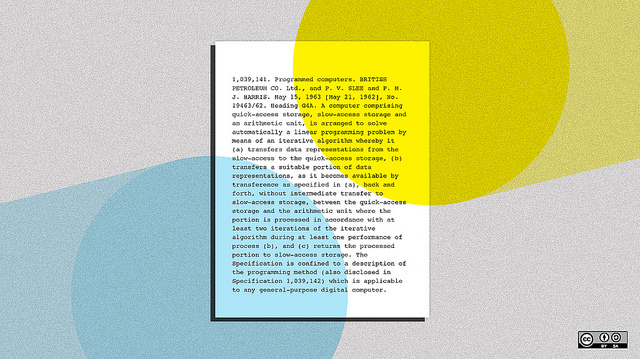Le pillage des semences paysannes

La législation actuelle sur les semences dans l’Union européenne légalise, via les droits de propriété industrielle (COV et brevets), la biopiraterie vis-à-vis des communautés paysannes. Pourquoi ? Et comment y remédier ?
Nous avons vu comment la biopiraterie s’est développée sur les plantes sauvages, notamment par les entreprises de cosmétiques et de pharmacie. Pour les plantes cultivées, un autre acteur entre en jeu : l’entreprise semencière.
Afin d’éviter que les agriculteurs ne soient trompés sur le type et la qualité des semences qu’ils achètent, on ne peut dans l’Union européenne commercialiser de semences destinées à l’agriculture commerciale que si elles appartiennent à une variété inscrite à un catalogue de plantes agricoles (potagères, grandes cultures, pomme de terre…). Ces inscriptions requièrent le respect de standards spécifiques aux semences industrielles – les fameux critères de distinction, homogénéité et stabilité (DHS) – des analyses coûteuses, ainsi que de nombreux tests préalables, souvent hors de portée des paysans.
Si une variété commerciale est issue d’une population paysanne qui a juste été rendue homogène et stable, alors cette obligation d’inscription au catalogue est assimilable à un acte de biopiraterie en ce sens que le paysan n’a jamais donné son accord préalable et qu’aucun avantage n’est partagé. Pire, si le nom donné à la variété commerciale est similaire à celui de la population paysanne, alors le paysan ne peut même plus commercialiser ses semences sous sa dénomination d’origine. C’est le cas qui avait été dénoncé avec la variété de haricot Ganxet en Catalogne espagnole [1].
COV : une deuxième dépossession des paysans
Plus problématique est, dans l’Union européenne, le système de droit de propriété avec les certificats d’obtention végétale (COV) d’un côté, et les brevets de l’autre.
Le système des COV a été développé spécifiquement, au niveau international, pour donner un droit de propriété aux obtenteurs de nouvelles variétés végétales : toute personne qui sème, ou ressème, une semence protégée par un COV doit payer des royalties à son propriétaire et n’a le droit ni d’échanger ni de vendre cette semence. Dans la mesure où le matériel de départ du sélectionneur repose sur des semences paysannes collectées gratuitement dans les champs par des semenciers, l’interdiction de ressemer les variétés des sélectionneurs peut être, à notre sens, qualifiée de biopiraterie : les nouvelles variétés détiennent en effet un ou des fonds génétiques obtenus sans autorisation préalable et sans, par la suite, partage des avantages avec les détenteurs de la ressource.
Pour les brevets, autre forme de propriété industrielle permise dans l’Union européenne, c’est encore pire.
Le texte qui fait office de loi pour les brevets est la directive européenne 98/44. Selon cette directive, « une matière biologique isolée de son environnement naturel ou produite à l’aide d’un procédé technique peut être l’objet d’une invention, même lorsqu’elle préexistait à l’état naturel ». Ceci permet le dépôt de brevets sur des « gènes » existant préalablement dans des plantes sauvages ou cultivées. Ces gènes sont caractérisés par des paramètres appelés « information génétique ». Or, selon la même directive, « la protection conférée par un brevet à un produit contenant une information génétique ou consistant en une information génétique s’étend à toute matière […] dans laquelle le produit est incorporé et dans laquelle l’information génétique est contenue et exerce sa fonction ».
Biopiraterie avec brevetage de l’information génétique
Dans une synthèse d’août 2016 [2] publiée suite aux débats en France sur la loi biodiversité, Guy Kastler, de la Confédération Paysanne, décortique quelques brevets pour mieux comprendre les mécanismes de biopiraterie en cours. En 2013, Arcadia a obtenu le brevet EP 1 708 559 sur une séquence génétique de blé qui permet « d’obtenir un blé à faible teneur en amylose et riche en amylopectine (blé waxy) ». Dans ce cas précis, si les descriptions fournies par Arcadia dans le brevet concernent un blé obtenu par un certain procédé (ici, mutagénèse chimique assistée par marqueurs), les revendications du brevet couvrent tout blé contenant une séquence génétique responsable de la caractéristique recherchée, quelle que soit la façon dont il a été obtenu tant qu’il contient la séquence décrite ! Autrement dit, un paysan qui a dans son champ un blé possédant cette séquence doit payer des royalties au détenteur du brevet. Inouï ! Pas d’autorisation préalable, pas de partage des avantages, et qui plus est, interdiction de continuer à cultiver ses semences : de la biopiraterie au maximum de son cynisme.
Pareils brevets se multiplient comme le brevet EP 1 649 022 de Limagrain en 2013 sur du blé dont l’amidon contient au minimum 50 % d’amylose, quel que soit le procédé d’obtention… Et de s’appliquer aux graines et plantes de blé dur et tendre, à l’amidon tiré de ces plantes, aux produits contenant tout ou partie de ces graines et plantes…
Comment ces aberrations ont-elles été rendues possibles ? La directive européenne 98/44 interdit pourtant la brevetabilité des variétés végétales et des procédés essentiellement biologiques. De tels brevets ne sont donc pas délivrés par l’Office européen des brevets (OEB). Dans l’esprit du législateur, comme l’a rappelé en novembre 2016 la Commission européenne, il s’agissait aussi d’interdire les brevets sur les produits issus de procédés essentiellement biologiques. Mais d’une part, cela n’est pas formulé clairement dans la directive 98/44 (c’est par contre inscrit dans la loi française depuis juillet 2016) ; d’autre part, rien n’empêche d’étendre la protection d’un brevet portant sur une « information génétique » obtenue par un procédé brevetable à toute plante contenant la même « information génétique », même si elle est issue de simples croisements et sélections.
Limiter l’extension des brevets pour contrer la biopiraterie
Cette situation a entraîné la mobilisation de nombreux collectifs citoyens et paysans en Europe. Plusieurs pays, dont la France, par sa loi biodiversité de juillet 2016, ont déjà limité les possibilités de brevets sur les produits issus de procédés essentiellement biologiques (PEB) : lorsqu’une plante obtenue par un PEB contient une matière biologique identique à une matière biologique brevetée, la protection du brevet ne s’étend pas à cette plante. Mais si elle contient une « information génétique » brevetée, elle est alors couverte par la protection du brevet. De plus, ces changements ne sont pas valables pour toute l’Union européenne et les entreprises continuent à privatiser via leurs brevets le monde végétal. Le Parlement français a aussi annulé la protection du brevet en cas de « présence fortuite d’une information génétique brevetée dans des semences », visant par là les risques d’appropriation découlant d’inévitables contaminations génétiques.
Comment avancent les entreprises pour confisquer le vivant ? Avec l’obtention de brevets dont la protection peut s’étendre à des plantes existant « naturellement », les entreprises mettent définitivement sur la touche le paysan qui n’a aucun moyen de lutte contre ces géants qui pèsent plusieurs milliards d’euros. Les entreprises visent donc maintenant à s’organiser entre elles. Sachant qu’il n’existe pas d’exception de sélection pour le brevet (à la différence du COV), pour éviter que les brevets de leurs concurrents ne viennent annihiler leur travail, certaines entreprises proposent de continuer en Europe à privilégier un certificat d’obtention végétale « amélioré ». Ce dernier présente, par rapport au brevet, un avantage important : l’absence d’obligation de décrire le procédé d’obtention et donc la possibilité de commercialiser des OGM sans l’indiquer. L’ « amélioration » du COV consisterait en deux points : 1 – l’obtention d’un COV devrait pouvoir se faire sur la base de paramètres génétiques caractérisant la variété, facilement identifiables dans les produits de la récolte et une nouvelle variété issue de croisements avec la variété protégée (aujourd’hui, la description ne repose que sur des caractères visibles extérieurement, dits caractères phénotypiques) ; et 2 – mettre en place une période de cinq ans durant laquelle personne n’aurait le droit d’utiliser la variété à des fins d’amélioration (contrairement à aujourd’hui où la variété est directement disponible pour les sélectionneurs). C’est lors d’une discussion le 6 octobre 2016 en commission des affaires européennes du Sénat qu’un « avis politique sur la protection juridique des variétés végétales » allant dans ce sens a été adopté. Il présentait comme nécessaire l’instauration d’une « adaptation des modalités d’exercice de l’exception du sélectionneur par l’introduction d’un délai, qui pourrait être d’une durée de cinq ans, entre la mise sur le marché d’une nouvelle variété et le droit d’exercice de l’exception du sélectionneur de manière à ce que l’obtenteur puisse bénéficier d’une protection temporaire contre l’utilisation rapide par un concurrent de ses résultats de recherche obtenus au moyen de procédés de plus en plus coûteux sans bloquer trop longtemps l’accès à la nouvelle variété ».
Et pour les brevets ? La stratégie des entreprises est là encore assez claire et consiste tout simplement à essayer d’échapper au contrôle public en montant des clubs privés au sein desquels les seuls membres auraient accès aux brevets des autres qui ne pourraient pas, en retour, refuser de vendre les droits de licence afférents (voir Un petit semencier confronté aux brevets).
La biopiraterie pourrait donc avoir encore de beaux jours devant elle, sauf si cette situation aussi scandaleuse continue de mobiliser massivement citoyens et paysans pour interpeller et responsabiliser les politiques afin de rendre illégal ce vol généralisé des ressources végétales.