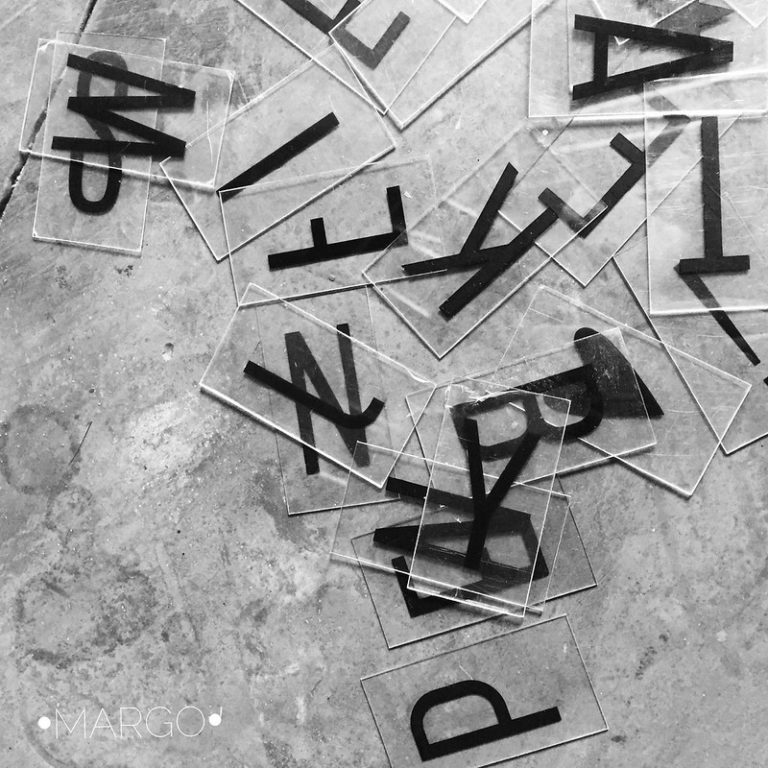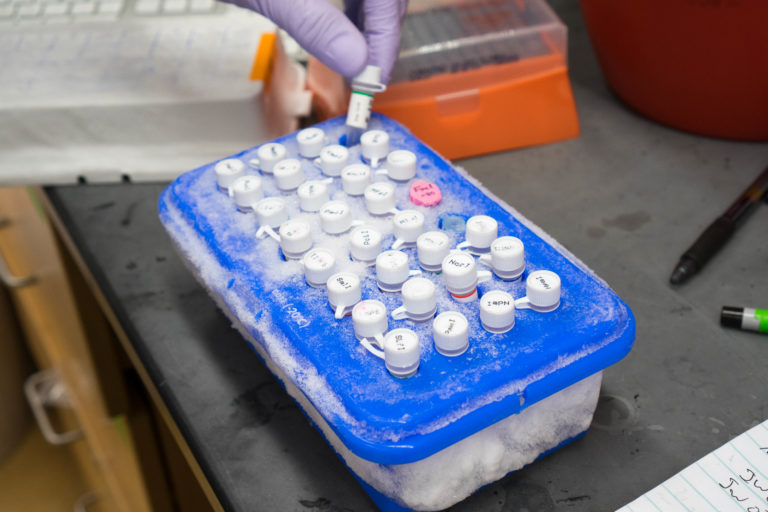Actualités
Le Ceta, incompatible avec les droits européen et français ?

Il y a quelques semaines, nous relevions comment le Ceta, accord commercial entre le Canada et l’UE, risquait de remettre en cause les droits des agriculteurs [1]. Alors que le Conseil de l’UE a adopté les décisions relatives à sa signature et son entrée en vigueur provisoire le 28 octobre et qu’il a été signé le 30 octobre [2], le Ceta soulève aussi un autre problème : celui de son incertaine compatibilité avec le droit de l’Union européenne et avec la Constitution française.
Le Ceta contient un mécanisme de règlement des différends entre États et investisseurs. Établi par les articles 8.18 et suivants de l’accord, le Tribunal peut être saisi par un investisseur d’une Partie – Canada, États membres de l’UE ou Union européenne – d’une plainte contre des mesures prises par un État ou l’Union européenne qu’il estime être contraires aux obligations découlant du Ceta. Il pourra également demander réparation s’il estime avoir subi des dommages du fait de ces mesures.
Le monopole des juridictions de l’UE remis en cause
Composé de juges issus du Canada, des États membres de l’Union européenne et d’États tiers, ce Tribunal pose problème au regard du droit de l’Union européenne. Ce dernier prévoit en effet que les juridictions de l’Union européenne (Cour de justice, Tribunal et tribunaux spécialisés) assurent le respect du droit dans l’interprétation et l’application des traités [3]. Pourtant, en se basant sur le Ceta, un investisseur pourrait contester devant le Tribunal une mesure prise au niveau de l’Union européenne, par exemple celle exigeant l’étiquetage des produits contenant plus de 0,9% d’OGM [4]. Il pourrait arguer que cette obligation d’étiquetage constitue un obstacle au commerce contraire au Ceta. Les juges du Tribunal seront alors amenés à apprécier si le Règlement de l’UE posant l’obligation d’étiquetage est contraire au regard des obligations découlant du Ceta. S’il est vrai que les juges ne pourront pas ordonner le retrait de la mesure contestée, il n’en reste pas moins qu’en vertu du droit de l’Union européenne, seule la Cour de justice peut se prononcer sur la validité d’un acte de l’Union et ce afin de garantir l’application effective et uniforme du droit de l’Union.
Cette incompatibilité entre le Ceta et le droit de l’UE, également relevée par ClientEarth et Foodwatch [5], est l’une des raisons pour laquelle des députés français ont déposé une proposition de résolution européenne pour que la France s’oppose à toute application provisoire du Ceta et s’assure de sa compatibilité avec les traités de l’Union européenne [6]. Dans leur proposition de résolution, les députés demandent également au gouvernement français de saisir la Cour de justice sur la compatibilité du Ceta avec les Traités européens [7].
Le principe de précaution, à valeur constitutionnelle, n’est pas garanti par le Ceta
Malgré les multiples déclarations de Mme Cecilia Malmström, Commissaire européenne chargée du Commerce, destinées à rassurer les citoyens européens sur la prise en compte du principe de précaution dans l’accord de libre échange négocié avec le Canada, il faut se rendre à l’évidence : le principe de précaution n’est pas directement mentionné dans le Ceta.
L’absence du principe de précaution dans le Ceta mais également dans le traité commercial en négociations avec les États-Unis (TTIP), a été relevée par l’ONG Foodwatch, qui craint que le principe soit remis en cause du fait de ces accords de libre-échange [8].
Consacré au niveau de l’Union européenne [9], le principe de précaution a valeur constitutionnelle en France depuis 2005. Dans le domaine de la santé, de l’environnement ou de l’alimentation, ce principe permet de prendre des mesures visant à protéger les populations ou l’environnement, en interdisant par exemple l’importation d’OGM ou de produits en contenant, même en l’absence de certitude scientifique quant à l’existence du risque [10].
Pour rappel, la réglementation de l’Union européenne relative aux OGM est fondée sur le principe de précaution. Et en France, le gouvernement a invoqué ce principe pour justifier l’interdiction de la commercialisation, l’utilisation et la culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié (Zea mays L. lignée MON810).
Si le Ceta ne comporte pas de référence explicite au principe de précaution, c’est qu’il prend pour référence les règles issues de l’Organisation Mondiale du Commerce. Ces dernières ne reconnaissent pas en tant que tel le principe de précaution. Elles prévoient certes qu’en l’absence de preuves scientifiques pertinentes suffisantes, un État peut adopter des mesures sanitaires ou phytosanitaires restrictives au commerce. Mais ces mesures ne peuvent être que temporaires et doivent dans tous les cas être suivies d’efforts en vue d’obtenir les renseignements additionnels nécessaires pour procéder à une évaluation plus objective du risque et d’un examen en conséquence de la mesure sanitaire ou phytosanitaire dans un délai raisonnable [11].
Selon l’ONG Foodwatch, compte tenu de la probable inconstitutionnalité du Ceta, il est inconcevable que le Ceta fasse l’objet d’une entrée en vigueur provisoire et urgent que le Conseil constitutionnel soit saisi de la conformité du Ceta à la Constitution [12].
[1] , « UE-Canada – Le Ceta, un accord commercial au détriment des paysans », Inf’OGM, 29 septembre 2016
[2] Après le veto opposé par le Parlement wallon à la signature du Ceta empêchant la signature de l’accord par le gouvernement belge, et le report du Sommet UE-Canada lors duquel devait être signé l’accord, le Conseil de l’UE a finalement adopté les décisions relatives à la signature de l’accord et à l’entrée en vigueur provisoire de l’accord le 28 octobre. Le 30 octobre, lors du 16e Sommet UE-Canada, Donald Tusk, président du Conseil européen, Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, Robert Fico, Premier ministre slovaque exerçant la présidence tournante du Conseil, et Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, ont signé le Ceta.
[3] Article 19 du Traité sur l’Union européenne
[4] L’obligation d’étiquetage est prévue par le Règlement 2003/1829
[6] Proposition de résolution européenne n°4071 de M. Jean-Noël Carpentier, Mme Danielle Auroi, M. Jean-Paul Chanteguet, Mme Suzanne Tallard et plusieurs de leurs collègues pour que la France s’oppose à toute application provisoire de l’Accord économique et commercial global avec le Canada et s’assure de sa compatibilité avec les traités de l’UE. Pour consulter la résolution, voir : http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion4071.asp
[7] En application de l’article 218 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement européen, la Commission européenne ou les États membres peuvent saisir la Cour de justice pour recueillir son avis sur la compatibilité d’un accord envisagé avec les traités. En cas d’avis négatif de la Cour, l’accord envisagé ne peut entrer en vigueur, sauf modification de celui-ci ou révision des traités. La Commission européenne a déjà fait savoir qu’elle ne saisirait pas la Cour. En revanche, l’un des points de la déclaration sur laquelle les entités fédérées de la Belgique se sont mises d’accord pour la signature du CETA est la saisine par la Belgique de la Cour de justice pour vérifier si le système juridictionnel des investissements est bien compatible avec le droit de l’Union européenne.
[8] Voir : http://www.foodwatch.org/uploads/tx_abdownloads/files/foodwatch_re__sume___princpice_Pre__caution_2016_WEB.pdf
[9] L’article 191 § 2 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que la politique de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement « est fondée sur les principes de précaution et d’action préventive ».
[10] Le principe de précaution est consacré à l’article 5 de la Charte de l’environnement. Aux termes de celui-ci : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. «
[11] Voir article 5.7 de l’Accord sur l’Application des Mesures Sanitaires et Phytosanitaires.
[12] Voir le communiqué de presse de Foodwatch : http://www.veblen-institute.org/IMG/pdf/cp_ceta_et_constitution_foodwatch_veblen-14-10-2016.pdf. En vertu de l’article 54 de la Constitution, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, par le Premier ministre, par le président de l’Assemblée nationale ou du Sénat ou par soixante députés ou soixante sénateurs. Si le Conseil constitutionnel estime que l’engagement international est contraire à la Constitution, sa ratification ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.