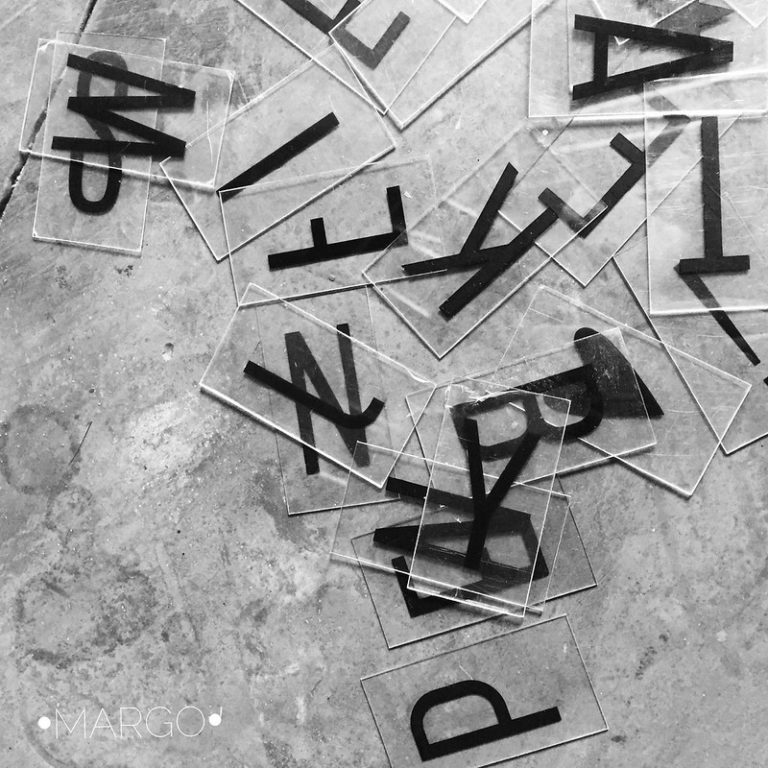Ressemer et vendre ses semences : un droit à (re)conquérir

Pas facile de s’y retrouver dans ces notions de propriété industrielle sur le vivant. Ce qui est certain, c’est que les paysans sont la plupart du temps poursuivis comme des fraudeurs lorsqu’ils veulent échanger leurs semences [1]. Et qu’il est juridiquement difficile pour eux de retrouver une marge de manœuvre pour produire leurs propres semences et encore plus pour les échanger ou les vendre. Catalogue officiel et droits de propriété industrielle sont en effet autant de freins pour la production de semences par les paysans et pour les paysans. L’arrivée massive des brevets sur des traits génétiques de plantes aggrave encore le problème en confisquant le vivant, au détriment des paysans et même de certains semenciers. Explications.
Avant… disons, avant l’apparition du premier catalogue officiel obligatoire, c’était simple : les paysans semaient des graines qu’ils avaient obtenues soit de leur récolte précédente, soit de celle de leurs voisins, soit, à la marge, de revendeurs plus ou moins autorisés [2]. Aujourd’hui, c’est-à-dire moins de cent ans plus tard, en France et dans les autres pays industrialisés, la majeure partie des agriculteurs utilisent des semences commerciales [3] (qu’ils achètent ou qu’ils reproduisent à la ferme en s’acquittant des droits), et le paysage juridique s’est complexifié pour ceux qui souhaitent produire leurs semences, les vendre ou les échanger.
Produire ses semences : un droit très encadré
Tout d’abord, les paysans qui continuent à produire leurs propres semences (et tous ceux qui retrouvent aujourd’hui cette pratique) peuvent librement les cultiver, même si elles n’appartiennent pas à une variété inscrite au catalogue des variétés (cf. plus bas), sauf évidemment s’il s’agit de plantes génétiquement modifiées (PGM), d’espèces non autorisées à la culture (tabac et autres psychotropes), si des règles sanitaires s’y opposent ou encore si elles appartiennent à une variété protégée par un certificat d’obtention végétale (COV) ou un droit de marque (Pomme Granny, par exemple). Ce qui est interdit, c’est le commerce ou l’échange, à titre onéreux ou gratuit (sic), de semences issues de variétés non inscrites au catalogue [4]. Ainsi, les semences appelées « populations » (sélectionnées et multipliées en pollinisation libre et/ ou en sélection massale) [5], par définition la plupart du temps non inscriptibles au catalogue, car non homogènes, peuvent être échangées lorsqu’elles sont destinées à l’expérimentation, la sélection ou la conservation [6]. Il ne s’agit alors pas, pour le législateur, d’une exploitation commerciale de la variété. C’est ce que font les membres d’AgroBio Périgord, par exemple. Libre aussi à l’agriculteur qui a reçu un lot de semences destiné à l’expérimentation, de reproduire et de sélectionner ses propres populations sur sa ferme et de les utiliser pour sa propre production [7].
Les semences n’appartenant pas à une variété inscrite au catalogue peuvent aussi être commercialisées accompagnées d’une indication claire qu’elles sont destinées au jardinage amateur (l’autoconsommation de la récolte n’est pas une exploitation commerciale de la variété). Il faut évidemment alors que les quantités échangées ou commercialisées correspondent à ce qui est nécessaire pour l’utilisation revendiquée. Elles peuvent enfin être commercialisées « sans indication de variété » [8] (cf. encadré plus bas).
Catalogue : le contrôle de qualité dérive en monopole des semenciers
Pour, entre autre, lutter contre la fraude et la mauvaise qualité des semences, un premier « catalogue des espèces et variétés cultivées en France » est établi en 1932, mais il ne concerne que quelques espèces de grandes cultures agricoles et n’est pas encore obligatoire pour pouvoir commercialiser des semences. Il le deviendra en 1949 et sera ensuite progressivement étendu à l’ensemble des plantes cultivées [9]. Pour que des semences soient commercialisées, voire échangées, la variété à laquelle elles appartiennent doit aujourd’hui être inscrite au catalogue [10]. Et pour être inscrite au catalogue, une variété doit avoir passé avec succès les tests de distinction, d’homogénéité et de stabilité (dit aussi critères DHS), ce qui exclut donc de fait la majeure partie des « populations » [11]. A ces trois critères, il faut ajouter pour les plantes de cultures agricoles [12] les critères appelés VATE pour Valeur Agronomique, Technologique et Environnementale [13].
Il existe deux statuts pour les variétés agricoles inscrites au catalogue : celles qui sont dans le domaine public, et celles qui sont couvertes par un droit de propriété industrielle appelé certificat d’obtention végétale (COV) [14] déposé par l’entreprise semencière qui les a mises au point ou qui en a acheté les droits d’exploitation. Explication : dans l’Union européenne, un obtenteur dépose un COV sur chacune de ses variétés [15] et les inscrit au catalogue. Mais le COV a une durée limitée de 25 à 30 ans selon les espèces [16]. Après ce délai, la variété tombe dans le domaine public. Elle peut alors être maintenue au catalogue par l’obtenteur initial ou par une autre personne physique ou morale, sous réserve qu’elle puisse se procurer des semences de base [17]. Ces semences peuvent alors continuer à être commercialisées, comme c’est le cas aujourd’hui pour 450 variétés, qui sont inscrites au catalogue mais totalement libres de droits [18]. Ces dernières peuvent être ressemées gratuitement et vendues comme semences (sous réserve d’un agrément par le Groupement national interprofessionnel des semences et plants – GNIS). Mais la plupart du temps, elles sont radiées du catalogue parce que la maintenance n’est plus assurée par aucun obtenteur [19]. Elles ne peuvent alors plus être commercialisées, mais peuvent malgré tout se retrouver dans un champ si un agriculteur en demande un petit lot à une banque de semences qui les aurait conservées au préalable.
Un agriculteur qui achète des semences – d’une variété qui est non seulement inscrite au catalogue mais aussi protégée par un COV – paye un droit de les utiliser facturé avec le prix d’achat. Il s’agit de premières royalties versées à l’obtenteur. Là encore, deux cas de figure se présentent. En règle générale, un agriculteur rachète chaque année la semence protégée à l’obtenteur (ou à un semencier sous licence avec ce dernier). Il est obligé de le faire lorsqu’il utilise des hybrides F1. Mais, pour 34 [20] espèces dérogatoires [21], un agriculteur peut ressemer une partie de sa récolte lorsqu’il s’agit de variétés non hybrides F1. Il doit alors s’acquitter d’une cotisation volontaire obligatoire (CVO) [22] (cf. encadré ci-dessous). Seul le « petit » agriculteur ne paye pas la CVO, ou celle-ci lui est remboursée. Petit agriculteur ? C’est celui qui récolte moins de l’équivalent de 92 tonnes de céréales, ce qui représente, en France, plus ou moins 15 ha de céréales suivant les régions [23].
La semence de ferme : un droit qui se prend
Les semenciers justifient le système du COV en arguant du coût de développement des nouvelles variétés ; et certains paysans le rejettent en arguant du pillage préalable de leurs ressources par les semenciers, sans contreparties, pour mettre au point ces variétés [24]. Du coup, ces derniers légitiment le fait de garder, pour ressemer dans leur ferme, une partie de leur récolte. Ceci est techniquement possible pour les semences de variétés multipliées en pollinisation libre. Ces variétés gardent en effet une bonne partie de leurs caractéristiques initiales et peuvent même parfois évoluer vers une meilleure adaptation locale. Le paysan récolte des graines qui donneront, globalement, la même récolte pendant un nombre d’années variable suivant les qualités de la variété initiale et pour peu qu’il fasse un minimum de sélection. Certains paysans gardent donc ces semences, appelées « semences de ferme », soit légalement en ayant payé un droit pour les 34 espèces sus-mentionnées, soit illégalement tant qu’ils ne sont pas pris, tant il est compliqué pour un semencier de prouver ce qu’aux yeux de la loi on appelle une « contrefaçon » !… Ce qui pourrait changer avec l’introduction dans les variétés de « marqueurs moléculaires », sorte de signature génétique de l’entreprise, faciles à détecter…
Pour les plantes allogames (à fécondation croisée), comme le maïs, le caractère hybride F1 de la plupart des semences commerciales donnera, à la génération suivante, une production hétérogène, moins productive. Mais il existe aussi pour ces espèces quelques variétés populations qui peuvent se ressemer, sans dégénérer.
A noter qu’un sélectionneur, ou un agriculteur qui souhaite faire sa propre variété, peut utiliser n’importe quelle autre variété, même protégée par un COV, pour en sélectionner une autre et obtenir une nouvelle variété, qui doit remplir à son tour les critères DHS pour que ses semences puissent être commercialisées [25] et être suffisamment distincte de la précédente pour pouvoir déposer un nouveau COV.
Voyons un cas concret : un cultivateur de blé sème une population (sans COV) ou une variété du catalogue libre de droit… Il peut vendre son grain à qui il veut (en passant toutefois obligatoirement par un organisme stockeur), peut ressemer sa récolte et continuer ainsi toute sa vie. Mais si la personne à qui il a vendu son grain, disons pour l’alimentation de ses poules, le sème au lieu de le donner à ses poules, que se passe-t-il légalement ? Le cultivateur de blé est-il coupable d’avoir vendu une semence n’appartenant pas à une variété inscrite au catalogue ? Dans l’absolu, la réponse est non, il ne serait coupable que s’il avait vendu des semences. Mais il a vendu du grain pour les poules. Et il n’est pas habilité à contrôler ce qu’en fait son acheteur. Le GNIS précise cependant que la réponse à cette question est aussi basée sur la bonne foi du vendeur, bonne foi estimée selon différents critères. Le plus fort est sans aucun doute le prix auquel ces grains ont été vendus : si c’est au prix de la semence (et non du grain), le soupçon est automatique. D’autres critères d’appréciation de la bonne foi sont possibles, comme par exemple d’avoir détaillé sur la facture la nature de la variété : si ce détail n’apporte rien à l’alimentation des poules, mais au contraire va dans le sens d’une semence adaptée à un certain type de terroir, alors la bonne foi peut être mise en cause.
Quant à celui qui a semé les grains au lieu de les donner aux poules, que risque-t-il ? Rien du tout, car il peut faire ce qu’il veut de ce qu’il a acheté (sauf bien sûr s’il s’agit d’une variété protégée : il doit alors payer des droits de licence). Par contre, il ne pourra pas se retourner contre celui qui lui a vendu du blé si par exemple les semences ne germent pas, puisqu’il a acheté du grain et non des semences.
On ignore parfois que la semence est protégée !
Le système du COV est régi au niveau international par l’Union pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) qui englobe aujourd’hui 73 pays sur 193 [26]. Mais il coexiste avec un autre système de protection industrielle : le brevet. Dans certains pays on peut déposer un brevet sur une variété (c’est le cas notamment des États-Unis, même s’ils sont également membre de l’UPOV). Dans d’autres, comme dans l’Union européenne, les brevets sur les variétés et les races animales sont interdits.
Mais, et c’est là que tout se complique, on peut aussi, dans beaucoup de pays et notamment en Europe, déposer un brevet sur une séquence ou un trait génétique (ou pour faire court un « gène ») contenu dans la plante (ou dans un animal ou un micro-organisme) si on respecte quatre critères : il faut avoir identifier sa nouvelle fonction, que cette « information génétique » ne soit pas déjà connue, qu’elle ne soit pas « réservée » à une seule variété et qu’elle puisse avoir une application industrielle. Aux yeux de la loi, un tel brevet privatise les plantes qui contiennent cette séquence génétique au profit du détenteur du brevet. Ce qui peut donc avoir la conséquence surprenante suivante : telle variété, en tant que variété, n’est pas brevetable ; mais toutes les plantes qui la constituent peuvent de fait être brevetées si elles contiennent une séquence génétique brevetée qui exprime sa fonction ! Ce que l’Office européen des brevets (OEB) résume avec un schéma [27] qui montre en exemple que s’il est impossible de breveter la variété Golden delicious, il est par contre possible de déposer un brevet sur toutes les plantes contenant un taux élevé de vitamine C, en tant qu’invention. Dès lors, toutes les variétés de pommes avec un taux élevé de vitamine C, comme par exemple la variété Belle de Boskoop, sont incluses dans cet ensemble de plantes et sont donc de facto couvertes par la protection de ces brevets.
La conséquence du brevetage de ces gènes, et qui plus est de gènes préexistants à l’état naturel (appelés aussi « gènes natifs »), est simple : une entreprise peut s’approprier toutes les plantes de la Planète qui possèdent tels ou tels gènes qu’elle a brevetés. Et donc interdire aux paysans de les cultiver et d’en commercialiser la récolte sans payer au préalable une redevance. Situation scandaleuse aux yeux de tous les paysans, mais aussi de certaines entreprises semencières qui ne peuvent plus utiliser librement les variétés de leurs concurrents ou les ressources génétiques des banques de semences sans au préalable s’assurer – mais comment ? – qu’elles sont totalement libres de droits. En effet, il n’y a pas d’obligation d’indiquer sur les sacs de semences si ces dernières renferment des séquences génétiques brevetées. Il faut donc mener l’enquête, ce qui a un coût exorbitant.
Comment sortir de l’appropriation du vivant ?
De plus en plus de voix s’élèvent contre la brevetabilité des gènes natifs. « Il y a une quasi unanimité des acteurs contre la brevetabilité des gènes natifs, à l’exception des grosses entreprises de semences, assurait François Burgaud, directeur des relations extérieures du GNIS, au journal Le Monde [28]. La science fait tant de progrès qu’il va être de plus en plus facile d’isoler tel gène correspondant à telle fonction. S’ils sont systématiquement brevetés, c’est la fin des méthodes classiques de sélection par croisement ». Les semenciers du GNIS protègent en effet leurs semences par des COV, et non des brevets. C’est pourquoi, contre le brevet, ils soulignent volontiers leur accord avec les dénonciations du Réseau Semences Paysannes (RSP), même s’ils proposent des solutions différentes. Car le RSP défend aussi, depuis près de 15 ans, le droit des paysans de sélectionner, échanger et vendre leurs propres semences paysannes, avec des critères plus ouverts que ceux du catalogue [29].
Dernière prise de position en date : celle des organisations paysannes observatrices au Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’agriculture et l’alimentation (Tirpaa), qui menacent de ne plus verser leurs ressources génétiques aux collections, afin de ne pas faciliter la biopiraterie et finalement l’interdiction pour eux de continuer à les cultiver [30]. La réunion de l’Organe directeur du Tirpaa (5-9 octobre 2015 à Rome) a été l’occasion d’une clarification des positions de chacun, sans pour autant que l’Organe directeur du Traité ne dénonce lui-même la biopiraterie [31] permise par le séquençage massif des semences et plants déposées dans le Traité (programme Divseek [32]). Ce que condamne le syndicat international de petits paysans La Via campesina, qui « attend des nombreux gouvernements, qui ont découvert à Rome ces détournements inadmissibles des objectifs du Traité, une vive réaction destinée à le remettre dans la bonne direction. La Via Campesina espère que la prochaine consultation sur les droits des agriculteurs (art. 9 du Traité) organisée en 2016 par l’Indonésie fera de ces droits une priorité garantissant la souveraineté alimentaire contre le vol des semences par les droits de propriété industrielle de l’industrie » [33].
Des paysans peuvent-ils s’échanger à titre gracieux des semences ?
Les échanges de semences sont régis par le Décret n°81-605 du 18 mai 1981 [34] qui « concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences et de plants ». Apparaît le mot « commercialisation », donc a priori cela ne concerne pas les échanges gratuits. Détrompez-vous ! Car, reprend le texte, « au sens du présent décret, par commercialisation, on entend la vente, la détention en vue de la vente, l’offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d’une exploitation commerciale, de semences ou de plants, que ce soit contre rémunération ou non ». « Contre rémunération ou non » ! Alors, même gratuitement, on ne peut échanger les semences ? C’est ainsi, mais il existe quelques exceptions.
L’article 1.1 de ce décret précise deux exemples de ce que peut être une exploitation non commerciale d’une variété : l’expérimentation et l’inspection par des organismes officiels, et « la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement » [35]. Et pour les producteurs (article 1.3), ils « peuvent commercialiser des semences et plants (…) s’il s’agit :
a) De petites quantités de semences et de plants, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection ;
b) Des quantités appropriées de semences et de plants destinées à d’autres fins, d’essai ou d’expérimentation, dans la mesure où ils appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d’inscription au catalogue national a été déposée ».
L’article 2 indique :
« – Ne peuvent être mis sur le marché en France sous les termes « semences » ou « plants » suivis d’un qualificatif les produits qui ne répondent pas aux conditions suivantes [suivent trois conditions dont la première ci-dessous] :
1° Appartenir à l’une des variétés inscrites sur une liste du Catalogue officiel des plantes cultivées ou, à défaut, sur un registre annexe
(…). Cette condition n’est pas exigée pour les semences et plants vendus sans indication de variété. »
Il est donc possible de vendre des semences n’appartenant pas à une variété inscrite au catalogue pour peu qu’on n’indique aucun nom de variété.
Enfin, l’article 3.1 de ce même décret prévoit « des conditions particulières de commercialisation (…) fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre de l’Agriculture en ce qui concerne :
![]() les semences ou les plants traités chimiquement ;
les semences ou les plants traités chimiquement ;
![]() la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes ;
la conservation in situ et l’utilisation durable des ressources génétiques des plantes ;
![]() les semences ou plants adaptés à la culture biologique ;
les semences ou plants adaptés à la culture biologique ;
![]() les mélanges de genres, d’espèces ou de variétés »…
les mélanges de genres, d’espèces ou de variétés »…
[1] , « Qu’est-ce que le catalogue officiel des espèces et des variétés en France et en Europe ? », Inf’OGM, 30 avril 2013
[2] Mais seulement un agriculteur sur 70 achetait sa semence aux semenciers agréés, voir , « Semence : de la sélection paysanne aux entreprises semencières », Inf’OGM, 25 juin 2013
[3] A la fois pour des raisons de simplicité et de « modernité » : au sortir de la deuxième guerre mondiale, via l’intervention étasunienne et son plan « Marshall », les premiers hybrides F1 ont débarqué en Europe. Mais la semence a aussi été fournie, entre autre, par la recherche publique (Inra), avec le paquet technologique des intrants et de la mécanisation, laissant augurer de meilleurs rendements pour un travail moins pénible…
[4] http://www.semencespaysannes.org/reglementation_especes_vegetales_cultivees_qu_117.php#question7
[5] Les populations sont constituées d’individus à haute diversité intra-variétale qui sont sélectionnés et multipliés en pollinisation libre et/ ou en sélection massale, et, contrairement aux hybrides F1, qui peuvent se ressemer d’une année sur l’autre. Juridiquement, ce ne sont pas des variétés car elles ne correspondent pas aux normes juridiques qui définissent la variété, cf. http://www.infogm.org/rubrique825
[6] Il en va de même pour les semences issues des banques de gène, qui peuvent être demandées pour la recherche, la sélection, la conservation ou la formation, donc pas pour une exploitation commerciale de la variété. D’autant que la plupart du temps, ces semences n’appartiennent à aucune variété, mais à des cultivars ou autres populations hétérogènes
[7] http://www.inra.fr/Chercheurs-etudiants/Systemes-agricoles/Tous-les-dossiers/Selection-classique-ou-participative-plusieurs-strategies-pour-les-bles-bios/La-reglementation-va-evoluer/%28key%29/3 (10 juin 2014)
[8] Art 2, 1. 1° du décret 81-605
[9] Bonneuil, C. et Thomas, F., Semences : une histoire politique, éd. CLM, 2012
[10] L’association Kokopelli en a fait les frais : elle a été condamnée à payer autant de contraventions de 3e classe que de variétés concernées, soit 3426 amendes de cinq euros chacune, en exécution de la loi sur les fraudes, prévue par les articles L.214-1 AL.1 et L.214-2 du Code de la consommation
[11] On a néanmoins quelques populations inscrites dans des catalogues nationaux de pays de l’UE, qui peuvent donc être cultivées en France : Peredovick, une vieille variété population de tournesol des années 50, inscrite au catalogue espagnol ; une population de maïs, le Jaune de Bade (Gelber Badischer Land en allemand) inscrite avant les hybrides F1 dans les années 50 au catalogue allemand ; et au moins deux autres variétés de maïs population, OPM11 et OPM12 (cf. http://www.sativa-rheinau.ch/dateien/Landwirtschaft/Offre-Agricole-Printemps-2015.pdf)…
D’après le GNIS, il est toujours possible d’inscrire une variété population au catalogue si elle est relativement stabilisée et qu’on peut la décrire (tant de pourcent de tel ou tel caractère). En revanche, pour le RSP, « l’appréciation du respect de critères DHS n’est que petits arrangements entre concurrents. Ces populations de tournesol et maïs ont été inscrites avant que les critères DHS ne se resserrent avec la généralisation des lignées pures et des F1. Des populations, ou des variétés moins homogènes, sont aussi inscrites au catalogue encore aujourd’hui pour des espèces comme les légumineuses fourragères, carottes… où on ne peut pas faire facilement de lignées pures ou des hybrides F1 de bonne valeur commerciale. Il suffit pour cela que les « experts » se mettent d’accord pour accepter un taux d’hétérogénéité plus important ».
[12] par exemple, les céréales, mais pas pour les fruitières ni les potagères
[13] On retrouvera les détails de ces définitions de DHS et VATE par exemple sur http://www.infogm.org/rubrique825
[14] , « Qu’est-ce que le Certificat d’Obtention Végétale (COV) ? », Inf’OGM, 30 octobre 2017
[15] délivrés par l’Office Communautaire des Variétés Végétales – OCVV (règlement 2100/94/CE)
[16] 30 ans pour des espèces pérennes : arbres forestiers, fruitiers ou d’ornement, la vigne ainsi que pour les graminées et légumineuses fourragères pérennes, les pommes de terre et les lignées endogames utilisées pour la production de variétés hybrides (art. R 623-56 du décret 95-1407 du 28 décembre 1995)
[17] C’est ainsi que par exemple l’association des Croqueurs de Carottes, qui regroupe des petites entreprises semencières, est mainteneur de quelques variétés traditionnelles présentes dans le catalogue, voir : http://www.biaugerme.com/reglementation-semences_526.php et http://www.semaille.com/fr/content/16-les-croqueurs-de-carottes
[18] Par exemple la pomme de terre Bintje, le blé Florence Aurore, ou la luzerne Europe, voir : http://www.gnis.fr/index/action/page/id/960/title/Quels-sont-maintenant-les-choix-d%E2%80%99un-agriculteur-avec-la-nouvelle-loi-
[19] http://www.semencespaysannes.org/reglementation_especes_vegetales_cultivees_qu_117.php#question7
[20] Un décret du 3 août 2014 a fait passer le nombre d’espèces reproductibles à la ferme de 21 à 34, article L623-24-1 du Code de la propriété intellectuelle, Modifié par LOI n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 – art. 58
[21] Les 21 premières espèces dérogatoires sont : Pois chiche, lupin jaune, luzerne, pois fourrager, trèfle d’Alexandrie, trèfle de perse, féverole, vesce commune, avoine, orge, riz, alpiste des Canaries, seigle, triticale, blé, blé dur, épeautre, pommes de terre, colza, navette, lin oléagineux. Les 13 nouvelles espèces sont : cinq espèces de fourragères, une espèce oléagineuse, deux Cipan (culture intermédiaire piège à nitrates), trois espèces de protéagineux, et deux espèces de potagères (pour la liste complète, voir : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029323640&categorieLien=id)
[22] uniquement celle sur le blé tendre a rapporté 6,5 millions d’euros aux obtenteurs lors de la campagne 2012-2013, http://www.lafranceagricole.fr/actualite-agricole/semences-fermieres-une-cotisation-de-0-70-t-collectee-pour-toutes-les-cereales-73854.html. Les CVO autres que celles du blé tendre viennent tout juste d’être mises en consultation par le ministère de l’Agriculture jusqu’à début novembre 2015, voir https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-37e02296-bb09-4455-a3cd-ec90700eafa0
[23] alors qu’en Pologne on reste petit agriculteur jusqu’à 25 ha de céréales, soit plus des 3/4 des paysans polonais, voir http://www.agriculture-durable-limousin.org/actualite/actualite-semences/45-lexemption-de-la-cvo-pour-les-petits-agriculteurs-mise-en-sursis-.html
[24] Ils rajoutent qu’un sélectionneur qui vend des animaux reproducteurs n’exige pas de royalties sur sa descendance, mais se contente de le vendre plus cher qu’un animal destiné à l’engraissement ou à l’abattage
[25] Pour commercialiser ensuite ses semences, l’agriculteur devra cependant s’enregistrer au GNIS
[27] , « Traité sur les semences : danger, biopiratage en vue ! », Inf’OGM, 18 septembre 2015
[28] http://www.lemonde.fr/planete/article/2014/04/30/le-brevetage-de-la-nature-en-question_4409389_3244.html
[29] , « Débat Gnis / RSP : dialogue de sourds sur la sélection variétale », Inf’OGM, 25 février 2015
[30] , « Traité sur les semences : danger, biopiratage en vue ! », Inf’OGM, 18 septembre 2015
[31] Il s’est contenté de confier l’étude de la question à un groupe de travail
[32] Divseek est un programme international qui veut décortiquer les séquences génétiques des ressources contenues dans les banques de gènes pour les publier sur des bases de données électroniques. Les brevets déposés sur des séquences génétiques permettent l’appropriation de toutes les plantes qui contiennent ces séquences et expriment un caractère qui leur est lié, cf. , « Les brevets à l’assaut des semences », Inf’OGM, 2 juillet 2015
[33] http://viacampesina.org/fr/index.php/les-grands-ths-mainmenu-27/biodiversitt-resources-gtiques-mainmenu-37/1158-le-traite-des-semences-ebranle-par-la-gangrene-de-la-biopiraterie
[34] appelé précisément « Décret n°81-605 du 18 mai 1981 pris pour l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants »
[35] « Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes :
![]() la fourniture de semences à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection ;
la fourniture de semences à des organismes officiels d’expérimentation et d’inspection ;
![]() la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n’acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie ».
la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n’acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie ».