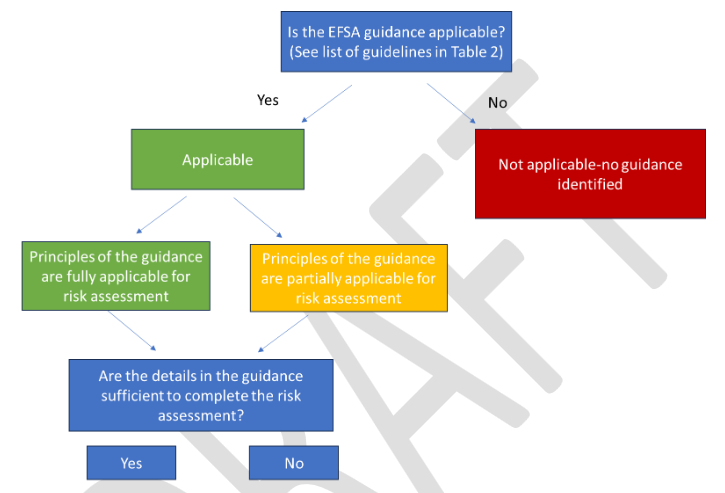De l’éthique générale… comme cadre de l’évaluation des OGM
Le Comité Économique, Éthique et Social (CEES) du Haut Conseil des Biotechnologies (HCB) a décidé de créer un groupe de travail sur la question : « comment harmoniser les recommandations sur les biotechnologies avec une éthique générale en évolution et comment mettre cette évolution en démocratie ? ». Diverses instances consultatives, eu Europe, ont déjà abordé les questions d’éthique dans le domaine des biotechnologies, mais le HCB innove en proposant une réflexion inverse, en considérant les biotechnologies dans le domaine de l’éthique générale. Nous avons demandé à Frédéric Jacquemart, vice-président du CEES (et par ailleurs Président d’Inf’OGM), à l’origine de cette initiative, de la présenter à Inf’OGM, en son nom propre, puisqu’il est bien entendu qu’il ne peut s’exprimer au nom, ni du groupe, ni de l’institution qui l’a instauré. Voici sa réflexion.
Toute évaluation nécessite des jugements de valeur (« ceci est bon ou mauvais, souhaitable ou non, discutable ou évident, etc. »). Ces jugements ne peuvent être absolus et prennent sens dans un contexte éthique particulier. La pertinence du jugement dépend donc de l’adéquation de ce contexte avec ce qu’on pourrait appeler « l’état du monde ». Evaluer des OGM (ou autre objet technologique nouveau) sans autre forme de réflexion, revient à valider, de fait, le contexte éthique culturellement hérité, déclaré implicitement adéquat (et unique).
Avant de poursuivre, une description forcément très schématique de ce que nous entendons par « éthique générale » s’impose : l’être humain a des sens (vue, ouïe, odorat…) et des capacités physiques plutôt médiocres par rapport aux prédateurs dont il pourrait être la cible. Sa survie lui impose depuis toujours une vie en société, vie sociale qui tout à la fois entraîne des restrictions à ses désirs, pulsions, décisions, etc. et ouvre la possibilité de nouvelles conceptions, notamment de soi (ontologie). L’individu construit son être à travers la société qui lui sert de cadre, en tant qu’il a une relation de co-construction avec les individus de sa communauté (nous allons y revenir) mais aussi avec cette communauté (société) en tant que telle. Il s’agit bien de relations complexes et non assimilables à un ensemble (société) comprenant des membres (individus) (1). Le bien individuel nécessite un bien commun visant à l’harmonie entre l’individu et la société. L’éthique générale constitue ce cadre conceptuel, fait d’explicite et d’implicite, censé harmoniser les individus et le bien commun. Les déclinaisons de cette éthique générale dans des cas concrets relèvent de l’éthique appliquée, en œuvre le plus souvent dans les comités d’éthique. Pour artificielle que soit cette distinction, elle est pratique et c’est du fait des facilités de présentation qu’elle procure que nous l’utilisons.
Ce qui est « mal » dans un cas peut devenir « bien » dans l’autre
Mais ce « bien commun » et cette « harmonie » ne sont pas non plus des absolus. Une première évolution est très bien résumée par Darwin (2) : « À mesure que l’homme avance en civilisation et que les petites tribus se réunissent en communautés plus nombreuses, la simple raison indique à chaque individu qu’il doit étendre ses instincts sociaux et sa sympathie à tous les membres de la même nation, bien qu’ils ne lui soient pas personnellement connus. Ce point atteint, une barrière artificielle seule peut empêcher ses sympathies de s’étendre à tous les hommes de toutes les nations et de toutes les races ». Darwin introduit là ce qu’on peut appeler la considération morale. Dans sa tribu, l’individu, du fait de l’éthique générale sociale évoquée plus haut, doit avoir de la considération morale pour les membres de la tribu, qu’il doit donc respecter (idéalement). Les membres de la tribu voisine, eux, ne sont pas nécessairement concernés par cette considération morale et peuvent éventuellement, bien qu’étant reconnus humains, être pillés ou tués. Ce qui est « mal » dans un cas peut devenir « bien » dans l’autre, du simple fait des limites de la considération morale. On a vu encore récemment, comme au Rwanda ou en Yougoslavie, ce que pouvait donner un changement de délimitation de cette considération morale édictée par des dirigeants… Nous percevons aussi à cette occasion l’importance considérable de l’implicite, du non dit, dans l’éthique (et de manière encore plus générale, dans la culture).
Dans cette éthique sociale, la nature, qu’on nomme « environnement » du fait du caractère anthropocentriste de cette éthique, est un objet extérieur, à considérer comme les autres, au sein de l’éthique sociale. Les enquêtes dites de commodo et incommodo (3) du XIXe siècle ou les enquêtes publiques actuelles (ou l’évaluation des OGM !) traduisent parfaitement cette situation. De plus, bien que comme toujours, quelques exceptions aient existé de temps à autre dans l’histoire, la nature est, de fait, considérée comme ayant une résilience (4) infinie. Il n’y a donc pas à se soucier de son devenir. C’est de cette éthique générale sociale dont nous héritons (5) et qui est validée a priori et implicitement (6) lorsque, par exemple, une évaluation au cas par cas est décidée pour les OGM. En effet, ce faisant, on décide qu’il n’est pas pertinent de réfléchir au cadre éthique dans lequel on se situe et qui est commun à tous les OGM et aux techniques qui les produisent. Si l’évaluation est faite au cas par cas, on place hors de toute réflexion le cadre (éthique) dans lequel se situe l’analyse. Dans un monde relativement stable, on peut concevoir que le cadre éthique hérité soit considéré comme valide a priori. Dans un monde en mutation comme celui dans lequel nous vivons, ce n’est plus possible. L’éthique traditionnelle, héritée, permet des jugements de valeur qui conduisent nos actes. A l’heure où ces actes aboutissent à une altération profonde de la biosphère, on ne peut plus considérer cette éthique générale héritée comme étant adéquate et hors de tout questionnement, sauf à poursuivre le mouvement de destruction de nos propres conditions de vie. Cette situation est générale, elle vaut aussi pour les OGM.
Vers le milieu du XXe siècle, il devient en effet patent que cette résilience de la nature ne peut plus être considérée comme infinie. Les effets des activités humaines sur la nature ne peuvent plus être considérées comme des perturbations temporaires réversibles et des alertes sont lancées (7). Dès lors que le social devient clairement dépendant de l’état du monde, lui-même non immuable, mais vulnérable aux actions de ces (ou cette) sociétés, le bien commun change de nature. Comme l’individu se co-construisait avec la société, la société doit maintenant s’harmoniser avec une nature vulnérable. Le bien, pour chaque individu, se pense en fonction d’une nature dont il fait partie, sans pour autant abandonner la nécessité d’une harmonie sociale, bien au contraire, mais cette harmonie sociale change profondément dès lors qu’elle est plongée dans d’autres nécessités. Notamment, la hiérarchie des valeurs, à la base des jugements et de l’évaluation, s’en trouve bouleversée. Quant à la considération morale, elle tend à être étendue à tous les êtres (8).
Le « syndrome Gramsci »
Encore une fois, il serait très dangereux d’appliquer à cette nouvelle et naissante éthique générale de la nature la vision réductionniste et ensembliste déjà dénoncée. Les rapports de l’individu, de la société et de la nature sont complexes et le système de valeurs peut difficilement être autre chose qu’une émergence sociale évolutive. Cependant, il est possible, dans l’urgence, d’établir des hiérarchies en rapport avec des enjeux particulièrement cruciaux (climat, artificialisation des terres, destruction de la biodiversité par exemple). Un aéroport ou une route périphérique détruisant des terres agricoles de qualité ou des espaces naturels précieux ne sont simplement plus justifiables actuellement, sauf par des réactionnaires archaïques incapables de prendre conscience de l’évolution éthique nécessaire (9).
Ce changement éthique est en cours et s’exprime de façon variée. Il s’en suit que lorsqu’on veut débattre, par exemple à propos des technologies nouvelles, deux choses se produisent : d’une part, les participants ne parlant pas de la même chose à travers les mêmes mots, c’est une cacophonie et non un débat (cf. ce qui se passe avec les OGM depuis 15 ans !) et d’autre part, accepter de débattre sans qu’il soit possible d’aborder la question du contexte éthique et culturel revient à valider le contexte qui, justement, a généré ce qui fait question. C’est ce que le GIET (10) a appelé le « syndrome Gramsci », du nom du révolutionnaire italien qui disait que contester un système dans les termes de celui-ci revenait à le conforter. C’est tout le problème de la démocratie participative dès lors qu’elle s’adresse à des problèmes de société (nanotechnologies, OGM, biologie de synthèse, transhumanisme, etc.) où ce qui devrait être en question est posé comme un a priori non questionnable. Sans vouloir parler à la place de PMO (11), il nous semble que c’est ce qu’exprime cette organisation lorsqu’elle vient perturber des réunions où, de bonne foi, des participants pensent venir débattre, justifiant et consolidant, sans qu’ils en aient l’intention, cela même qui est à l’origine des nanotechnologies ou de la manipulation et asservissement du vivant. Instaurer de vrais débats est une nécessité. On ne saurait choisir à la place des citoyens. Mais les formes de ces débats, qui permettent une remise en cause des fondamentaux éthiques et culturels, sont à mettre au point. C’est un des thèmes, aussi, du groupe d’étude mis en place par le HCB, non pour répondre, bien évidemment, mais pour rendre ces questions politiquement pertinentes.