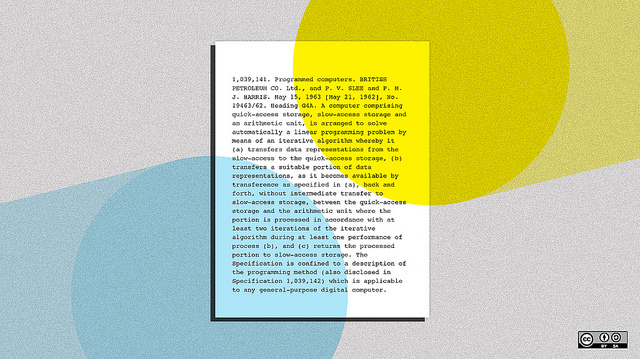Actualités
Numériser les gènes pour posséder le vivant sans partage ?

En 1992, la Convention sur la diversité biologique (CDB) a placé les ressources génétiques sous la souveraineté des États. Pour les utiliser, une entreprise doit donc demander l’autorisation à l’État concerné après l’avoir informé de l’utilisation qu’elle compte en faire, et signer un contrat de partage des bénéfices réalisés. Mais aujourd’hui, les entreprises cherchent à contourner ces obligations de consentement préalable et de partage des bénéfices en construisant des bases de données de séquences et d’informations génétiques numérisées… librement accessibles ! Numérisation versus partage des bénéfices : cet article décrit les enjeux de cette bataille.
Des génomes de plantes, animaux ou micro-organismes ont déjà été partiellement ou entièrement séquencés. Et la quantité de séquences génétiques obtenues va croissante. Car depuis une vingtaine d’années, les techniques de séquençage des génomes évoluent, varient, changent… À tel point que le récent forum économique mondial de Davos en Suisse a promis début 2018 un financement de quatre milliards de dollars sur dix ans pour séquencer le génome de tous les organismes vivant sur Terre [1]. Mais plusieurs bases de données mettant en ligne des collections de ces séquences génétiques existent déjà. Et des programmes ambitionnent d’harmoniser l’accès aux différentes bases de données qui recensent de telles séquences de génomes, comme le programme controversé Divseek depuis 2014 [2].
Comment gérer ces données obtenues par séquençage du génome et collecte des fonctionnalités d’organismes vivants, et notamment de plantes ? Comment réglementer leur utilisation ? C’est pour en discuter que les pays signataires de la CDB se sont réunis du 4 au 17 décembre 2016 à Cancun (Mexique) au cours d’un atelier intitulé « Information de séquençage numérique sur les ressources génétiques ». Pas de conclusion, mais un mandat pour qu’un comité technique ad hoc d’experts de la CDB avance sur ce sujet. Ce comité s’est réuni une première fois à Montréal en février 2018 [3]. Participent à ce comité quatorze États dont le Congo, le Mexique, les Philippines, le Canada, les États-Unis (non membre de la CDB), l’Argentine ou l’Union européenne, des associations comme Third World Network, des collectifs de recherche internationaux comme le CGIAR [4], des instances internationales comme l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Traité international sur les ressources génétiques pour l’agriculture et l’alimentation (Tirpaa), la Chambre Internationale du Commerce…
Convention, traité : de bonnes intentions non concrétisées
Pour œuvrer à conserver la diversité biologique, assurer que son utilisation soit « durable » et que toute exploitation commerciale des ressources génétiques la composant fasse l’objet d’un partage juste et équitable des bénéfices tirés, la Convention sur la diversité biologique seule ne peut rien faire. Elle doit être mise en œuvre par un texte international contraignant, un Protocole.
En attendant l’entrée en vigueur d’un tel protocole – ce qui fut fait en… 2014 – la FAO accueillait en 2001 le Traité international sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture (Tirpaa) pour « mettre en place un système mondial permettant de fournir un accès aux matériels phytogénétiques aux agriculteurs, aux sélectionneurs de végétaux et aux scientifiques [et] s’assurer que les bénéficiaires partagent les avantages qu’ils tirent de l’utilisation de ces matériels génétiques avec les pays d’où ils proviennent » [5]. Ce Tirpaa concerne 64 des principales espèces agricoles qui à elles seules représentent 80% de notre consommation de cultures végétales. Et pour organiser l’accès aux « ressources phytogénétiques » et le partage des avantages tirés de l’utilisation commerciale de ces ressources, le Tirpaa a créé un « Système multilatéral d’échange » (SME), une base de données accessible sur Internet qui permet d’accéder à plus de 3,5 millions d’échantillons de ces 64 espèces agricoles conservés dans les banques de semences versées au SME. Pour les entreprises semencières par exemple, accéder à de telles ressources phytogénétiques leur permet de les « améliorer », d’en sélectionner d’autres et de les commercialiser ensuite. Mais pour ce faire, elles doivent signer un accord type de transfert de matériel (ATTM) avec le pays ayant fourni la plante et verser une part du chiffre d’affaire lié à cette commercialisation si un brevet a été déposé.
Un système qui assure en théorie un partage juste et équitable des avantages mais qui dans les faits ne remplit pas son rôle [6] [7]. Mais en 2014, les choses changent : la CDB devient enfin contraignante avec la mise en œuvre du protocole de Nagoya. Ce protocole met en œuvre de façon contraignante le partage des avantages prévu par la CDB, notamment pour les espèces cultivées non concernées par le Tirpaa. Des espèces parmi lesquelles se trouvent le soja, la tomate ou le quinoa par exemple. Ce protocole pourrait donc aboutir à une obligation de consentement préalable et de partage des avantages effective, et à une obligation de traçabilité des échanges de ressources génétiques, alors que les semenciers, de leur côté, les considèrent comme un secret industriel. D’autant que dans le même temps, des pays œuvrent à ce que le Tirpaa adopte à son tour un système de partage des avantages efficace.
L’expression « informations de séquences numérisées » permettrait-elle d’échapper à la loi ?
Une opportunité d’échapper à ces obligations se présente avec le séquençage des génomes. Car des chercheurs et des entreprises ont d’ores et déjà constitué des bases de données de séquences et d’informations génétiques informatisées. Une dématérialisation des ressources génétiques et leur enregistrement dans des bases de données électroniques qui revient à constituer un catalogue de ressources génétiques dans lesquelles les entreprises espèrent pouvoir piocher et y repérer les séquences liées à des fonctions (résistance à un pathogène, un herbicide…) qui les intéressent. Et revendiquer ensuite une propriété industrielle (brevet) sur ces séquences et/ou sur l’information correspondante. Mais, pour cela, une première étape doit nécessairement être franchie : convaincre que « séquence et information génétiques » ne sont pas assimilables aux « ressources génétiques » et échappent donc aux obligations de consentement préalable informé, de traçabilité et de partage des avantages !
Les participants à la réunion de Montréal ont donc démarré leur réunion sur des questions de définition des termes. Les choses sont assez basiques : les termes « matériel génétique » et « ressources génétiques » de la Convention comme les termes « utilisation de ressources génétiques » et « dérivé » du Protocole de Nagoya couvrent-ils les termes « séquençage numérique » utilisés pour évoquer le sujet des bases de données recensant toutes les séquences génétiques des organismes collectés ? Question importante on l’aura compris car, en cas de réponse positive, ces bases de données tombent sous le coup de la Convention et du Protocole et donc du consentement préalable informé, de traçabilité des échanges et du partage des avantages. En cas de réponse négative, aucune contrainte.
Les gouvernements en désaccord
Selon le résumé des contributions reçues préalablement à la réunion de Montréal, deux tendances apparaissent : la première, défendue par plusieurs pays ou parties prenantes comme l’Inde, le Mexique, le Brésil, le continent africain, l’association Third World Network (TWN)… [8], considère que les « informations génétiques » relèvent bien des termes « ressources génétiques » ou « matériel génétique ». Conséquence, les accessions aux bases de données d’informations génétiques doivent se faire dans les conditions énoncées par la Convention et le Protocole. La seconde tendance portée par des pays comme les États-Unis, le Japon, l’Australie et des organisations comme l’Association européenne des semenciers considère qu’ « il existe une différence entre les matériels génétiques et les informations les décrivant » [9] qu’il est essentiel de maintenir. Certaines contributions vont jusqu’à argumenter que Convention et Protocole encadrent l’accès aux matériel / ressource génétique, c’est-à-dire des éléments physiques, alors que les informations numérisées seraient par définition non physiques et donc non concernées. La stratégie derrière cette argumentation est bien résumée par l’Association européenne des semenciers qui écrit que si les informations numérisées de séquençage génétique « étaient inclues [dans la législation du partage des avantages] [cela] changerait le paysage scientifique global […] car elles ne seraient plus largement accessibles à tous les acteurs du secteur agricole » [10]. Entendez, notamment pour les entreprises…
Il est intéressant de noter la position de l’Union européenne. Une contribution datée de septembre 2017, non signée mais émise au nom de l’Union européenne et de ses États membres précise que « tout en reconnaissant le fait que l’utilisation d’information génétique numérisée doit être soumise à des requis au niveau domestique […] et des requis de partage des avantages, l’Union européenne et ses États membres sont d’avis que l’accès à une information n’est pas équivalent à l’accès aux ressources génétiques au sens de la CDB et du Protocole de Nagoya »…
La traçabilité, faisable mais commercialement gênante
Au cas où les séquences numérisées devraient tomber sous le coup du partage des avantages, un aspect technique déterminant pour que cela soit opérationnel est la traçabilité de ces informations. Autrement dit, la capacité à établir si telle ou telle plante a été développée ou pas en partant d’une séquence numérisée identifiée dans telle ou telle ressource génétique. Une situation qui rappelle celle du débat sur la réglementation ou non des nouveaux OGM. Dans le dossier OGM, une théorique impossibilité technique à tracer des modifications est avancée par certains. A contrario, les experts sur les ressources génétiques jouent eux carte sur table. Le rapport de la réunion de février mentionne en effet que les échanges ont amené les experts « à noter que » une traçabilité serait utile et facilitée « par l’utilisation d’identifiant unique », que la « capacité de tracer s’améliore avec les nouveaux développements technologiques » et que, « pour être efficace », la traçabilité devrait être obligatoire. Mais certains s’inquiètent que des requis de traçabilité pourraient créer « des barrières inutiles à l’accès aux données et leurs utilisations ». En clair, la traçabilité est faisable techniquement mais pour certains, gênante commercialement…
Face à la dispersion des points de vue, la réunion de février 2018 à Montréal a conclu que plus de discussions étaient nécessaires pour « trouver une balance entre une terminologie suffisamment adaptable et dynamique pour s’adapter aux changements scientifiques, technologiques, commerciaux et autres, et dans le même temps être suffisamment claire et solide pour fournir une base juridique certaine ». Les discussions continuent donc… Prochaine étape ? Une réunion du SBSTTA, l’Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques à la CDB, en juillet 2018 à Montréal sur ce sujet avant une grande réunion des Parties à la Convention sur la Diversité Biologique qui se retrouveront à l’automne 2018 en Égypte [11].
Dématérialisation des ressources génétiques : d’autres lieux de discussions
La Convention sur la Diversité Biologique et le Protocole de Nagoya ne sont pas les deux seuls lieux de discussions sur le sujet de la dématérialisation des ressources génétiques. Au niveau international, le Tirpaa bien sûr, comme Inf’OGM l’a déjà rapporté, discute âprement de cette question. La FAO aborde également ce sujet au sein de sa Commission sur les ressources génétiques pour l’agriculture et l’alimentation avec les volets animaux, forêts, aquatiques et plantes [12]. L’Assemblée Générale des Nations unies elle-même s’intéresse au sujet depuis qu’elle a décidé en 2015 de se doter d’une loi sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine qui intègre cette question des ressources génétiques. Et les discussions préparatoires ont déjà fait apparaître que « différentes opinions ont été exprimées [quant à savoir] si accéder et tirer bénéfices de ressources génétiques in silico seraient inclus dans un instrument international » [13].
[1] Davos : lancement de la Banque du Vivant. Vers un accaparement de la vie par l’économie ? Gérard Ayache, 24 Janvier 2018.
[2] , « DivSeek : chronique d’une biopiraterie légalisée », Inf’OGM, 5 juillet 2017
[3] Ad hoc Technical expert Group On Digital Sequence Information On Genetic Resources, Montreal, Canada, 13-16 February 2018, Report Of The Ad hoc Technical expert Group On Digital Sequence Information On Genetic Resources
[4] CGIAR : c’est le regroupement des centres internationaux de recherche agricole, organisés souvent par type de culture (exemple : le Cimmyt, Centre du blé et du maïs au Mexique, l’Irri, pour le riz, basé aux Philippines…)
[6] , « Des semences partagées, mais des droits paysans théoriques », Inf’OGM, 29 octobre 2013
[7] , « Le Tirpaa, 10 ans après : l’industrie semencière ne joue pas le jeu… », Inf’OGM, 29 octobre 2017
[8] La synthèse des contributions reçues est disponible en anglais
[9] U.S. Submission on Digital Sequence Information on Genetic Resources, 18 August, 2017
[10] ESA Submission On The Use of Digital Sequence Information and the benefits thereof for the three objectives of the Convention on Biological Diversity
[11] ,
, « Internet et biopiraterie, les États ne sont pas d’accord », Inf’OGM, 22 janvier 2019